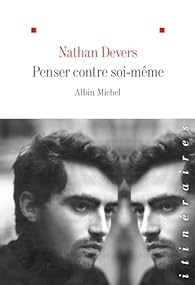Réflexions sur l’effondrement
Corinne Morel Darleux
Libertalia - 2019-2024
10€ 107 pages
Réflexions saisies avec la lecture de ce livre de petit format.
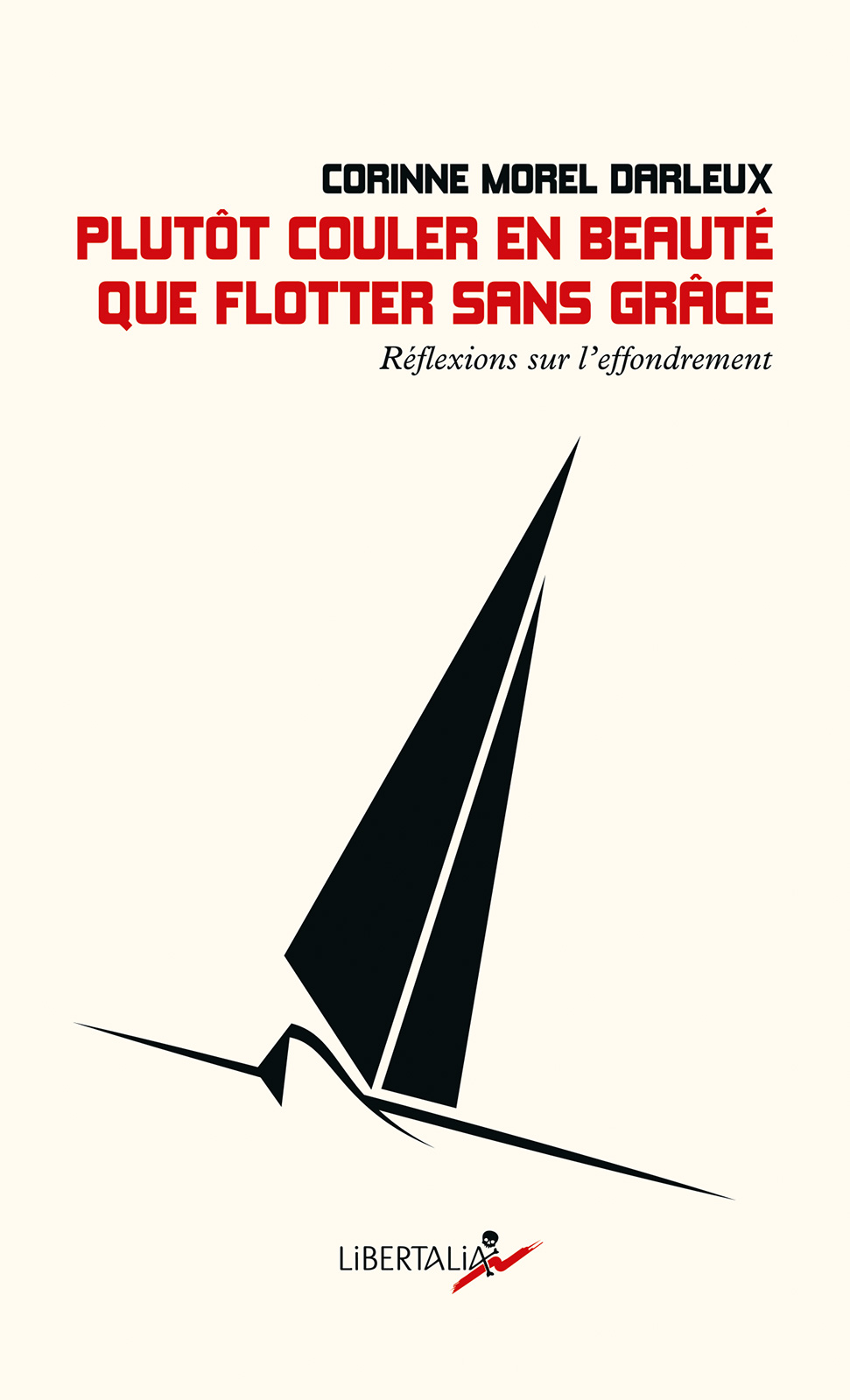
De Bernard Moissetier, navigateur auquel l’auteur fait référence tout au long de son livre :
« Le capitaine attend le miracle, entre le bar et le salon… mais il a oublié qu’un miracle ne peut naître que si les hommes le créent eux-mêmes, en y mettant leur propre substance » (La Longue route).
Le rapport Meadows qui critique la croissance économique date de 1972.
« Pas de médiocrité ou de trahison qui n’ait déjà été opérée » (p12)
Moissetier est comparé à un Maverick, « un cheval sauvage qui choisit de vivre en marge de la harde : il reste à distance mais suit la marche du troupeau, sans jamais s’en éloigner jusqu’à s’en exclure » (p17)
« La consommation ostentatoire », avec l’idée de « conforter leur place sociale et de se singulariser » (p21).
L’otium «au sens de temps libéré » est l’objet d’une rivalité mimétique, une fabrique de l’ignorance (p22)
Hannah Arendt : « Les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action » (p25)
« Le refus de parvenir n’implique ni de manquer d’ambition ni de bouder la réussite (p26)
« Refuser une promotion est contre-intuitif, mais ça ne signifie pas qu’on manque d’ambition. Simplement qu’on ne place pas tous l’épanouissement au bon endroit ». (p28)
« Le refus de parvenir doit s’accompagner d’une réflexion politique...traverser un moment dur quand vous l’avez choisi, quand vous vous sentez en phase avec vous-même, est très différent de le subir par le contrôle qu’exercent d’autres sur votre vie » (p30)
« S’alléger pour mieux avancer » (p31)
« Pour que la pauvreté subie se transforme en frugalité choisie, il y a besoin de choix individuels, mais aussi d’organisation collective. De services publics et de protection sociale... Besoin de réduction de temps de temps libéré, afin que le souci de l’intérêt général puisse s’engager et s’exprimer » (p35)
« Besoin d’une organisation collective qui assure ces dispositifs de solidarité et de consentement à l’impôt ; payer des taxes n’est acceptable que si on en voit l’utilité pour soi ou la société » (p36)
« Le refus de parvenir, c’est le dédain des distinctions sociales, de démarches avilissantes » (p37), une insubordination (p38), une « émancipation de la tutelle et de l’autorité, une volonté de cesser de nuire, pour en revenir à la valeur d’usage, l’intention de transformer ses difficultés individuelles en force collective. » (p39).
« L’héroïsme ne nait qu’avec un choix délibéré » (p40) « des constructions intellectuelles, de la formation d’un esprit critique, de capacités de réflexion autonomes : en un mot d’éducation » (p41)
« On peut être pauvre et faire preuve d’esprit bourgeois, à pieds joints dans le conformisme social » (p42)
« Le propre d’un système oligarchique est de nous faire croire que les choses sont ainsi, qu’il n’y a pas d’alternative. Qu’il faut suivre la marche du progrès » (p43)
« Le maintien dans la logique promotionnelle du système est paresse de l’esprit, soumission volontaire, aveuglement et déni qui ne dépendent que de chacun » (p44).
« Le véritable ennemi est celui qui sait, qui possède des leviers pour que ça change, peut choisir de les activer, et qui ne le fait pas. De manière délibérée »... « Beaucoup de personnes sont aujourd’hui conscientes des changements de fond à mener mais n’en ont tout simplement pas la possibilité. Leurs conditions matérielles d’existence entre précarité, disparition de services de proximité, nécessité de travailler, dévissage culturel, laissent peu d’énergie et de disponibilité d’esprit à la fin de la journée » (p54).
« Le système (dominant) décourage les initiatives collectives, associatives, en les asphyxiant une par une. » (p57).
« Le glissement insidieux du combat politique au registre moral » (p58)
« La société en est arrivée à un tel état de dévissage culturel, le conformisme et l’injonction normative sont devenus de tels fléaux, que toute déviation, tout pas de côté, toute élégance gratuite en vient à acquérir une portée subversive. Aussi, couplés à une intention politique, le refus de parvenir et la dignité du présent sont aujourd’hui susceptibles de s’inscrire dans la longue lignée de l’action directe et de la non-coopération au système, au titre de « sabotage symbolique » (p59)
Corinne Morel Darleux évoque son parcours de « transfuge de classe » qui a choisi de ne plus être partie prenante d’un système promotionnel, au demeurant très complexe et contrasté. Elle a payé, de différentes manières, son « pas de côté ». Comme tout un chacun refusant de « parvenir ». Elle évoque sa crainte, que son livre soit assimilé à un ouvrage de développement personnel, réunissant conseils et vérités premières. Nous pouvons la rassurer.
« Pour organiser le pessimisme, encore faut-il partir de ce qui est. Dans une société parcellisée par des décennies de déstructuration méthodique des liens sociaux, on peine à retrouver une classe pour soi, consciente d’une appartenance commune. De même qu’il ne suffit pas de crier le plus fort pour avoir raison, et que répéter une erreur cent fois n’en fait pas une vérité, la méthode Coué ne suffira pas. » (p70)
« Les dérèglements climatiques, la dépendance au numérique, la spéculation financière, l’impasse démocratique, la surexploitation des ressources naturelles, l’explosion des inégalités sociales… Qu’en faire, comment organiser une culture de résistance ? (p77)
Pour ce qui nous concerne, nous avons, depuis longtemps, fait le choix du refus de parvenir. Nous n’avons jamais négligé, depuis, la dimension éthique, culturelle, politique et même spirituelle de notre investissement. Nous avons toujours relié notre particulier – le champ de l’alcoologie – à l’état et à l’avenir de nos sociétés. Nous avons conscience de nos limitations et de nos limites. Comment faire bouger les lignes ? En interpellant, de façon claire, ponctuelle et précise, ceux qui tiennent des commandes. Beaucoup se détourneront mais notre optimisme consiste à penser – « peut-être pas tous » – et à interpeller ceux qui subissent directement le programme de marginalisation, de soumission, d’abrutissement et d’élimination, au premier rang desquels figurent les addictés.