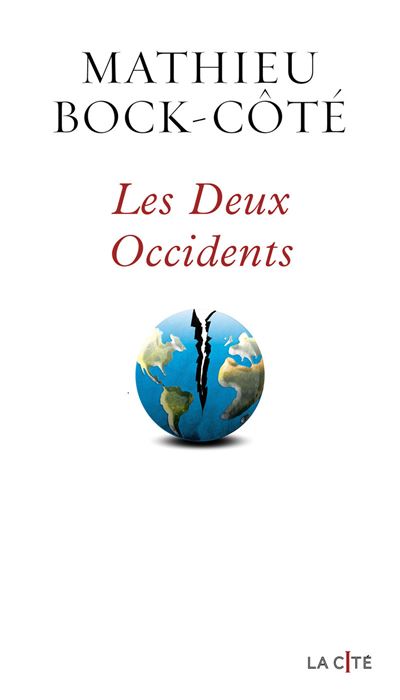Asma Mhalla
Seuil
19€
200 pages
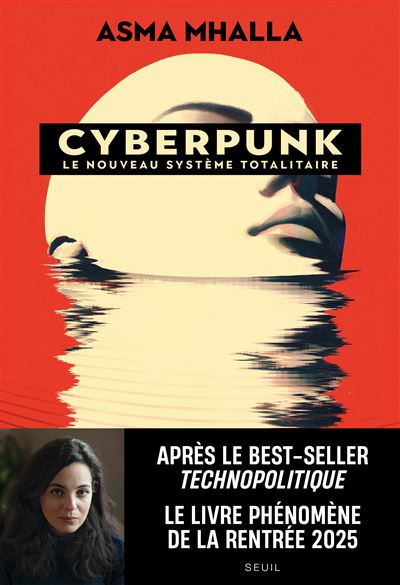
Asma Mhalla est une essayiste franco-tunisienne, née en 1984 (année remarquable de circonstance !), spécialisée dans l’analyse du Totalitarisme numérique.
Mieux vaut préciser d’emblée un point important de vocabulaire. Le concept de totalitarisme est de loin le plus pertinent pour analyser les pouvoirs systémiques antidémocratiques. Il permet de comprendre la matrice de l’ensemble des phénomènes de domination politique qui ont existé, existent et se développeront encore sur notre planète. Le terme de fascisme suscite des confusions et des distorsions de signification. Le fascisme se réduit, historiquement, au franquisme espagnol, avant tout anti-communiste et inféodé à un catholicisme réactionnaire, et au fascisme de Mussolini, un tantinet plus bouffon et nettement moins sanglant. Nous sommes redevables à Hitler et à sa bande du nazisme génocidaire, un modèle d’organisation tourné vers l’efficacité, via la propagande et la terreur.
Staline a inauguré les dictatures déporatrices au prétexte du marxisme-léninisme. D’autres ont instauré des dictatures se réclamant de Mahomet. Le totalitarisme peut se mettre en place, avec ou sans théâtralité.
Le contenu de l’ouvrage de Mhalla n’est guère engageant. Il décrit avec une précision convaincante, et beaucoup d’anglicismes, la collusion-confusion entre le pouvoir politique incarné par Trump et le pouvoir numérique illustré par Musk.
« Ceci n’est pas une crise de la démocratie mais le glissement vers un nouveau régime. Nous sommes confrontés à un Léviathan à deux têtes. L’une organise le show pendant que l’autre code le système. »
« Le futur est déjà là » déclarait William Gibson, auteur de science-fiction, appelé Cyberpunk.
En référence au monde d’Huxley : « la cage de fer technologique est omniprésente, quadrillant un monde surpeuplé, sur-pollué, où errent des individus désabusés et isolés dans des mégapoles désenchantées » (p19).
Ce qu’elle appelle avec d’autres le « techno-fascisme », consacréel’alliance entre le Big State et le Big-Tech. (sans oublier les médias main stream.)
On retrouve au passage un de nos concepts avec le « darwinisme sociétal » (p22).
La « monarchie des cinglés » se met en place.
« La Chine est le modèle : impérialisme + protectionnisme ». (p51).
Le rêve dérisoire et pathétique de l’immortalité de l’élite (p55).
Un nouveau régime attentionnel (p117): « La saturation comme nouvelle expression politique de la censure ».
Arendt distinguait deux types de vérités, les vérités factuelles (ce qui s’est réellement passé, et les vérités rationnelles (logiques et philosophiques) (p121).
Le DOGE (Department of Government Efficiency) a donné aux “élites” le pouvoir par des coupes budgétaires et des licenciements », en octroyant des marchés à ses propres entreprises et aux autres entités économiques amies. Les « agences luttant contre la désinformation, comme le Global Engagement Center, ont été fermées ». Le DOGE a rencontré peu de résistance (p133).
Quelques dizaines de jours ont suffi à « détricoter l’Etat » (p136).
« La dérèglementation massive et la politisation de l’appareil d’Etat participent à la privatisation du pouvoir politique au profit de quelques acteurs stratégiques privés ». Le politique s’hybride avec le pouvoir technologique et financier. (p141).
La capacité de collecte, de croisement des données sont bien supérieures à celles des polices secrètes historiques (Gestapo, Stasi).
L’explosion des maladies mentales sera proportionnelle à l’augmentation technologique des cerveaux. Le malheur du monde du « bas » est invisibilisé. Plus on technologise une société, plus on la rend vulnérable.
« Surveillance permanente, altération des perceptions, effacement des citoyens devenus instruments dociles (p153), plus on technologise une société, plus on la barbarise. (p151)
La conclusion du livre est d’un optimiste relatif, le nôtre.
« Dire non se révèle salvateur du reste, c’est le refus de l’abus, de la servitude, de l’esclavage, de la mort intérieure, du gâchis et de l’absurde.
Les réponses : la réflexion, l’observation, les rencontres, le nous qui s’impose aux « on », le refus silencieux d’obtempérer, l’amour de la liberté et le sens du fraternel.
L’essai s’achève par quelques définitions et références livresques utiles.