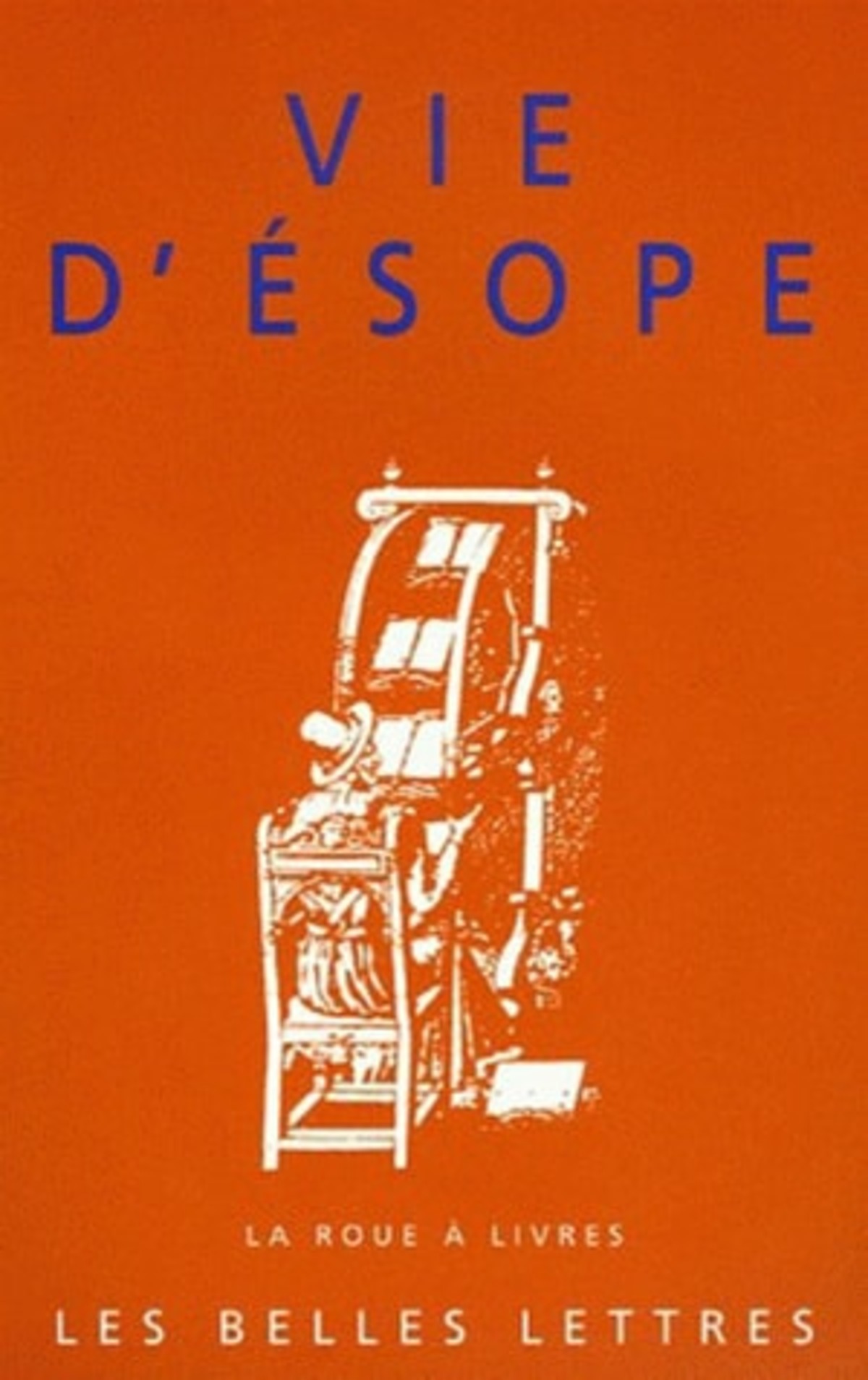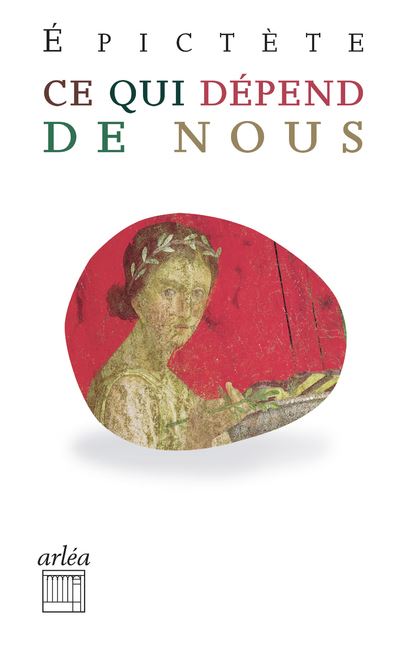Epictète
Arléa
9€ 251 pages
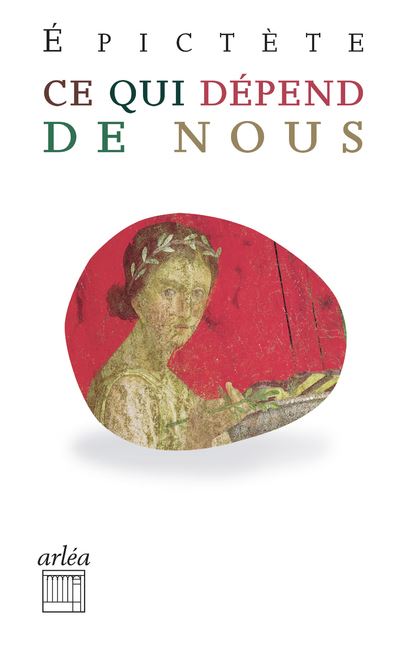
C’est à Cicéron que nous devons la mise à disposition de la réflexion des stoïciens et notamment de celle d’Epictète qui, à défaut d’innover, eut la passion d’éduquer. Epictète est né 50 ans après JC.
L’intitulé du Manuel, traduit par Myrto Gondicas, est tout un programme de vie : « Ce qui dépend de nous ». Il fixe une exigence et une limite, un territoire d’action, d’interactions et d’influences dont il nous appartient de fixer les contours.
Il peut sembler étrange que, vingt siècles plus tard, un éditeur s’avise de publier ce genre d’écrits et qu’il se trouve des lecteurs pour les apprécier. Il faut croire que la déraison humaine est tenace pour justifier d’avoir à rappeler des remarques de bon sens, aux couleurs du temps de leurs écritures. Chacun peut annoter ou souligner celles qui lui parlent, plus ou moins. Le ton est familier et bon enfant. Jugez-en !
« Ne te monte jamais la tête pour une chose où ton mérite n’est pas en cause » (p21) (sois fier des victoires que tu remportes sur toi-même)
« N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites » (p22)
« Devant tout ce qui t’arrive, cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. » (p23)
« Si tu veux progresser, accepte de passer pour un ignorant dans ce qui concerne les choses extérieures. Si certains ont bonne opinion de toi, méfie-toi » (p24)
« Exerce-toi à ce qui est en ton pouvoir. Que ceux qui veulent être libres s’abstiennent de vouloir ce qui ne dépend pas d’eux. (p25)
« Quand le plat, faisant le tour des convives, arrive devant toi, tends la main et sers-toi comme il convient. S’il te passe sous le nez, n’insiste pas. (p25)
« Si un corbeau pousse un cri de mauvais augure, ne te laisse pas entraîner par ton imagination (p27)
« Pour être libre, un chemin : le mépris de ce qui ne dépend pas de nous » (p28)
« Que la mort, l’exil et tout ce qui te semble redoutable soient présents à tes yeux tous les jours » (p28)
« Si ton désir te pousse vers la philosophie (sobriété), prépare-toi à être partout en butte aux moqueries et aux sarcasmes » (ou du moins aux incompréhensions et à l’animosité voilée) (p28)
« Qui peut donner à autrui ce qu’il n’a pas lui-même ?» (p30)
« Il suffit à chacun d’accomplir sa tâche » (p31)
« Donne ton dû quel qu’en soit le prix. Mais si tu veux être payé de retour sans rien donner, tu n’es qu’un fou » (accepte aussi de donner sans recevoir en retour) (p32)
« Pour tout ce que tu entreprends, examine les tenants et les aboutissants avant de passer à l’action » (p33)
« Crois-tu en faisant le choix de la philosophie pouvoir céder à tes désirs et à tes colères ? (p35)
Seras-tu prêt à privilégier l’insensibilité aux émotions, la liberté, la sérénité ? (le détachement émotionnel) Si c’est non, ne va pas plus loin » (p 35-36) (Toute proportion gardée, c’est ce qui correspond au choix de la sobriété pour une personne alcoolique.)
« Personne ne te fera de mal, à moins que tu n’y consentes » (p37)
« Décide d’un style, d’un genre de vie que tu garderas aussi bien seul que devant les autres » (p41)
« Quand l’occasion t’y convie, parle, mais ne t’occupe pas de l’actualité » (p41)
« Pas de réflexions sur les gens… Si tu te trouves seul au milieu de gens que tu ne connais pas, tais-toi encore » (p41) Laisse tomber les invitations à dîner. Si les circonstances justifient que tu t’y rendes, soit attentif au contenu des échanges, ne te crois pas obligé de te mettre au diapason. (p41)
« Si l’on te rapporte qu’untel dit du mal de toi, ne cherche pas à te défendre. Réponds plutôt : « Il ne connaît pas tous mes défauts, sinon il en aurait dit bien davantage » (p42)
« Si tu te lances dans une entreprise qui dépasse tes forces, non seulement tu te conduis comme un idiot, mais tu négliges ce qui était dans tes possibilités » (p46)
« Face à quelqu’un qui te fait du tort par sa conduite ou ses propos, accepte qu’il ne puisse régler sa conduite sur ta façon de penser, mets la distance qui convient et éloigne-toi de lui (p47)
« Une fois que tu t’es fixé des buts, tu dois t’y tenir comme à des lois. Et quoi qu’on dise de toi, n’y prête pas attention » (p52)
« Si tu te montres négligent, si tu prends les choses à la légère, si tu continues à échafauder projet sur projet en reculant sans cesse le moment où tu devras prendre soin de ta vie, tu ne feras aucun progrès (p53)
Il y a même une forte probabilité que tu passes à côté de ta vie jusqu’à son terme.
« Que tout ce qui te semble le meilleur te soit une loi incontournable. » (p53).
À parcourir ces propos anciens qui résonnent comme des maximes, nous pourrions nous étonner que l’enseignement des principaux courants de la philosophie grecque ne soit pas de tous les programmes scolaires, dès le collège. À quoi sert le gavage des cerveaux s’il ne leur est pas enseigné à discerner, avant de se lancer dans d’incertaines conquêtes ? L’enseignement du stoïcisme, de l’épicurisme et du scepticisme constituerait la meilleure des préventions face aux stimulations narcissiques et consuméristes de la Modernité tardive. Il laisserait un espace suffisant aux croyances religieuses. Ces dernières gagneraient en simplicité ce qu’elles perdraient en arrogance.
Les pages réunies dans la partie « Entretiens » manquent d’intérêt. Elles manifestent la difficulté à donner une portée durable à un échange ponctuel. Elles témoignent, au mieux, d’un esprit de répartie.
La dernière partie de cet ouvrage n’est pas la moins intéressante. Elle a pour objet, un échange entre un religieux de l’abbaye janséniste de Port-Royal des Champs, Mr de Saci, et Blaise Pascal. Celui-ci présente les approches philosophique opposées d’Epictète et de Montaigne pour en situer les limites, qu’il dépasse par la foi. L’esprit de synthèse de Pascal impressionne le religieux, tout en maintenant les préventions de ce dernier qui s’en tient à Saint-Augustin.
Pascal dit peu de chose d’Epictète. Il résume ainsi sa pensée : « C’est votre fait de jouer bien le personnage qui vous est donné ; mais de le choisir, c’est le fait d’un autre » (sous-entendu : Dieu). Epictète souhaite que l’homme soit humble, qu’il adopte de bonnes résolutions et qu’il les accomplisse en secret (p221). Epictète ajoute que « l’esprit ne peut être forcé de croire ce qu’il sait être faux, ni d’aimer ce qui rend malheureux (p222).
Pascal s’attarde bien plus sur Montaigne. Bien que catholique, celui-ci « a voulu chercher une morale fondée sur la raison sans les lumières de la foi… Il met toutes choses dans un doute universel, son incertitude roule sur elle-même dans un cercle perpétuel et sans repos. » (p.222)
Montaigne manifeste ainsi une forme de nihilisme ou, du moins, de scepticisme.
« Il dit qu’il vaudrait autant soumettre sa cause au premier passant qu’à des juges au fait des lois ». Il s’attache à souligner la « vanité des opinions les plus reçues, montrant que l’exclusion de toutes lois diminuerait plutôt le nombre des différends que cette multitude de lois qui ne sert qu’à l’augmenter parce que les obscurités croissent à mesure qu’on espère les ôter » (p.225)
« Nous pourrions croire, selon Montaigne, que la vie est un songe dont nous ne nous éveillons qu’à la mort et pendant lequel nous avons aussi peu les principes du vrai que durant le sommeil naturel. (p.229).
« Je trouve, ajoute Pascal, dans Epictète un art incomparable pour troubler le repos de ceux qui le cherchent dans les choses extérieures, et pour les forcer à reconnaître qu’ils sont de véritables esclaves et de misérables aveugles. Montaigne est incomparable pour confondre l’orgueil de ceux qui, sans la foi, se piquent d’une véritable justice, pour désabuser ceux qui s’attachent à leurs opinions, et qui croient trouver dans les sciences des vérités inébranlables et pour convaincre la raison de son peu de lumière et de ses égarements. » (p243)
Epictète fait courir le risque de l’isolement et Montaigne celui de la passivité. Pour Pascal, la foi est le moyen de sortir de ces impasses. Nous pourrions ajouter comme solutions à la souffrance existentielle : l’amour raisonné de soi et des autres mais également le goût de l’action reliée à la réflexion.