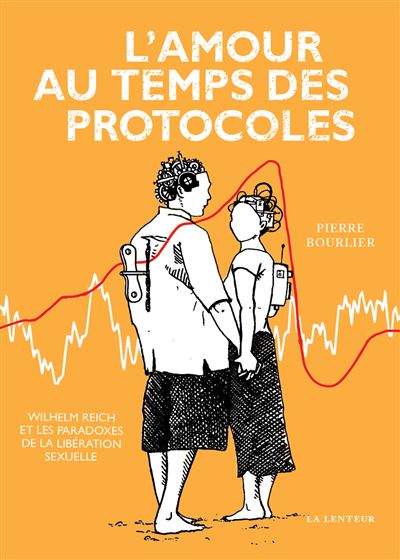Pour ne pas en rester un soi-même
Maxime Rovere
Champs
7€50 202 pages
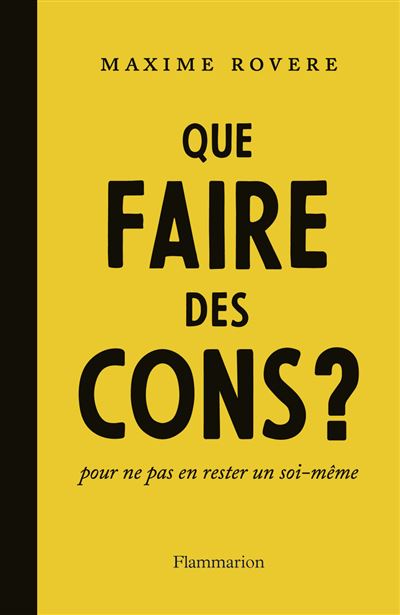
Voici un livre d’une actualité brûlante et permanente, un ouvrage d’autodéfense et d’auto-critique, sait-on jamais, si, par extraordinaire, nous disposons d’assez de recul pour dépister, par instants, en nous les stigmates de l’universelle connerie.
Je suis tombé immédiatement en arrêt devant la date de parution initiale : 2019. Maxime Rover a donc consigné ses réflexions, dans la continuité de sa sensibilité spinozienne, avant la démonstration à l’échelle planétaire du triomphe de la connerie, fondée sur le principe de précaution et le désir de soumettre les masses, en les préparant à obéir aux injonctions les plus absurdes. Pour être juste, nous devons admettre que bien des experts et d’acteurs sociaux n’ont fait que concrétiser, en toute bonne foi, la connerie qui les habitait.
Comme nous le verrons, l’auteur se garde de toute démarche classificatoire. Nous ne trouverons pas dans ses pages d’inventaire à la Buffon ou même à la façon de La Bruyère. Son objectif exprime un souci de bienveillance. Il fournit un certain nombre d’arguments et de recommandations pour nous éviter, dans la mesure du possible, de trop souffrir des cons, en évitant d’occuper nous-mêmes cette position pour les autres.
Je suis tombé sur cet ouvrage édifiant en manquant une conférence ouverte dans le contexte du Festival FIFIGROT. J’ai la chance d’en connaître un des organisateurs. Le soir de la conférence, j’étais bloqué par les consultations. J’ai cédé à l’irrésistible appel de la connerie et voici le résultat de ma lecture.
L’auteur parle en philosophe. Un truisme : « On ne commence à comprendre que dans la mesure où on cesse d’être con ». Le problème, avance-t-il dans son introduction, ce n’est pas la connerie, le problème, ce sont les cons. Stultitia delenda est, aurait pu dire ce con de Caton. Mais quid des cons ? « Leur existence de béotiens stupides et souvent agressifs constitue un problème théorique complexe ». Comme disait quelqu’un à propos de quelqu’un d’autre : « J’ai rencontré X. Nous avons échangé des idées. Depuis, je me sens tout bête ». Le con rend con. Il neutralise nos capacités d’élaboration. Rovere est pessimiste ou réaliste. Pour lui : « il est structurellement impossible de se réconcilier avec les cons, car ils ne le souhaitent pas eux-mêmes.
Trois conclusions jetées en préliminaires
On est toujours le con de quelqu’un ; les formes de la connerie sont en nombre infini ; et le principal con se trouve en nous-mêmes. Après avoir dit ça, on pourra commencer à réfléchir.
(p19) Dans sa bienveillance infinie (le philosophe) accueille avec amour les improvisations les plus stupides, les gestes et les phrases déplacées…Il sait qu’il faut de tout pour faire un monde.
Il y a les cons assis sur leur certitude et d’autres qui rejettent tout et d’autres encore qui se foutent de tout (hormis de leur nombril).
Une tentation serait de constituer une typologie des cons, sous la forme d’une arborescence, ou les regrouper par familles. Ce serait leur donner une consistance qu’ils n’ont pas, même si un grand nombre de livres ou de films ont immortalisé des figures de cons. Un de mes cons préférés, par exemple, le pasteur Collins d’Orgueil et préjugés. Comme Mr Bennet, je prends toujours plaisir à le côtoyer - en imagination. La connerie a ainsi suscité la créativité d’innombrables grands auteurs.
Comment on tombe dans les filets de cons
Il va bien, Maxime. Nous ne faisons pas exprès d’être pris dans leurs filets ! Nous jetons nos filets et nous découvrons des poissons. Une certitude : il est hors de portée de changer un con ordinaire. En revanche, c’est l’alcoologue qui parle, aider une personne intelligente et sensible à écarter l’alcool peut lui permettre de découvrir, de retrouver, de développer ses capacités critiques. Un miracle intervient : un con ou une conne cesse de l’être ! Tel est l’objectif d’un soin pas con, soit le contraire de ce qui est proposé par les cons et les structures faisant autorité. Être alcoologue consiste à aider un con objectif à cesser de l’être. La surprise est de taille. Quelquefois, le miracle ne se produit pas. L’alcool était le masque d’un connard… Certains d’entre eux poussent d’ailleurs le vice jusqu’à rester abstinents, pour être encore plus cons.
Comment se remettre de sa stupeur
En identifier un, c’est commencer à en devenir un autre, risquer de perdre son sang froid et ses capacités d’analyse. Le con vous met à l’épreuve !
Comment on passe de la faute à chance
Cela doit parler aux personnes alcooliques qui se décident à secouer le joug de leur consommation. « J’avais tout faux » disent les « repentis ».
« Parmi les cons, il y a ceux qui se délestent sur les autres de leurs frustrations accumulées, qui couvrent tout l’Univers de reproches » (p 46). Il y aussi ceux qui se focalisent sur un groupe : C’est la faute aux, la faute à. Eux ne sont que les innocentes victimes d’un sort funeste.
Vous avez à vous défaire de la part négative de l’interaction ou, dit autrement, à vous défaire de la part négative du connard. Vous avez à prendre conscience qu’il se prend lui-même dans le piège de sa connerie. En gros, il faut éviter d’imiter le con. C’est un jeu trop dangereux. Vous devez refuser le phénomène d’hypnose qu’il crée par sa connerie.
L’auteur le dit clairement : « c’est toujours le con qui est à l’origine de sa connerie » (p51). Et j’ajoute, si vous êtes le témoin d’un jeu de cons, prenez garde à ne pas faire le troisième de la partie.
« Votre attention doit se limiter exclusivement à la situation qui vous concerne, afin d’identifier votre marge de manœuvre et de choisir les stratégies les plus efficaces (p52). L’objectif se limite à l’empêcher de nuire, à le faire sortir de votre vie (p53). Autant que possible !
Indiscutablement, l’auteur sait de quoi il parle !
Il ajoute : « Ne soyez pas brutaux, ni aveugles, ni précipités » (p53)
Rechutes dans l’émotion
« Plus l’émotion est vive, plus l’obscurité autour d’elle est profonde’ (p59)
Il s’agit d’évacuer l’émotion. Il n’y a rien de plus stupide que de cultiver les émotions désagréables, surtout avant de dormir (expérience personnelle).
Comment l’impuissance engendre le devoir
Il y a des cons semblables simultanément à des éléphants et à des verres en cristal. On sait dès le départ qu’il faut les ménager : on esquive le conflit presque à chaque phrase, à chaque regard ; d’une rencontre à l’autre, le jonglage se poursuit. C’est ce à quoi on reconnait les cons : ils rendent les accidents inévitables (p68)
Ne vous avisez pas d’adopter une posture moralisatrice face à un con. Il ne manquera pas de vous faire la morale à son tour.
Vous avez d’autant moins de leçons à donner qu’il est incapable d’en recevoir. Il ne sait pas écouter.
Comment les autorités morales entrent en conflit
Le problème consiste en ceci : « la capacité de recevoir quelque chose de vrai ou de recevable est perdue ». « Les cons ne veulent pas de vous (p87). Non seulement, ils n’ont pas de respect pour vous, mais surtout, ils ne souhaitent pas tenir compte de votre existence. Ils ne vous considèrent pas.
Comment écouter un con ?
Les cons adorent culpabiliser les autres (p96). Préférez les récits. Encouragez leur narration.
Soit dit en passant, l’aptitude aux récits est un bon marqueur de connerie. Il y a des cons qui ne se lassent pas de vous infliger les mêmes souvenirs, les mêmes désopilantes anecdotes, les mêmes citations de bons auteurs. Ils ont l’art d’occuper le temps et l’espace de parole comme pour mieux vous empêcher de dire quelque chose qui pourrait les faire sortir de leurs ronronnements.
Pourquoi l’État se fout de nous
En tout ce qu’ils appellent la « politique » ou la « religion », les cons sont tellement convaincus qu’ils en deviennent fébriles. Une nuance, un bémol les font hurler comme si on leur arrachait les ongles.
Or, « c’est par les actes que l’on montre quel citoyen on est, et par les actes encore qu’on montre quel fidèle on est. Une fois que l’on s’installe dans le silence (éloquent) des actes, les invraisemblables conneries que les humains charrient deviennent aussi légères que le roulement d’innocents cumulus dans un beau ciel d’azur » (p106)
Le rapport à la loi renvoie à trois cas de figure.
- Une nouvelle loi serait socialement utile.
- La bonne loi existe. Elle doit être appliquée.
- La loi n’existe pas. Il s’agit de faire vivre une loi implicite.
À ce propos les cons sont loin d’être toujours hors la loi. Ils savent utiliser les failles et les angles morts des lois.
« L’État désigne une forme d’organisation reposant sur des lois écrites, censées encadrer les manières de vivre par un système de normes et d’allocation de ressources. »
Il faut prendre conscience que l’Etat fonctionnera toujours mal car ses lois courent après une réalité changeante et fluctuent selon l’état des rapports de force existants. L’Administration a toujours été et sera toujours aussi conne qu’au temps de Babylone. Une incurie s’ajoute à l’incurie précédente et le tout crée les conditions du vivre ensemble. Les citoyens doivent lutter en permanence pour faire valoir leurs droits. Les fonctionnaires doivent lutter en permanence pour que l’Etat ne les emporte pas dans sa perpétuelle déliquescence. (p114). La révolte politique ne peut pas se contenter d’être la voix d’une émotion. Le défi est de s’articuler « dans un esprit constructif avec de vrais cons, des abrutis réels (p115). Autant que possible, vous avez à valoriser vos adversaires pour aboutir à la meilleure solution possible. Ce n’est pas gagné, même sans brusquer les immobiles, tant ils ont l’expérience rassurante de leur inertie.
Pourquoi la menace est une forme de soumission
Au sein des organisations pyramidales, l’agitation formelle vient au secours de l’immobilisme.
Les cons n’ont pas compris le sens du mot autorité.
Il ne sert à rien de basculer dans le pointillisme juridique, ce que l’on appelait la chicane, spécialité des cons qui se moquent de trouver un compromis intelligent et libérateur.
Les lois ne remplaceront jamais la conscience individuelle et collective du respect de soi et des autres.
« La soumission est une tendance naturelle de l’être humain » (p125). La période Covid l’a démontré avec éclat. Elle reflète le besoin de sécurité qui se fait jour dès la naissance, dans la relation à la mère protectrice.
Comment la morale exécute l’interaction
La morale est la continuation du droit sans lois écrites, sans attribution de récompenses et de punitions.
Les règles – y compris non écrites – donnent le cadre des interactions. Il suffit d’en comprendre l’esprit pour les faire vivre.
Pourquoi les cons préfèrent détruire
« Il est plus simple et plus facile de détruire que de construire, d’agresser que d’apaiser, de foutre en l’air que de comprendre. La destruction est consubstantielle à la connerie. » Cela étant, s’en tenir à l’existant quand les signes de dysfonctionnement se confirment est une forme de connerie symétrique, tout aussi efficace.
Pourquoi les cons gouvernent
Maxime Rovere nous dit sa compassion quand il constate combien nous devons appliquer dans nos professions de décisions absurdes, déployer des activités contre-productives, en nous conformant à des règles de jeu imbéciles. Il s’interroge sur la fatalité avec laquelle le pouvoir de gérer est donné « au pire des pervers ou des benêts, à la plus fieffée connasse. et l’horreur personnelle d’avoir à y participer » (p 158). Il nous livre une parole de consolation : « Comment se distingueraient les bons si nous supprimions les médiocres ? ».
Pourquoi les cons se multiplient
Plus la connerie se propage aisément, plus les cons se multiplient. De ce point de vue, le numérique est une arme fatale, même quand elle est utile, parce que, souvent, elle se révèle utile.
« Du point de vue des groupes, nous assistons aujourd’hui à un gigantesque brassage normatif : des manières différentes de parler, de se vêtir, de rire, de marcher, d’interpréter les événements, de se représenter le temps, l’espace, le moi, le toi, le nous… Le cosmopolitisme contribue à effriter les codes sociaux en micro-communautés et les cons forment un sous-ensemble (bruyant) à l’intérieur de chacune d’elles. (p174)
Pourquoi les cons gagnent toujours
Plus l’âge avance et plus les illusions sur le genre humain se dissipent. La connerie est, à l’évidence, le résultat d’une adaptation à un environnement de moins en moins compatible – paradoxe des avancées et des révolutions technologiques – avec une vie simplement épicurienne.
Il ne sert à rien d’en vouloir aux cons. Selon les points de vue, ils ont réussi ou raté les adaptations requises.
Vivre, tant bien que mal, et laisser vivre, telle était déjà la philosophie stoïcienne véhiculée par les Alcooliques anonymes. « Plus de soupirs ni de regrets » chante Béatrice dans « Beaucoup de bruit pour rien ».
Faire avec ceux qui se rallient à l’idée de construire un avenir incertain, à élaborer un bonheur relatif. Se rapprocher de ceux qui, discrètement, résistent et se risquent à aimer. Laissez le réel faire son œuvre et faire place à plus de discernement. Préserver sa bienveillance, même si elle peut prendre, parfois, l’apparence du mépris.