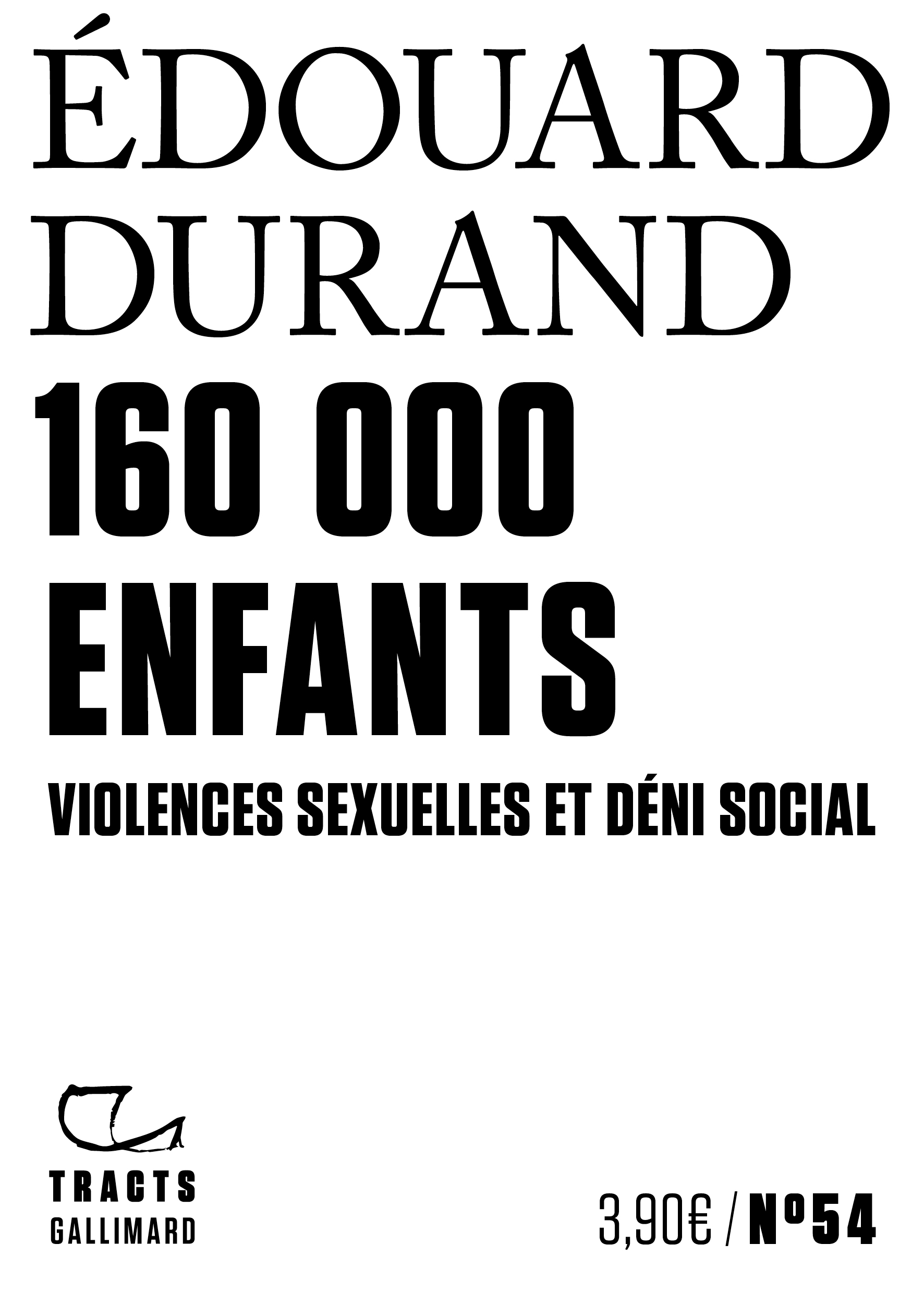Maurice Berger
Dunod
223 pages - 2023

Maurice Berger a été pédopsychiatre, chef de service, au CHU de Saint-Etienne et professeur de psychopathologie de l’enfant à Lyon 2. Il est co-organisateur du diplôme universitaire d’expertise légale en pédopsychiatrie et en psychologie clinique de l’enfant. Il est connu internationalement pour ses travaux sur la protection de l’enfance. Son style est clair, pédagogique, accessible à tout lecteur.
I - Modalités de garde et besoins de l’enfant
« Un adulte sait, à peu près, et encore, avec quel genre d’homme ou de femme il se met en couple. Mais ce qu’il ignore, c’est avec quel futur père ou future mère il a conçu un enfant. Il ne le réalisera qu’au moment où la grossesse débutera ou deviendra visible, ou après la naissance ».
Actuellement, on constate une augmentation des divorces et séparations parentales avec des bébés ou des enfants à peine plus grands ; ou parfois dès la conception. Et ces adultes qui n’ont jamais vécu en couple peuvent exiger un droit d’hébergement.
Dans un hebdomadaire féminin à grand titrage, un article titrait « Mi-pute, mi-soumise » pour indiquer la préférence de certaines femmes à mener une vie amoureuse une semaine sur deux, acceptant d’être « soumise » à la garde de l’enfant, l’autre semaine, profession oblige, cela va de soi.
Les hommes, de leur côté, investissent un peu plus la relation à l’enfant tout petit qu’il soit.
L’auteur critique la loi de 2002 dite loi Ségolène Royal – SOS papa (du nom éponyme de l’association de défense des droits du père. La loi érige en principe la garde alternée entre la mère et le père. L’auteur demande si l’on comptabilise le temps des parents passé auprès de chaque enfant quand les parents vivent ensemble. La loi de mars 2016 insiste pour que soient satisfaits les besoins fondamentaux de l’enfant, au premier rang desquels se situe la sécurité affective. « Ceci passe par le besoin de vivre dans un environnement stable, prévisible, continu, impliquant la permanence des personnes et des lieux » (p17). N’oublions pas que le bébé est physiologiquement un prématuré à la naissance.
De 15 à 40% des situations traitées par le juge des affaires familiales doivent être également traitées par le juge des enfants pour mise en danger des enfants.
Lors des séparations, la conflictualité entre les parents est en hausse. Est souvent retrouvée « une volonté d’emprise sur autrui, tant sur l’ex-partenaire que parfois sur l’enfant et qui risque de se poursuivre à travers des exigences paternelles concernant le mode de garde. » (p19).
N’en déplaisent aux égalitaristes, mères et pères ne se situent pas à l’identique auprès du tout petit. « Les pères sont plus dans des dialogues phasiques, plus brefs, avec des mots plus compliqués. Le père sert à réguler l’agressivité de l’enfant. Il peut sans problème accepter d’occuper temporairement la seconde place auprès du tout petit. Cela étant, si la mère présente des troubles de l’humeur et de la personnalité, spontanés ou induits (Berger introduit ici la toxicomanie), la question de l’hébergement principal devrait être revue.
2 – Le petit enfant et la question de la continuité
Pour les professionnels soucieux des enfants, la garde alternée n’est qu’un des modes de garde non adaptés à la capacité des enfants de supporter la discontinuité du parent et du lieu de référence. C’est également le cas des nuits et des week-ends instaurés précocement ou du saucissonnage du droit de visite ou d’hébergement, selon Berger.
Lorsqu’un enfant dont les grands-parents ont également divorcé (situation non exceptionnelle), la répartition de la garde peut concerner six lieux et six groupes d’adultes pour un enfant !
Les troubles de l’enfant s’atténuent significativement à partir de six ans en moyenne. Jusqu’à trois ans, la vulnérabilité psychoaffective est considérable et elle aura des effets déstructurants.
Les troubles apparaissent en général dès la première nuit chez le père. Sont relevés un sentiment d’insécurité, des angoisses d’abandon, de l’anxiété, un état dépressif avec un regard vide persistant, un état de confusion, une absence de reconnaissance des lieux, de retour chez la mère, des troubles du sommeil, de l’agressivité, en particulier à l’encontre de la mère, le rejet du père, le refus de se soumettre à l’autorité, des troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité, une phobie scolaire.
Ces troubles de l’attachement ont été identifiés depuis 1954, avec les travaux de Bowlby et Robertson.
Il en résulte des recommandations de bon sens, hélas, loin d’être toujours suivies.
Dès sa naissance, un enfant a besoin d’une figure d’attachement sécurisante, c’est-à-dire d’un adulte stable, donc le même, prévisible, accessible, capable d’apaiser ses moments de stress. Pour obtenir cette présence, les enfants sont programmés pour l’exprimer par des pleurs, des cris, de l’agrippement, la poursuite du regard, la poursuite à quatre pattes.
Le non-respect de ces besoins fondamentaux, l’exposition précoce au stress chronique qui en résulte, altère la plasticité cérébrale pendant 70 mois, avec un maximum les 36 premiers mois.
Il en résultera :
- Le risque de désordre de l’attention,
- Un risque accru de troubles anxio-dépressifs,
- Un risque de difficultés interpersonnelles avec des niveaux de motivation bas, tout comme l’estime de soi et la confiance en soi.
L’enfant a besoin de continuité et de temporalité.
La continuité est constituée par la permanence d’une personne et du cadre de vie, à savoir la chambre de l’enfant.
La temporalité concerne la durée d’une présence et d’une absence. Le temps passé en crèche est à prendre en considération, même si l’environnement est en principe adapté. Le temps de crèche doit rester mesuré. Il est atténué par le fait que l’enfant retrouve toujours son cadre de vie (et non deux ou plusieurs).
Trois points sont à considérer : la nuit, la progressivité, la conflictualité.
L’important est le partage de moments dans la journée. Il n’est pas nécessaire qu’un enfant passe des nuits chez son père pour développer une bonne relation avec lui.
La progressivité de l’éloignement de la figure d’attachement est à considérer, en laissant la conflictualité de côté.
La formule du « nid » impliquant la rotation des parents et la fixité du lieu pour l’enfant est plus attrayante intellectuellement que pratique et utile.
Un enfant peut se sentir plus en sécurité au foyer maternel sans que sa relation affective au père s’en trouve affectée.
Au total, on retiendra qu’en ce qui concerne les séparations précoces, il est préférable que la garde soit confiée, sauf raison contraire, à la mère et dans un même lieu, pour éviter des troubles de l’attachement lourds de conséquences.
La nuit est importante pour la qualité du lien d’attachement qui se fait avec une personne et non avec deux. Un père peut développer une relation constructive en journée. C’est qu’il fait avec l’enfant qui compte et non les nuits qu’il passe avec lui. Son rôle peut et doit croître avec le temps.
3 – L’enfant né d’un non-couple et la question de l’appartenance
Je prends ici la place de l’auteur, car je rencontre souvent ce genre de situation, en dépit du fait que je ne sois pas pédopsychiatre.
Un non-couple, chacun comprend ce que cela veut dire : deux personnes se rencontrent, elles n’ont pas de projet de vie commune, elles ne s’aiment pas ; un enfant se fait dans la logique d’une relation sexuelle librement consentie et sans protection particulière, de part et d’autre. Que faire de l’enfant ?
Les cas de figure sont multiples mais ils ont en commun la chosification de l’enfant. L’enfant n’est pas le résultat d’un projet. Il n’est pas le résultat d’un passion amoureuse partagée, comme dans la trilogie de Pagnol. Il arrive et, dès lors, qu’en faire, à qui appartient-il, si, toutefois, la question est légitime ?
J’ai assez souvent rencontré des femmes qui ont souhaité un jour avoir le statut de mère sans se poser la question de savoir si elles pouvaient l’être, sans dommage pour l’enfant à venir. Ces femmes que j’évoque étaient pour le moins instables, profondément déstructurées par leur propre histoire, si bien que la seule chose qu’elles ont su faire dans ce domaine a été de répéter le traumatisme de leur gestation, de leur enfance et de leur adolescence. Elles ont été mères d’enfants encore plus déstructurés qu’elles. Quelquefois, leurs premiers enfants avaient déjà été placés à la DDASS. Il n’empêche, à l’occasion d’une rencontre improbable, elles s’étaient de nouveau mises en tête de mettre au monde un nouvel enfant. Chaque fois que j’en ai eu la possibilité, j’ai essayé de les placer avec tact devant leurs responsabilités, chaque fois, elles ont préféré s’éloigner de la consultation, chaque fois, elles ont donné la vie à un être qu’elles ont rendu psychotique par leur incapacité à assurer une sécurité affective satisfaisante. Leur enfant a pris leur place, sur le mode de la reviviscence traumatique. Des femmes ayant subi, un abandon, se révèlent mères abandonniques.
Berger nous apprend que des médecins ont pu se voir condamnés à une suspension temporaire d’exercice par l’Ordre des médecins pour avoir exprimé des réserves sur des parentalités revendiquées !
Je livre, à présent, un autre cas qui montre que l’enfant né d’un non-couple peut s’inscrire dans une autre logique que celle du trauma.
Une jeune femme africaine arrive en France sans papiers. Elle rencontre via les réseaux sociaux un homme également trentenaire. Quelques relations sexuelles plus tard, elle est enceinte. Elle a menti sur la prise d’un contraceptif. L’enfant est le moyen d’obtenir une stabilisation sociale avec des revenus garantis. L’homme a eu un parcours de vie difficile expliqué par une carence de soins précoces, pour ne pas dire de maltraitance caractérisé, un sentiment d’abandon, des problèmes d’attachement, une addiction à l’alcool. Tout ceci a pu être neutralisé par le biais de l’accompagnement psy-alcoologique.
Il dispose d’un emploi stable bien que modestement rémunéré. Il a appris à se connaître assez pour savoir qu’il n’est pas en situation psychologique de devenir père, particulièrement dans ces conditions.
Il refuse en conséquence de donner suite à cette histoire. Il reste à souhaiter que la mère assure la présence affective dont a besoin cet enfant. Il sera toujours temps pour ce père biologique de savoir dans quelle mesure il peut exister quand l’enfant demandera des comptes. Il a mis fin à sa solitude en acceptant une vie de couple avec une mère …dont la grande fille est logée chez la grand-mère.
À côté des non-couples se retrouvent des couples éphémères, constitués sur des bases incompatibles avec le développement harmonieux de l’enfant. Un Français d’origine épouse une Algérienne, déjà maman de deux filles, d’esprit libéral bien qu’attachée à sa culture d’origine. Passé le temps de la séduction, le conjoint révèle une nature perverse et une volonté d’emprise. Bien qu’un enfant soit né, la situation du couple devient rapidement ingérable. La maman, mère de deux filles d’une première union avec un compatriote, alors qu’elle n’était pas en situation de dire non à ses parents, se retrouve avec un enfant de plus à charge. Ses filles complètent par leur présence son rôle auprès de l’enfant.
Le père demande la garde alternée. Apparemment très attaché à la domination masculine, il épouse en suivant, une seconde femme d’origine magrébine et, pour valider sa préférence culturelle, se convertit, devenant un musulman farouchement acquis aux traditions religieuses les plus strictes. L’enfant se trouve ainsi balloté entre deux types d’éducation : l’un respectueux de son évolution, l’autre, piétiste et directive, nourrie d’une conflictualité entretenue par le père désireux d’assurer sa main mise idéologique sur l’enfant. La maman est alors prise entre trois contraintes culturelles opposées. En effet, psychologue dans un service obstétrical, elle est confrontée à des demandes de paternité émanant de transsexuels. Elle a eu du mal à faire accepter sa démission de son poste en raison de ses convictions. Elle se forme depuis aux thérapies familiales.
Berger ne laisse aucun doute subsister sur les conséquences de violences conjugales : un mauvais conjoint ne peut être un bon père dans la mesure où les violences conjugales sont mémorisées par le petit enfant. Il termine ce chapitre en soulignant les conséquences d’une expertise mal faite dans une situation de violence conjugale.
4 – Un combat qui n’aura pas de fin
Le résultat de la loi de 2002 a déterminé une majoration des troubles de l’humeur de l’enfant en raison des carences en termes d’attachement. En 2014 une enquête du REPPEA regroupant plus de 200 professionnel de l’enfance a établi les faits sans discussion possible. Cependant, les tenants de la résidence alternée à tout prix ont poursuivi leur politique de pression, via un organisme international dont la branche française se nomme CIRA. Cette association mène une campagne médiatique importante pour imposer son idée. Elle passe, comme beaucoup d’autres mouvements de ce type, par les institutions européennes. Le paradoxe est que moins de 10% des pères et des mères réclament la résidence alternée alors que ce groupe de pression présente la résidence alternée comme une volonté très majoritaire. Ce procédé se retrouve pour tous les mouvements minoritaires ou même anecdotiques qui entendent imposer leur exigence particulière à l’ensemble de la population.
5 – Des études auprès des plus petits
Des études ont pu être menées avec la plus grande rigueur sans que la situation change. Beaucoup de pédopsychiatres constatent que les enfants présentant une hyperactivité avec troubles déficitaires de l’attention sont beaucoup plus nombreux qu’il y a vingt ou trente ans. Même si la garde alternée ne fait qu’aggraver la fragilité émotionnelle et mentale des dernières générations, en tant que facteur ajouté, il semble évident que les troubles relevés se retrouvent dans toute ambiance traumatique, molle ou dure, y compris à structure familiale maintenue.
6– Et les plus grands ?
Une vignettes clinique : Deux parents divorcent sans conflictualité. Ils habitent tout près l’un de l’autre. Leur fils âgé de 13 ans est satisfait dans un premier temps de vivre en résidence alternée, avec la possibilité de passer dans la journée chez le parent chez lequel il n’est pas hébergé. Au bout de quelques mois il demande d’aller vivre en internat. Il ne supporte plus cette alternance.
Les troubles suivants ont été relevés de façon significative dans une étude établissant un suivi de 10 ans pour trente enfants (E. Izard) :
- une souffrance dépressive avec sentiment très fort de solitude.
- une angoisse de perte des personnes et des lieux majorée lors des départ avec rite obsessionnel de vérification.
- le sentiment d’être nié par ses émotions par les parents.
- une sensation de clivage.
II – Le refus d’un contact de la part d’un enfant
L’auteur incite à prendre l’attitude de l’enfant au sérieux en se donnant la peine de la comprendre, ce qui demande du temps et des compétences, car les cas de figures sont divers et variés. Le dialogue et l’évaluation sont d’autant plus faciles que l’enfant est grand mais les dommages à prévenir exigent de prendre rapidement position quand ce type d’alerte se manifeste.
Maurice Berger raconte l’histoire édifiante d’un concept très dangereux, émanant d’un nommé Richard Gardner, le SAP ou « syndrome d’aliénation parentale ». Ce psychiatre nord-américain proposait ce diagnostic quand un enfant exprimait des réticences à se rendre chez son père. Il estimait que l’enfant était manipulé par la mère dans 90% des divorces conflictuels et qu’il ne fallait pas tenir compte des déclarations d’agressions sexuelles de l’enfant. La rigueur intellectuelle de Gardner aurait pu être mise en question par sa position favorable…à la pédophilie. Gardner se suicida à coups de couteau, à la japonaise en 2003. Il n’en reste pas moins qu’il reste encore cité dans diverses réunions ou journaux.
Cela me rappelle un philosophe toujours de ce monde qui donnait des leçons de vie édifiantes alors que ses pratiques sexuelles privées étaient des plus problématiques.
La théorie du fantasme, proposée par Arthur Green, ou encore les « faux souvenirs » ont également eu des impacts négatifs concernant les abus sexuels. Les enfants sont alors soupçonnés de projeter sur le père ou une figure d’autorité masculine leurs propres désirs incestueux (cf le film La Chasse). Berger invite encore une fois à distinguer par une expertise rigoureuse entre faits, rumeurs et opinions.
En cas de refus prolongé et total, l’analyse des raisons données par l’enfant (p 142) montre que sa position s’explique par ce qu’il a pu vivre avant la séparation : parent maltraitant ou violent, gravement négligeant, alcoolique, souffrant de troubles graves de la personnalité manipulateur ou déconnecté du réel.
Berger insiste également sur la complexité des conflits de loyauté et la banalité des emprises. Il indique la fréquence dans les histoires compliquées des personnalités paranoïaques et des pervers narcissiques.
Conclusion
Nous avons choisi de présenter le combat de ce pédopsychiatre et de ses collègues contre l’air du temps égalitariste, pour une fois, en faveur des pères. Du point de vue de l’enfant, éclairage rarement pris en compte par notre modernité tardive, il est indispensable que l’enfant ait une figure d’attachement fiable et sécurisante dans les premieres années de la vie, à savoir au minimum 6 ans. La garde alternée systématique est, de son point de vue, une mauvaise décision pour le devenir de l’enfant. Un argument à prendre en compte : un mari violent ne sera pas un bon père pour l’enfant. Dans ces temps d’accélération, l’espérance de vie des couples s’est singulièrement raccourcie et si l’on prend en compte le temps conflictuel qui précède la rupture et les absences professionnelles de la figure d’attachement, nous pouvons comprendre pourquoi autant de jeunes et moins jeunes d’aujourd’hui présentent des troubles de l’attention et d’instabilité et basculent dans les troubles de l’humeur et les addictions.
La seule réserve soulignée par l’auteur est l’état mental et le statut addictif de la mère. Il met en avant, pour elle, les dépressions, les troubles de l’humeur caractérisés et la toxicomanie. Il oublie curieusement l’alcool, alors qu’il est bien connu que la maman du matin n’est pas celle du soir, en cas de dépendance alcoolique installée. Il démontre, sans l’ombre d’un doute, qu’en cas de mère suffisamment bonne, selon le mot de Winnicott, non cité, que le père peut exister par une présence ponctuelle intelligente et bienveillante, en laissant la garde à la mère. Le père existera autrement et de plus en plus, s’il le souhaite et s’il en est capable, par la suite.
Dans la seconde partie du livre, l’auteur souligne la complexité des situations de conflit et d’accusations, avec l’acharnement habituel à poursuivre l’affrontement en prenant l’enfant comme argument.
Il montre que la plupart des plaintes pour abus sur enfants sont justifiées, ce qui est une incitation à prendre le temps d’une expertise rigoureuse par un pédopsychiatre compétent, avant tout jugement concernant la garde.
La conclusion de la conclusion est de pointer la toxicité du néolibéralisme en matière du devenir de l’enfant. Séparer tôt la mère de son enfant pour des raisons professionnelles et financières est un acte grave pour le devenir de l’enfant. Les Droits de l’enfant devraient être pris en compte au même titre que les droits de la mère. Le temps du père viendra plus tard et autrement. Plus généralement, les adultes devraient avoir conscience de ce qu’implique le fait de décider de faire des enfants. Une grande partie de l’avenir de chaque être humain se joue dans les premières années de vie. Tous les manuels de développement personnel ne pourront rien devant cette réalité.