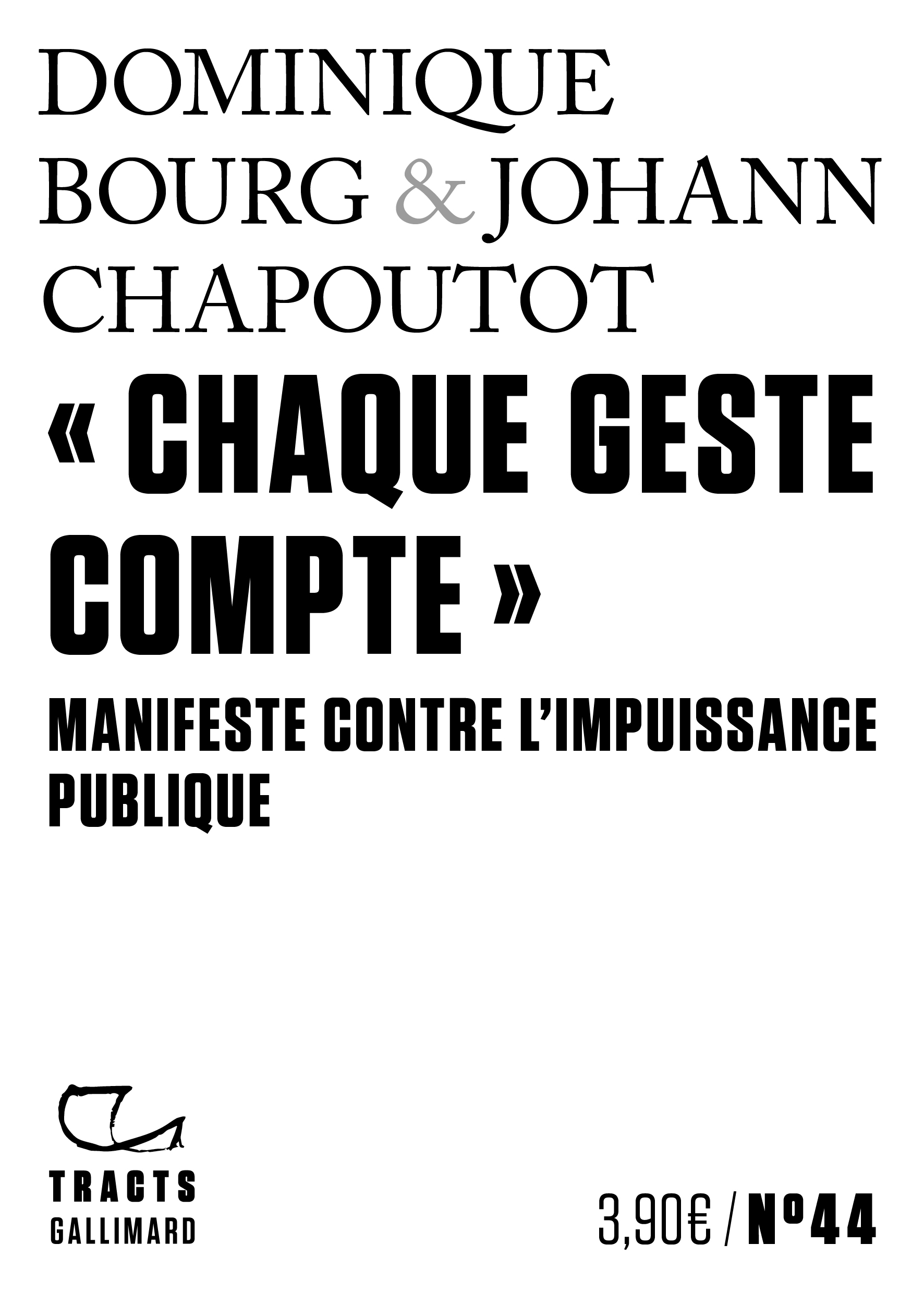L’économie de la décroissance
Timothée Parrique
Seuil
2022
20€ - 312 pages
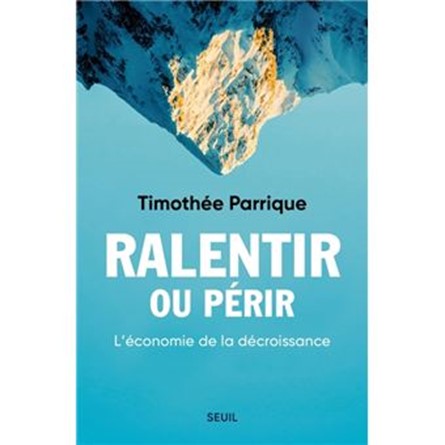
Timothée Parrique est chercheur en économie écologique au sein d’une université suédoise. Pour lui, la croissance économique fait problème.
Dans son introduction, l’auteur nous dispense de l’habituel inventaire des catastrophes écologiques et de leurs conséquences, des chiffres alarmants et des histoires chocs.
Pour lui, il ne fait pas l’ombre d’un doute que nous sommes progressivement entrés, avec l’industrialisation massive de la Modernité et les progrès des technologies, dans l’Anthropocène, c’est-à-dire dans une période où les activités humaines induisent des changements climatiques qui menacent de plus en plus la vie sur la planète Terre.
Le fait que les 10% des pays les plus riches à l’échelle de la planète soient responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre n’est pas rassurant. Cette minorité pollue 4 fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Il n’est pas extravagant de comprendre que les plus défavorisés aspirent à un meilleur niveau de vie. S’ils pouvaient consommer plus, ils le feraient. Et qui peut leur jeter la pierre ?
Tarrique estime que « la cause première du déraillement écologique n’est pas l’humanité dans son ensemble mais le système capitaliste, avec l’hégémonie de l’économie et de la finance pour la poursuite effrénée de la croissance. » Tout de même, la densité humaine intervient aussi !
Historiquement, l’impératif de croissance a pris son origine aux USA, après la « grande dépression » de 1929. La relance par la consommation a été le moyen de solutionner le chômage et la pauvreté. Elle s’est prolongée dans l’effort de guerre.
« Devons-nous laisser les marchés décider de ce qu’il faut produire ? » (p15), telle est la question, sans réponse concrète d’envergure.
L’objet de l’ouvrage est de « comprendre en quoi le modèle économique de la croissance » capitaliste est une impasse, de « dessiner les contours d’une économie » centrée sur l’utilité sociale et la prise en compte de l’écologie. L’auteur défend la notion de capitalocène qui englobe l’économie néolibérale, l’économie du capitalisme chinois et celle de l’économie soviétique qui n’a été qu’une économie de rattrapage, aussi centralisée que celle du modèle chinois actuel. Le système a été qualifié de mégamachine par Fabian Scheidler.
Au fond, la question de l’écologie tourne autour de la question de l’utilité sociale, associée désormais aux impératifs écologiques.
Si nous prenons l’exemple de l’alcoologie, l’utilité sociale nous aide à repenser une offre de soin qui tienne compte du facteur écologique.
L’offre d’accompagnement doit être rapprochée des utilisateurs potentiels de façon à en créer les conditions. Nous comprenons sans peine que ce n’est pas la durée des séjours et la lourdeur des ordonnances médicamenteuses qui font la différence. Ce qui compte, c’est le temps donné, le contenu et la forme du soin. Notre approche intégrative répond aux préoccupations d’efficience. Nous devrions être en situation de soigner plus et mieux, en adaptant l’offre à chaque situation. Parallèlement, l’éducation et une contrepublicité pourraient avoir des effets positifs, parallèlement au souci d’améliorer les conditions de vie.
Ceci entre en contradiction avec les intérêts capitalistes et les habitudes de consommation que le système développe directement, notamment par les représentations dominantes et la publicité, et indirectement, par les souffrances qu’il induit au travail et par la dislocation des liens de solidarité familiale et sociale, par la disparition des croyances spirituelles qui aident à modérer les appétits de consommation. Après moi, le Déluge ?
Nous sommes d’accord avec l’auteur : ce sont les populations favorisées qui consomment le plus d’énergie avec un égoïsme assumé. Un autiste richissime, au cerveau embrouillé par la science-fiction et un égo pathologique, peut imaginer abandonner la Terre pour des planètes où la vie est impossible. Nul ne peut nier qu’il n’a pas imaginable de revenir à des situations d’inconfort pour les populations des pays développés et de ne pas améliorer les conditions de vie des autres, de les contraindre d’endurer stoïquement, par exemple, le froid ou des températures caniculaires.
Les habitudes exacerbées par la croissance elle-même conditionnée par la logique du profit doivent raisonnablement être remises en cause. L’évolution induite par le numérique – et son coût énergétique – doit être combattue ou du moins contrôlée, à l’échelle individuelle et collective. Le « tout numérique » est synonyme de mort sociale. La pratique des achats sur Amazon et des déplacements en tous sens sur la planète, la virtualisation des relations humaines doivent devenir une question politique, tout comme les priorités en matière de dépense d’énergie, sur une base documentée. À quoi sert d’être vivant si on est mort cérébralement ? …si l’autre et soi-même se réduisent à des corps consommant et consommables ?
La technologie crée désormais probablement plus de problèmes qu’elle apporte de solutions. Le nucléaire décrié avec force par des groupes écologiques est aujourd’hui porté aux nues. Il en a été de même pour les éoliennes ou l’énergie solaire. Certains bons esprits passent du temps à trier leurs déchets, faute d’avoir la capacité de faire supprimer les emballages de plastique. Les mêmes ou d’autres acceptent sans broncher le remplacement des arbres de la végétation urbaine par des masses de béton. Ne pas respecter la nature finit par se retourner contre ceux qui la pillent et la détruisent. La politique ne peut être remplacée par l’idéologie véhiculée par les groupes dominant la planète mais également par les différents aveuglements partisans, qu’ils s’habillent en intérêts nationaux ou justifient des colonisations au nom d’arguments religieux.
L’écologie exige des approches scientifiques mais également des décisions éthiques qui associent une philosophie critique et une spiritualité ancrée sur le souci de l’autre et de la nature. Le problème est que la politique a régressé en communication au service des intérêts dominants.