Camille Dejardin
Tracts Gallimard
3€90 / n°42 / 51 pages
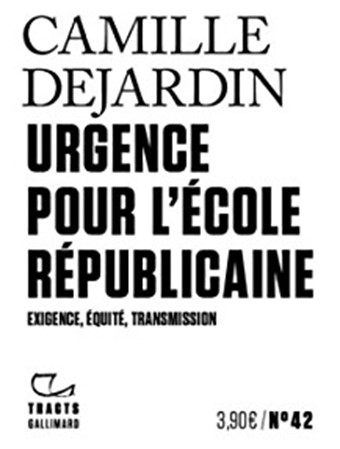
Camille Dejardin est docteur en sciences politiques et professeur agrégé de philosophie. Elle a récemment publié chez Gallimard.
Voici ce qu’elle nous dit : « Chaque année, plus de 90% de nos lycéens décrochent le Bac. Pourtant, près de 60% des inscrits à l’université échouent à terminer une licence. Notre système scolaire, inefficace et pourvoyeur d’illusions, est contre-productif à l’égard de ses fins essentielles en démocratie : former l’individu autonome et le citoyen éclairé. Comment accepter que douze à quinze ans d’« éducation nationale » maintiennent nos jeunes dans l’ignorance et les mènent à l’échec ou au ressentiment ? » Premier commentaire : L’objectif de constituer des citoyens éclairés est-il d’actualité ? Le but réel de l’Education nationale n’est-il pas de produire une masse « d’abrutis » - excusez la violence du mot – dépourvus de sens critique et d’éthique ? La masse n’est-elle pas vouée à gober ce qui lui est proposé sur le marché pour en faire des consommateurs manipulables ? Comment ne pas comprendre que, pour les élites dirigeantes, la démocratie a vécu ? Leurs enfants bénéficient de circuits qui, tôt ou tard, à l’exception d’un résidu négligeable, les amèneront aux postes de commande, aux fonctions bien rémunérées, aux plaisirs « classants » qui en résultent, quoiqu’il en coûte au plus grand nombre et à la Société tout entière.
L’auteur nous apprend qu’il existe une Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) et un Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Au terme de la scolarité primaire, 60% ne maîtrisent pas correctement la lecture, 20% sont en situation d’illettrisme de fait, à 15 ans. Lorsqu’on évalue l’aptitude des élèves à donner du sens à ce qu’ils lisent et a fortiori à ce qu’ils écrivent, l’effroi saisit. Ce qui est essentiellement en péril, c’est « la capacité de former puis de formuler ses idées : ce que les Grecs appelaient le logos », cet ensemble d’outils du langage nécessaire au raisonnement, à l’expression de sa sensibilité et à la compréhension d’autrui. » Il s’agit de dépasser ses ressentis immédiats, de se décentrer de l’ego, de stimuler ses capacités d’imagination et d’empathie. Une hypothèse de l’auteure est que l’on propose un enseignement pour « sous doués », alors que chacun gagnerait à être confronté à un niveau d’exigence plus grand.
Nous retrouvons, plus loin, une idée répandue dans les milieux enseignants : celle des petits effectifs. Il y a quelques générations, une classe comportait 40 élèves et en fin de primaire chacun savait lire, écrire et compter, y compris ceux que l’on destinait au Certificat d’Etudes pour des carrières d’ouvriers et de techniciens.
Il est beaucoup question d’évaluation dans ce tract, au détail que l’ensemble des dispositions ajoutées au fil des réformes a pour principal objectif d’enlever toute signification aux examens du secondaire : le Brevet et au Bac.
Une curiosité de la dernière réforme, celle du Ministre Blanquer : le
« Grand Oral », exercice de rhétorique de 5 minutes où l’élève va disserter d’un sujet qu’il ne connaît pas devant un jury d’ignorants.
L’assurance langagière est une façon comme une autre d’imiter la vraie vie où chacun peut avoir des certitudes sur tout et participer à un dialogue de sourds. En réalité, toute personne qui a pris le temps d’acquérir des connaissances sait combien il est difficile de les transmettre avec clarté et combien il est utile de maîtriser sensiblement la relation pour que les propos soient entendus et compris par les intéressés.
Pour les élèves une course s’engage afin d’être bien placés dans le « Parcours sup », comme si les goûts, les aptitudes et les talents se dégageaient dès la post-adolescence. « À mesure que les diplômes scolaires se dévaluent, les certificats parallèles prolifèrent ». La sélection par les appartenances sociales reprend tous ses droits. C’est un lieu commun de dire que « l’ascenseur social est en dérangement ».
Il serait souhaitable pour l’auteure que « les élèves soient à leur place dans leur classe ». Reste qu’un enfant de 11 ans a sans doute du mal à cohabiter, sans dommage, avec un élève de 15 ou 16 ans.
Il n’est pas question dans cet opuscule des violences, de tout ordre, sur les plus faibles et pas davantage des effets de la culture addictive, transgressive, et festive pour l’alcool.
Il est fait mention, en revanche, d’une « désintoxication numérique ». « Le ravage cognitif, affectif et social de (l’emprise numérique) plaide pour que l’école en soit protégée ». À quand l’interdiction des portables dans les transports en commun, au même titre que le tabac ? « Il s’agirait d’endiguer le lavage des cerveaux que les élèves s’infligent à chaque pause intercours où ils replongent dans leurs jeux et réseaux ».
La réhabilitation de 20% des salaires (comme pour d’autres professions d’utilité sociale évidente) n’est qu’un aspect de la question. Les enseignants ne peuvent être abandonnés à la « vindicte des usagers » et au surtravail.
« Entre conscience professionnelle malmenée et conditions de travail éprouvantes, humiliantes, voire clairement risquées, les démissions se multiplient, parfois à la veille de la retraite. » Les ‘‘départs volontaires’’ sans indemnisation sont en progression constante.
Le désarroi de l’auteure est perceptible et suscite une question : à quoi sert de proposer des solutions sur des thèmes maintes fois discutés, quand ce qui crée des problèmes – la société politique qui s’est mise en place – est occulté ?
Je terminerai sur des conclusions que je fais miennes, même si elles sont inégalement abordées par Camille Dejardin.
Chaque parent, quelle que soit son origine et son appartenance sociale, devrait avoir pour obsession d’apprendre à ses enfants à lire, écrire et compter dès l’école primaire. Les parents doivent se battre pour que les classes soient plus homogènes. Accueillir des autistes, des psychotiques et des caractériels dans des classes non spécifiques est un acte de malveillance pour tous les élèves. Ils ont à exiger que les examens sanctionnent le niveau véritable des élèves, sans démagogie, quitte à demander et à obtenir des cours de rattrapage quand leurs enfants connaissent des difficultés.
La loi de neutralité républicaine et vestimentaire devrait s’appliquer sans ménagement dans un objectif de neutralité. La même tenue devrait attester de l’appartenance à un établissement pour effacer les distinctions selon les fortunes et les croyances parentales. L’autorité des enseignants devrait être respectée et protégée par les Directions. Leur recrutement ne saurait souffrir de l’abaissement de niveau lié pour partie aux salaires, aux contenus des programmes, au discrédit en termes d’autorité, et à la dévaluation des notes. Le développement de l’esprit critique devrait devenir une discipline à part entière associant les grilles de lecture historiques, sociologiques, philosophiques et politiques. Des intervenants issus de la société civile devraient pouvoir exprimer leur expérience et permettre des dialogues avec les élèves à chaque étape de leur cursus.
Il va de soi que ce qui se passe à l’école n’est pas séparable ce qui se vit dans la société. Une école de rêve n’est pas imaginable dans une société de cauchemar, laxiste, violente, inculte, matérialiste, à courte vue. Tout commence là, cependant.

