Du corps charnel
Au corps fabriqué
Sylviane Agacinski
Gallimard, Tracts, n°7 2019
3€90, 42 pages
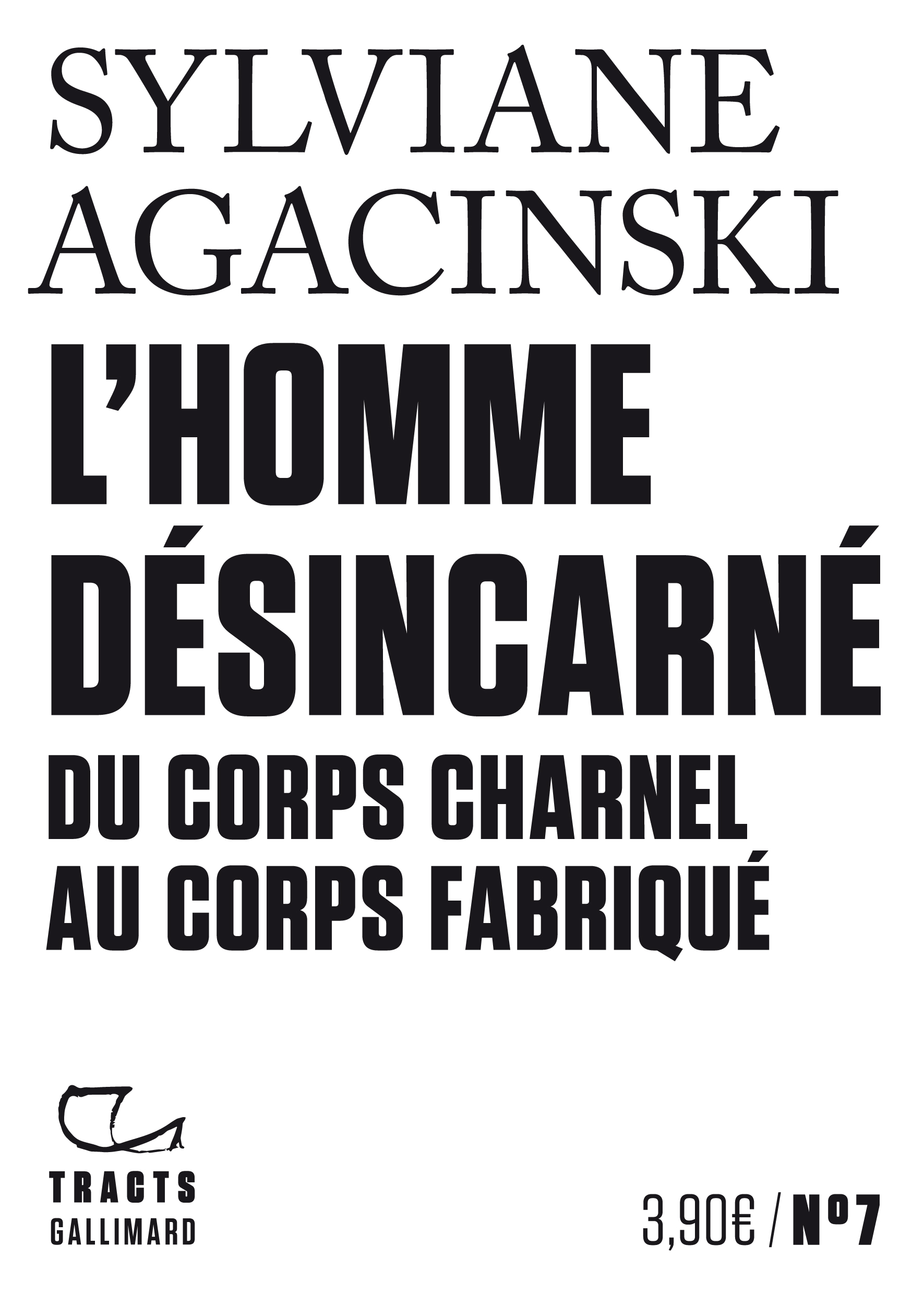
Sylviane Agacinski fait honneur aux intellectuelles françaises par sa lucidité et son courage, à contre-courant des modes idéologiques. Son essai annonce d’emblée ce dont il va être question : l’individu hypermoderne « s’est convaincu qu’il n’était rien d’autre qu’un produit de sa culture et de ses techniques. Il se veut le fabricant de lui-même et de ses descendants ».
L’hubris – la démesure – récuse le bon sens que devraient nous inspirer les lois naturelles. Cet hubris trouve une source dans la croyance que l’homme peut disposer de la nature et en faire ce que bon lui semble, sans se soucier des conséquences. « Les nouveaux croyants entendent échanger leurs vieilles tuniques de peau » contre un corps retravaillé selon leurs goûts : « corps restauré et augmenté, corps fabriqué sans père ni mère ; corps reconstruit et neutre ; corps de moins en moins vulnérable (à voir !) mais de moins en moins vivant ».
Ce type de dérive n’est pas sans fortes similitudes avec la façon dont vit l’homo addictus, avec ses produits, son agir et son fonctionnement mental, sans limites ni éthique.
On attend désormais du médecin – à l’heure des déserts médicaux, de la réduction du budget de la Santé – « qu’il dépasse sa mission thérapeutique pour assurer une fonction anthropotechnique, autrement dit qu’il nous permette non seulement de réparer, mais de refaire, de façonner, de corriger, de rectifier le corps humain, et même » de le créer.
L’auteur réalise un historique argumenté de la procréation artificielle, jusqu’à la mise en place du « baby business ». Le marché mondialisé n’hésite pas à proposer, de ce point de vue, le meilleur rapport « qualité/prix » avec « un diagnostic préimplantatoire légal (permettant le choix du sexe et assurant un enfant en bonne santé), complété par le choix du donneur de gamètes selon le phénotype souhaité (européen, asiatique ou africain).
En contraste absolu : « Paul Ricœur définissait la visée éthique par l’union de trois exigences : le souci de soi, le souci des autres et le souci des institutions justes ». Si l’éthique s’effondre, le Droit peut autoriser le n’importe quoi. Une sorte d’ennui triste saisit le lecteur à l’énoncé des étapes du « droit à l’enfant », qui fait fâcheusement écho au « désir d’enfant » exprimé avec force par des adultes dont les difficultés psychiatriques sont aussi manifestes que leur marginalisation sociale assistée.
Le n’importe quoi est porté à un degré supplémentaire avec le transsexualisme, qui revendique la possibilité de porter atteinte à son corps, par la chirurgie et les injections hormonales, pour le rendre conforme à ses préférences sexuelles. Pourtant, quels que soient les simulacres technologiques et chimiques, un homme reste un homme, une femme, une femme. La génétique et les lois de la reproduction nous rappellent que nous sommes une espèce animale hétérosexuelle, de surcroît mortelle, n’en déplaise aux délirants du transhumanisme. À force de démesure, nous devenons des animaux dénaturés. La perversion devient une façon d’être au monde.
Il semble se creuser un fossé croissant entre les droits à l’enfant et les droits de l’enfant, une confusion entre l’égalité sociale entre les sexes et l’interchangeabilité des sexes. Faute que les droits aient été préservés et mieux encore intégrés par les adultes, parallèlement au nécessaire apprentissage éducatif, de plus en plus d’enfants développent des troubles de la personnalité, des difficultés cognitives, émotionnelles, identitaires et relationnelles. Ils ont manqué de sécurité affective et de repères. Ils basculent avec d’autant plus de facilité dans les addictions et c’est ainsi que la boucle est bouclée.


