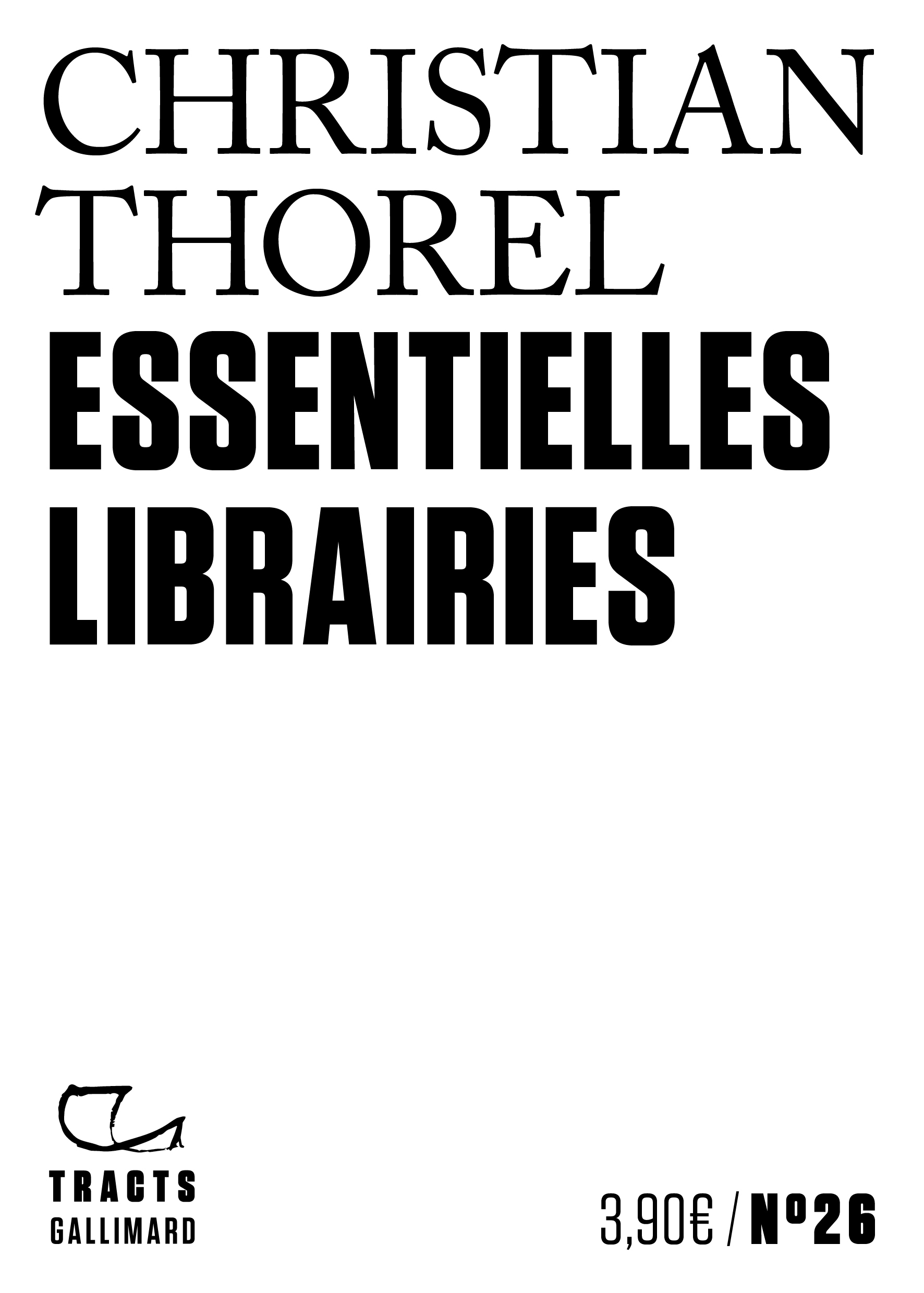La marche en avant De la nation hindoue
Arundhati Roy
Gallimard, Tracts, n°14 2020
3€90, 55 pages
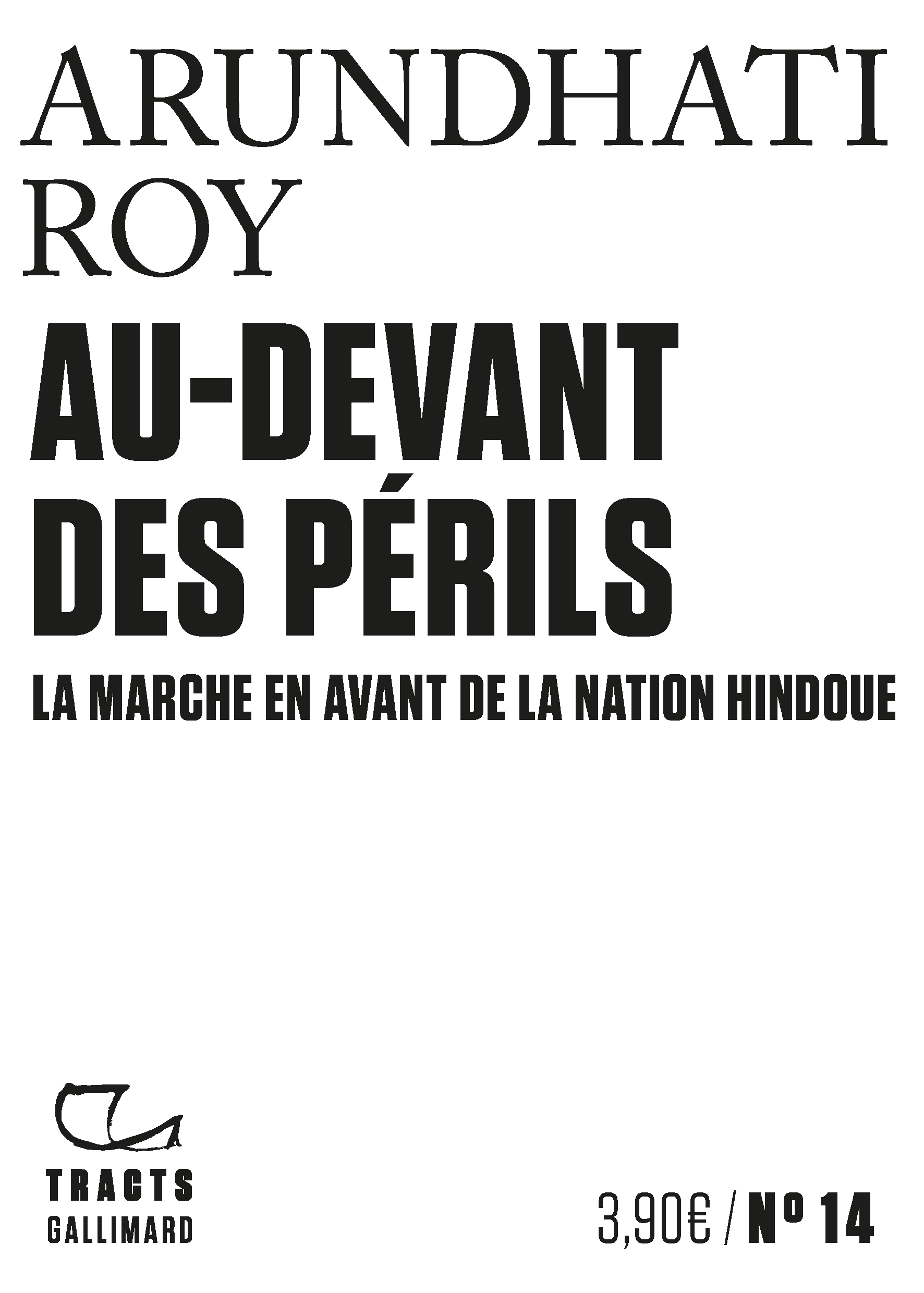
Le continent indien est exemplaire des difficultés que rencontre une planète secouée par la confrontation entre des modes de vie très anciens, des peuples différents et ce que Fabian Scheidler appelle la méga-machine, cet agglomérat financier, économique, étatique, numérique et militaire en compétition pour l’appropriation du monde. On constate sans peine que les différentes religions, loin d’apporter effort de compréhension et paix, sont instrumentalisées pour exacerber une logique de guerre et de tueries.
Arundhati Roy dessine un Apocalypse now en œuvre en Inde, à l’œuvre derrière les images du développement de la cinquième puissance mondiale.
L’auteure – on dit autrice, à présent – justifie d’être présentée, succinctement. Elle est fille d’une chrétienne syriaque et d’un père hindou bengali, séparés quand elle avait deux ans. L’influence chrétienne se retrouve dans sa philosophie de vie en faveur de la justice sociale, de l’universalisme, de l’altermondialisme et de l’écologie. Elle est devenue célèbre par un livre publié en 1996 : Le Dieu des Petits riens.
Cette fiche n’a pas la prétention d’éclairer sur la diversité des mouvements qui transforment le continent Indien. Pour l’auteur : « L’Inde n’est pas, de loin, le pire pays du monde ni le plus dangereux, du moins pas encore, mais le gouffre entre ce qu’elle aurait pu être et ce qu’elle devient en fait le plus tragique ». L’écart croissant entre les possibilités présentée par un continent – ou un pays – et ce qu’il est en passe de devenir sous l’effet des mutations économiques, politiques et climatiques donne le sentiment que la crainte exprimée par madame Roy peut être partagée. L’auteur s’attarde sur l’annexion récente du Cachemire par l’Inde et sur ce qui est advenu en Assam, un petit pays proche du Pakistan oriental, sous l’impulsion des nationalistes indous. Les déplacements de population par l’effet des persécutions religieuses, des oppositions ethniques et des déplacements de travailleurs-esclaves pour la réalisation de grands chantiers ont suscité des violences et des animosités multiples qui promettent de durer.
Le gouvernement hindou a entrepris l’établissement d’un Registre National des Citoyens ou NRC. Ce registre est destiné à faire la distinction entre les citoyens indous et les étrangers. Cet inventaire se révèle impraticable et injuste. Il pénalise particulièrement les populations musulmanes et les villageois pauvres et illettrés confrontés à des contraintes bureaucratiques surréalistes.
Au passage, une fenêtre sur les deux milles « îles mouvantes de Brahmaputra », au sol fertile, pouvant apparaître et disparaître selon les caprices du fleuve, imposant une sorte de nomadisme agricole.
Comme le dit l’auteur : « Une fois allumé le brandon de l’ethno-nationalisme, nul ne peut dire dans quelle direction le vent va relayer le feu ». La loi sur l’amendement de la citoyenneté ou CAA stipule qu’il sera « donné asile en Inde à toute les minorités persécutées non musulmanes, venues du Pakistan, du Bangladesh et de l’Afghanistan », c'est-à-dire indous, bouddhistes, sikhs et chrétiens. La mise en œuvre du NRC et du CAA va créer une banque de données inégalées, autorisant toutes les discriminations. Elle a commencé à justifier la mise en place de tribunaux et de centres de détention pour les « étrangers ». La brutalité du gouvernement hindou pour imposer sa force aussi bien au Cachemire qu’en Assam impressionne. Il lui a suffi de suspendre les connexions numériques et de maîtriser l’information pour œuvrer à sa guise.
Le tableau ainsi dessiné modifie l’image du continent indien tout en nous amenant à nous interroger sur un État dont les lois s’imposeraient à tous les particularisme religieux et ethniques.
Est-il possible d’imaginer un pays où ce qui rassemblera l’emporterait sur ce qui divise ?