L’optimisme de la volonté
Cet éditorial s’inscrit dans la continuité du précédent.
La mise en route du C3A est un processus en cours. Chaque jour ou presque, des mises au point interviennent, des détails sont pris en compte, le cadre se met plus précisément en place.
Pour faire du C3A une réalité, nous faisons collectivement preuve d’un incontestable optimisme. Effectivement, au moment de rédiger ces lignes, de nombreuses inconnues restent encore à clarifier :
− Quelles ressources financières attendre du statut d’association d’intérêt général ?
− Quel sera le degré d’adhésion des anciens et des nouveaux patients à la perspective de devenir concrètement acteurs de leur accompagnement, par l’effet d’une participation financière partiellement déductible ? Il s’agit là d’une décision innovante qui s’inscrit à contre-courant du « tiers payant généralisé » et de la politique des apparences. Autant l’automatisme de la gratuité dégrade la relation de soin, autant notre proposition va dans le sens de la responsabilité et d’un soin ouvert au plus grand nombre.
− Quel sera l’accueil de la Caisse d’Assurance Maladie et des Mutuelles à nos demandes de subvention permettant de couvrir le montant, à vrai dire dérisoire de l’adhésion à l’AREA (250€, la première année, 150 €, les suivantes), pour les patients exemptés d’impôt sur le revenu concernant la part ajoutée pour les patients exemptés d’impôts.
Il est facile de justifier le mot dérisoire, si…
− l’on se réfère au coût de la moindre bouteille de whisky, de la plus insignifiante ordonnance de médicaments psychotropes ou de « substitution », du coût moyen d’une séance de psychothérapie…
− on a en tête le coût d’un séjour en cure ou en postcure, alors que nous savons pertinemment qu’il représente au mieux un temps de récupération, une pause, suivis, la plupart du temps, d’une reprise de la consommation, faute d’un accompagnement de proximité adapté…
− on a conscience qu’en dehors de la consultation du clinicien alcoologue secteur I, elle-même anormalement sous-payée (durée, compétences mobilisées, disponibilité maintenue), la totalité des actes collectifs et individuels ne font l’objet d’aucune couverture sociale.
Cet accompagnement, à ajuster au cas par cas, combine diverses méthodes qui se complètent :
− des techniques et des temps de psychothérapie individuelle tels que les entretiens non directifs ;
− des formes diverses de thérapie brève focalisée, sous réserve de soignants aux savoirs éclectiques, reliés au dispositif ;
− des temps collectifs, tels les groupes de parole, assortis de référentiels précis »)
− les ateliers-cinéma favorisant la pensée associative et la constitution d’un nouvel imaginaire ;
− ou encore des ateliers visant à améliorer la gestion des émotions, l’aptitude à la communication, et,
− d’une façon générale, tout ce qui peut améliorer la relation à soi et aux autres.
Ces temps psychothérapiques sont pourtant le plus souvent indispensables pour induire le passage du « sans alcool » au « hors alcool », réduire la sévérité des « rechutes », conforter la durée et la qualité des « bons résultats ».
Quasiment rien de ce qui pourrait constituer un soin efficace et économique ne bénéficie de la Couverture sociale. Tout ce qui ne sert à rien, sinon à gérer la marginalisation, est ouvert à un financement arbitraire, dispensé de toute évaluation clinique. La mise sous tutelle bureaucratique du soin, renforcée par la dépersonnalisation numérique, aboutit à des aberrations et des gaspillages difficiles à mesurer. Les Administrations Centrales imposent des contraintes auxquelles se conforment les établissements par de beaux organigrammes et « projets de soin », qui ont l’inconvénient d’escamoter la diversité et la complexité des problématiques en jeu, tout en faisant peu de cas des soignants destinés à la mise en œuvre des programmes thérapeutiques. Les décideurs refusent de s’interroger sur la montée croissante des épuisements professionnels chez les praticiens. De même, ils continuent de sous-estimer la gravité − d’un point de vue quantitatif et qualitatif − des addictions avec ou sans produit psycho-actif qui attestent, dès l’adolescence, de la désorganisation mentale, affective, identitaire, et fonctionnelle, opérée par nos sociétés hypermodernes.
Avec le C3A, nous entendons inscrire le soin psychique et addictologique dans la filière de la médecine de ville, généraliste et spécialisée. Nous refusons et refuserons, jusqu’au dernier jour de notre activité, de considérer les patients en souffrance psychique, notamment par le fait de l’addiction alcoolique, comme des sous-malades, et leurs praticiens, comme des sous-médecins.
Quelle sera l’attitude des Pouvoirs publics face à la conception du soin que nous essayons de concrétiser à notre minuscule échelle, par ce que fait vivre le C3A, et les hospitalisations brèves auxquelles il donne sens ?
Ces points d’interrogation justifient le titre de cet éditorial. Nous avons besoin, quotidiennement, de l’optimisme de la volonté, sans négliger la force de la lucidité. Cet optimisme − et l’énergie qui va avec − se nourrit de la certitude que chaque personne rencontrée possède en elle des ressources insoupçonnées, car masquées par le conformisme, la pression sociale et les addictions, conditionnées par des difficultés mentales variables.
Plutôt que s’attarder sur des lamentations aigres-douces, nous préférons faire le choix de la volonté et de l’opiniâtreté, de la créativité et de l’innovation, de l’intelligence et de la culture, de la solidarité et du lien social, et, au final, de la bonne humeur !
Comme dirait le défunt et regretté Desproges : étonnant non ?


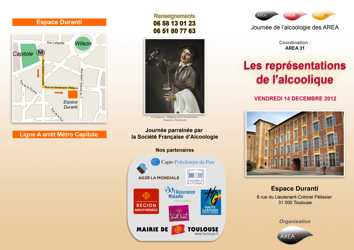

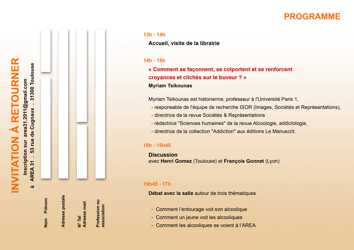
 L’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé) qui s’appelle maintenant ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) n’autorise pas les « praticiens expérimentés dans la prise en charge de l’alcoolo-dépendance » à prescrire le baclofène dans le but de réduire le besoin irrépressible de boire de l’alcool (ou craving). Elle le tolère, sans pour autant préciser qui elle considère comme « praticiens expérimentés » et sans faire mention des conditions de sa prescription ni des conséquences médicolégales pour les dits praticiens en cas de préjudice induit.
L’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé) qui s’appelle maintenant ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) n’autorise pas les « praticiens expérimentés dans la prise en charge de l’alcoolo-dépendance » à prescrire le baclofène dans le but de réduire le besoin irrépressible de boire de l’alcool (ou craving). Elle le tolère, sans pour autant préciser qui elle considère comme « praticiens expérimentés » et sans faire mention des conditions de sa prescription ni des conséquences médicolégales pour les dits praticiens en cas de préjudice induit.