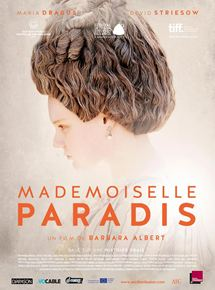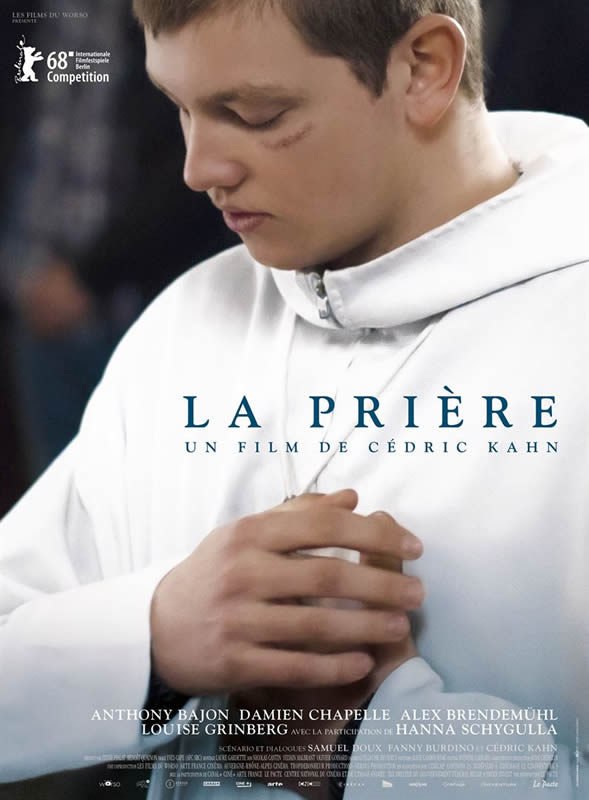Réalisation : Claude Barras
Scénario : Céline Sciamma, d’après « Autobiographie d’une courgette », roman de Gilles Paris
Date : 2016 / Fr-Suisse
Durée : 66mn
Acteurs principaux (voix) :
Gaspard Schlatter : Courgette
Sixtine Murat : Camille
Paulin Jaccoud : Simon
Michel Vuillermoz : Raymond
Paul Ribera : Ahmed
Brigitte Rosset : Tante Ida
Monica Budde : Mme Papineau
Natacha Koutchoumov : La mère de Courgette
A/SA/HA
Mots clés : Alcoolisme – maltraitance – abandon – solidarité - résilience

Commentaire du Dr Henri Gomez
Ma vie de courgette est un film d’animation qui a demandé un travail colossal si on en croit la technique mise en œuvre et les chiffres indiqués. Les statuettes furent filmées image par image et déplacées très légèrement pour donner l’illusion du mouvement. Neuf animateurs spécialisés furent mobilisés sur quinze plateaux de tournage différents. Le coût de la production a largement dépassé les 6 millions d’euros. Le film a reçu de nombreuses récompenses et il a suscité plus de 600000 entrées dans les salles de cinéma en France, les deux premiers mois de sa projection. Le film parle aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Courgette, de son vrai prénom Icare, subit une maltraitance au moins psychologique sous l’emprise d’une mère alcoolique, en conflit avec son amant, qui semble lui préférer la TV. Il vit au milieu des cannettes de bière vides et se relie à un cerf-volant sur lequel il a dessiné la figure de son père disparu, avec une cape de héros. En repoussant la trappe commandant l’accès du grenier où il se réfugie, il provoque la chute mortelle de sa mère dans l’escalier, montant de fait pour lui flanquer une rouste. Il est, peu après, conduit par un policier moustachu, Raymond, dans une maison spécialisée pour enfants maltraités ou abandonnés. Il est accueilli sobrement par la Directrice, Madame Papineau et par une jeune éducatrice. Parmi les enfants, il se heurte à l’hostilité de Simon qui voudrait s’imposer en chef de bande et qui veut savoir pourquoi il a été placé de la sorte…
De la maltraitance à la résilience affective
L’histoire est sans surprise, pédagogique, et en même temps touchante. Les marionnettes ne sont que trop humaines et les effets de reconnaissance ou d’identification en sont poétiquement facilités. Les histoires ne sont que trop vraies, mais il y a place pour d’autres sentiments que la colère ou le désespoir. Les enfants sont capables de résilience. Dans un cadre éducatif souple et contenant, avec les tuteurs de résilience que sont le policier, la Directrice, les éducateurs et même le Juge, ils peuvent évoluer, se confier leurs misères, s’amuser et danser, éprouver des sentiments d’amitié et d’amour. L’évolution parallèle de Raymond, le policier va aboutir à une double adoption, celle de Courgette et de son amie Camille. Raymond, en l’occurrence, a fait l’objet d’au moins un abandon, celui d’un fils parti au loin, sans donner de nouvelles. Cette fin fait penser à celle de Moonrise Kingdom, avec l’adoption du scout fugueur, Sam, par le solitaire et laconique Capitaine Sharp. Dans les deux cas, il s’agit d’une adoption tardive, en connaissance de cause, de part et d’autre. La créativité solidaire des enfants évoque la fratrie de Nanny Mc Phee.
Le message est sévère pour les parents qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. La mère alcoolique n’est pas épargnée.
La signification du film est cependant très positive : le pire n’est pas une fin assurée, même quand l’histoire est très mal engagée.
Question subsidiaire : de nombreux cas de maltraitances ou de carences parentales provoquent quotidiennement des dégâts psychoaffectifs chez les enfants, compromettant leur avenir. Le système de la garde alternée est-il le meilleur quand les parents séparés manifestent des insuffisances éducatives et affectives manifestes ? Les ambiances traumatiques, souvent, ne sont pas assez caractérisées pour justifier un placement dans une structure humainement équipée. De telles structures apportent-elles les garanties nécessaires ? Comment éduquer à la parentalité ? Certaines de ces enfances feront le lit des conduites addictives et de l’alcoolo-dépendance. Et la boucle sera bouclée.
Commentaire de Bénédicte Sellès
L’histoire
Ce film d’animation dépeint la vie d’Icare, un garçon de neuf ans qui préfère se faire appeler « Courgette ». Courgette vit avec sa mère, une femme alcoolique qui le néglige. Sa triste vie bascule lorsque sa mère meurt accidentellement. Raymond, un policier, prend la déposition de l’enfant pour ensuite l’emmener dans un orphelinat. Courgette est intimidé par cette nouvelle situation, il éprouve des difficultés à échanger avec les autres enfants. Jusqu’au jour où une nouvelle enfant arrive à l’orphelinat, Camille, dont Courgette tombe amoureux. Ces enfants qui n’ont plus de parents vont apprendre à se découvrir à travers les liens de solidarité qu’ils créent entre eux et avec les adultes bienveillants de l’orphelinat.
Intérêt en alcoologie
Le film illustre de manière intelligente et sensible le point de vue d’un enfant sur l’alcoolisme parental. La mère de Courgette est négligente, peut-être même maltraitante. Le jeune garçon ressent de l’ambivalence envers la figure maternelle, à la fois aimée et crainte, et s’efforce de conserver un lien fragile en se comportant comme un parent (par exemple en ramassant les canettes de bière qui traînent partout dans la maison). Lorsque la mère meurt, Courgette a du mal à faire son deuil. Il conserve pendant un certain temps les objets qui symbolisaient ses parents : un cerf-volant sur lequel est peinte la représentation d’un père absent, et une canette de bière qui représente la mère de manière éloquente. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il offre à Camille un bateau construit à partir de la canette de bière, qu’il est en mesure de lâcher-prise, de renoncer à entretenir le souvenir d’une mère défaillante afin de s’ouvrir à des relations plus saines et sécurisantes.
Les autres enfants du foyer ont également vécu dans des familles dysfonctionnelles et doivent porter des traumatismes bien lourds pour leur jeune âge, que ce soit parce qu’ils avaient des parents toxicomanes, un parent qui a commis un meurtre, un parent incestueux… Pourtant, les enfants de l’orphelinat ne se laissent pas déterminer par ces ambiances traumatiques lourdes. Au contraire, ils parviennent progressivement à tisser des liens de confiance horizontaux et verticaux. L’amitié et la complicité qu’ils entretiennent entre eux les aide à panser leurs failles psychiques.
Ces enfants peuvent démontrer une maturité remarquable, et Simon est le personnage qui l’illustre le mieux. Simon se présente comme un enfant agressif, impulsif et harceleur. Mais cette agressivité lui sert de masque pour éviter de se confronter à ses affects, et peut-être aussi parce qu’être provocateur est le seul moyen qu’il connaît de se sentir exister aux yeux des autres. Simon démontre de l’ingéniosité en aidant Camille à sortir des griffes d’une tante peu aimante. Il parvient même à renoncer à ses désirs égoïstes en incitant Courgette à se faire adopter, conscient de la chance qu’il a, alors qu’il désirerait éviter la séparation en demeurant auprès de ses amis.
Les adultes de l’orphelinat apparaissent comme des parents « suffisamment bon » et apportent la sécurité affective dont ces enfants ont cruellement manqué dans leur famille d’origine. Le personnage de Raymond en est le plus exemplaire. Ce policier s’attache à Courgette, qui lui rappelle peut-être son propre fils dont il n’a plus de nouvelles. Il se montre compréhensif et attentionné, et par son attitude chaleureuse il permet à l’enfant de regagner confiance en soi et en l’Autre. Il prend en compte les désirs et les besoins du garçon, puisqu’en adoptant Courgette il adopte également Camille afin de ne pas les séparer. Par ailleurs, tout au long du film, Courgette relate son histoire illustrée de dessins qu’il envoie à Raymond. Cet échange offre l’occasion au garçon de se raconter son histoire et de la partager avec une personne significative à ses yeux afin d’élaborer le sens des événements qu’il vit.
Ces enfants délaissés ont l’opportunité de connaître une vie meilleure en grande partie grâce au soutien que leur apportent les adultes de l’orphelinat et Raymond, qui leur font confiance et accordent de la crédibilité à leur parole. Ces adultes les considèrent comme des personnes à part entière en tenant compte de leurs opinions, sans avoir une attitude paternaliste ou infantilisante qui auraient entravé leur épanouissement.