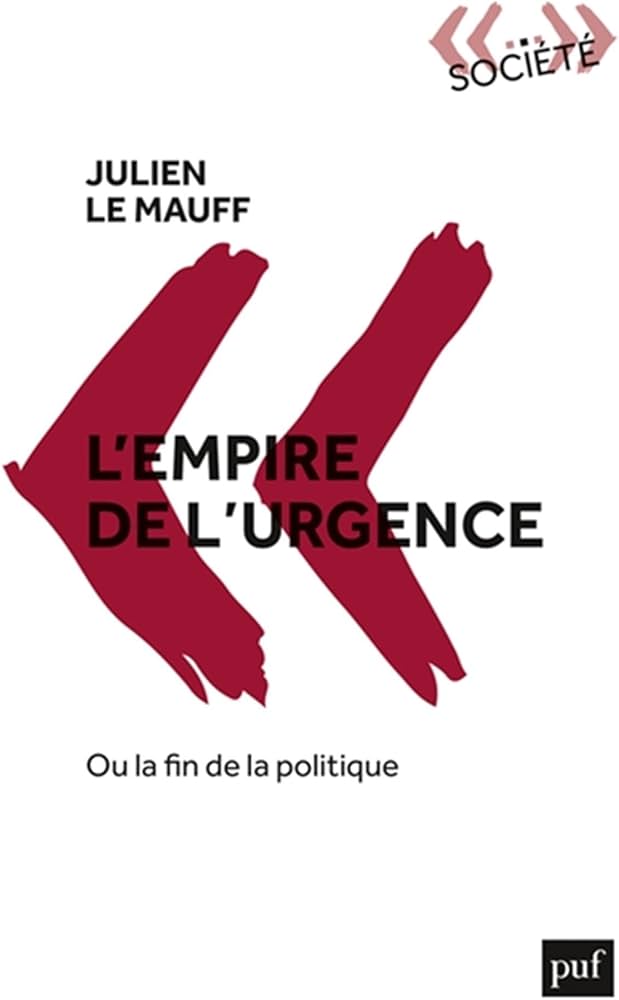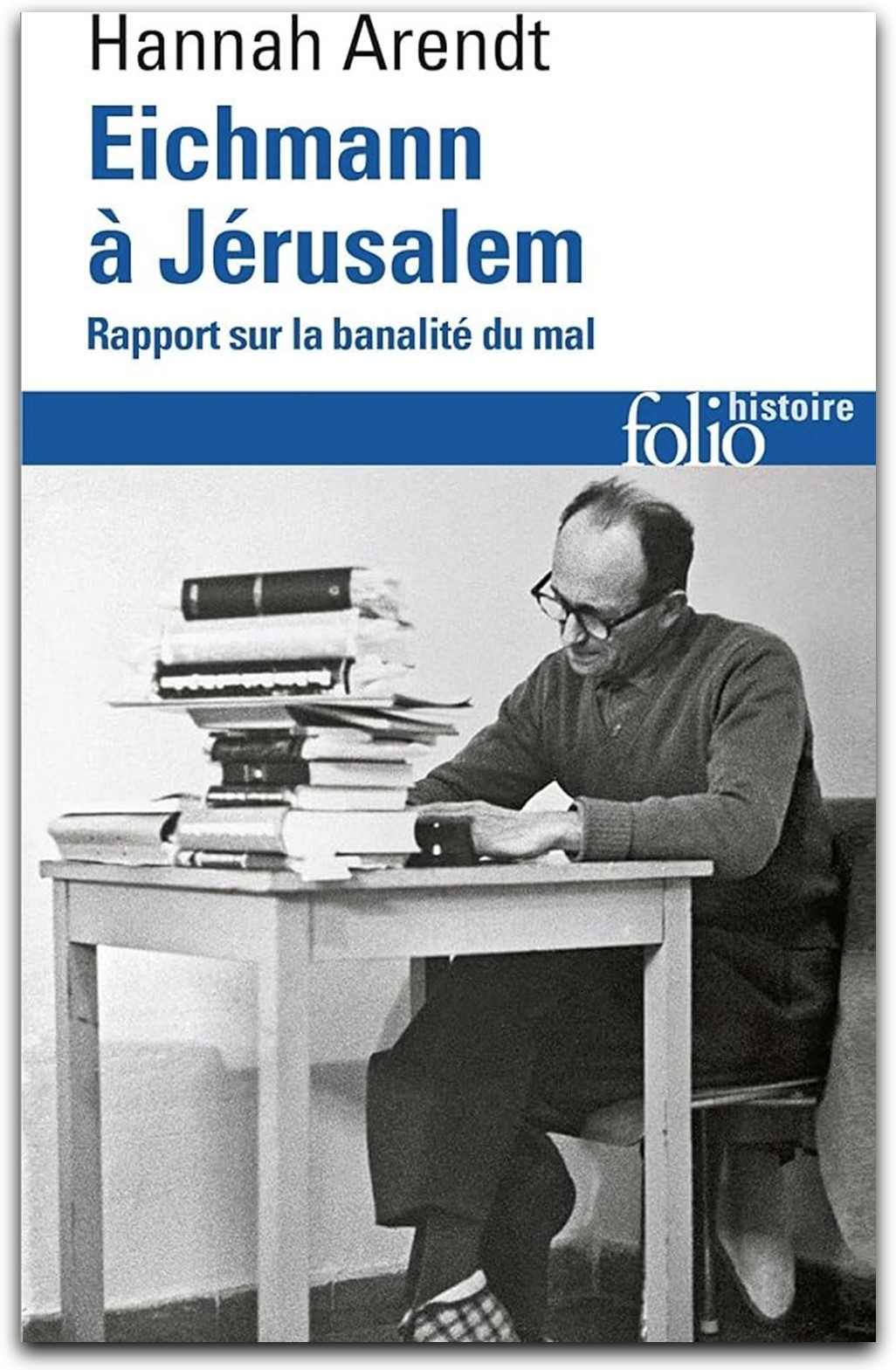Hannah Arendt
Folio Histoire
13€, 519 pages
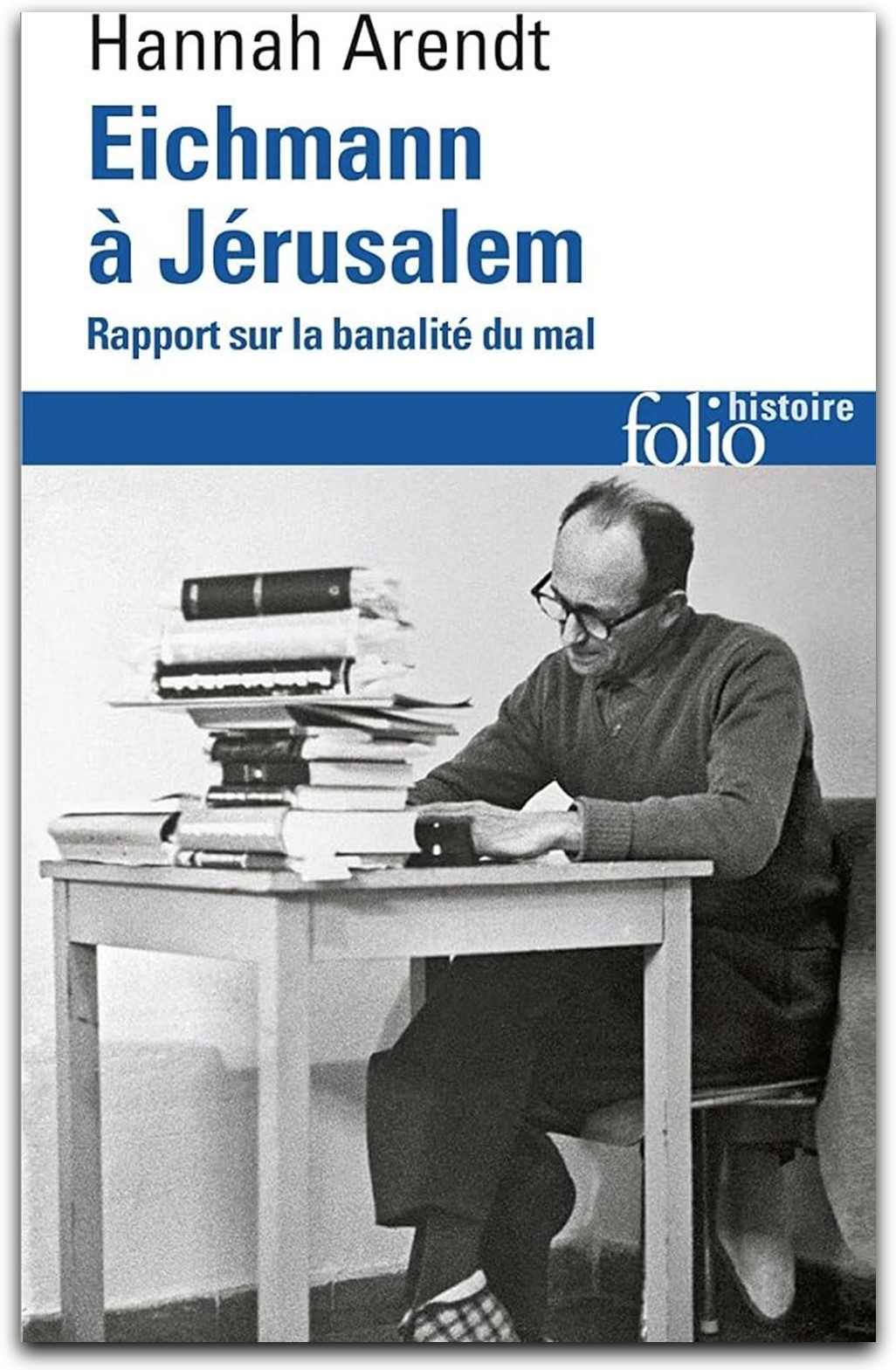
Ce document a fait Histoire à partir d’un procès qui s’est tenu en 1961 à Jérusalem. Il nous importe pour de nombreuses raisons. Nous nous intéressons, évidemment, à Hannah Arendt. Nous savons tous que ce reportage suscita remous et polémiques de par les illusions, les complaisances, les complicités passives et actives que révéla le récit du procès d’Eichmann par Hannah Arendt. Nous ne sommes pas dupes de la théâtralisation du procès et des motivations politiques sous-jacentes à la personnalisation de l’Holocauste. Ce n’est pas cela qui nous intéresse le plus, indépendamment du plaisir de lire le texte, vif et incisif, et contributif de l’auteure. Deux thèmes de réflexion nous préoccupent par analogie : la banalité du mal et la banalisation du mal.
Hannah Arendt nous démontre que le monstre Eichmann était aussi un individu banal, un « sale type » très ordinaire. Il était d’origine bourgeoise mais ses capacités moyennes l’avaient écarté du parcours universitaire dont sa fratrie avait tiré avantage. En cette époque de perturbations politiques, de crise économique et sociale, il avait basculé, sans avoir eu besoin de lire Mein Kampf, vers le parti nazi, la force montante de l’Allemagne, en 1933.
1. L’atelier-cinéma de l’AREA a découvert récemment Hannah Arendt, film centré en partie sur son reportage à Jérusalem pour le New Yorker, un distingué hebdomadaire US)
S’ennuyant comme soldat SS, il avait répondu à l’appel au recrutement du service de Sécurité d’Himmler. Ayant abandonné sa culture catholique familiale, il ne cessa, au cours de son procès, de professer son absence de haine des juifs, ce qui n’est pas sans surprendre. Ses deux grands projets pour la communauté juive, comme responsable nazi, (à la réflexion ridicules) auraient été de concentrer les juifs d’Europe sur l’île de Madagascar et de créer une enclave juive en Pologne, dans la Région de Nisko. Il aurait préféré ces solutions mais, en lieutenant-colonel obéissant, il organisa avec méthode et application les trains vers les camps d’extermination. Son efficacité, son zèle, évidents à la période d’avantguerre où la ligne officielle du Parti était de chasser les juifs d’Allemagne par l’émigration, ne furent pas récompensés. Il traîna avec lui ses frustrations et sa sensation d’être un raté. De ce point de vue, son procès le sortit de sa condition d’individu anonyme, dans laquelle il était tombée comme réfugié en Argentine. Comme le quidam d’une chanson de Guy
Béart, il fut enfin célèbre.
Le cas Eichmann pose de multiples questions dans le cadre de la banalité du mal. Apparemment, la situation faite aux juifs ne l’a jamais troublé. Sans doute, pensait-il qu’ils devaient avoir des torts, que l’on pouvait, non seulement, ne pas les secourir, mais encore les mettre à part, les faire partir de force et, même, si Hitler, Himmler et Heydrich en décidaient ainsi, les supprimer au même titre que les attardés et les malades mentaux. Il évoluait ainsi de l’indifférence passive à l’indifférence active, celle qui aboutit, au final, à supprimer sans état d’âme des innocents de tout âge. C’est le caractère délibéré, organisé méthodiquement et systématiquement qui distingue ce génocide des autres. Avec les guerres, saintes ou pas, nous restons dans les atrocités banales perpétrées par des individus banals. Avec une masse de gens qui laissent faire, en sachant ou en ne sachant pas, nous atteignons un niveau d’inhumanité hors du commun, avec, cependant, des gens ordinaires.
Nous pourrions ranger Eichmann – et tant d’autres avec lui – dans la catégorie des normopathes qui valident les opinions, les consignes et les pratiques admises par la majorité silencieuse ou les minorités bruyantes, spécialement quand les temps sont troublés. Le cas Lacombe Lucien, raconté au cinéma par Louis Malle en fournit un autre exemple.
Reste à considérer la problématique des individus banals en temps de paix. La peur des sanctions ou des représailles n’existe pas alors.
Comment parviennent-ils, sans effort apparent, en dépit de leur intelligence souvent nettement supérieure à celle d’Otto Eichmann, avec le niveau de connaissances dont ils disposent, de leurs pouvoirs, comment font-ils pour donner une telle force au silence, pour laisser se perpétuer un mode d’organisation qu’ils savent, par exemple, inadapté et inefficace, pour rester sourds et aveugles à ce qui pourrait tant soit peu changer le cours absurde et néfaste des choses ?
Un autre question dérivée, qui inclut l’élite dirigeante et les institutions éclairées, les Pouvoirs en général, est de réfléchir, non à l’individu banal dans sa participation au mal, mais dans le phénomène de la banalisation progressive du mal. L’Histoire, encore une fois, nous donne toutes sortes de renseignements pour montrer la progressivité du basculement de l’anodin au presque rien, au préoccupant, jusqu’à la catastrophe qui aboutit, par exemple, à une guerre civile, à un génocide, à une guerre caractérisée, au suicide d’une Nation ou au naufrage d’une civilisation.
La banalisation du mal associe les actions douces, presque anodines, aux actions violentes, l’usage des lois et la transgression des lois. Le mensonge finit par s’imposer comme vérité. Il suffit de crier très fort et de faire taire ceux qui ne partagent pas ses opinions. Il suffit de créer la confusion et la peur. Nous sommes dans une logique orwellienne
d’idéologie totalitaire.2
Le dernier point à clarifier est de définir le Mal. Nous savons que le camp des vainqueurs ou des puissants n’accolera jamais ce terme à leur réussite. Pour des faits analogues, le vainqueur peut être célébré et le vaincu honni, quitte à revisiter l’Histoire. Cependant, même Eichmann se disait – paraît-il – que « cette histoire finirait mal ». Restent à considérer les faits et, de ce point de vue, le procès Eichmann en fournit en surabondance.
1
12 Après la sinistre Nuit de Cristal du 8 et 9 décembre 1938 de destruction et de pillage de magasins et de biens juifs par des hordes émanant des sections d’assaut SS et des jeunesses hitlériennes, en réponse à l’assassinat d’un secrétaire d’ambassade à Paris, Von Rath, par un jeune juif, la peur devient le lot quotidien de la population persécutée, étoilée, déportée.
Hannah Arendt cite Dostoïevski qui racontait, au retour du bagne en Sibérie, qu’il n’avait jamais rencontré d’individu qui admette avoir mal agi, comme si ses crimes faisaient partie de lui-même au point qu’il soit incapable de les distinguer. L’absence de sentiment de culpabilité avait même incité à proposer un « comité de conciliation » composés de massacreurs nazis et de survivants juifs par un certain Robert Ley qui se suicida peu après.
Au déni s’ajoute l’amnésie sélective. Eichmann était nécessairement présent à la conférence de Wannsee où furent discutés les moyens de tuer les juifs.
Eichmann avait la manie des formules chocs qui lui procuraient un sentiment d’euphorie telle que « Je me pendrais avec plaisir en public en guise d’avertissement exemplaire à tous les antisémites » (p125).
L’expulsion hors d’Allemagne.
Dans les premiers temps de leur politique anti-juive (34-36), les nazis furent « pro-sionistes ». Eichmann adhéra à cette orientation. Il mit à disposition quelques fermes destinées à ce que de jeunes juifs, futurs émigrants, apprennent leur futur métier d’agriculteurs. Á l’époque, la Palestine était sous mandat britannique. La majorité des juifs allemands, en particulier ceux qui tentaient d’être assimilés, malgré la politique de persécution qui commençait, ne disposait d’aucun soutien. Les nazis mirent fin à leur politique de coopération, financièrement intéressée dès le début de la guerre. Le désir de fuir l’Allemagne relevait du sauve-qui-peut pour les juifs, depuis la Nuit de Cristal.
La concentration.
Un décret d’Himmler fusionna les SS (dont faisait partie Eichmann) et la Gestapo (police secrète d’État). Son premier chef fut Heydrich, jusqu’à sa mort par attentat, en 1942.
Arendt recommande la lecture d’un livre décrivant clairement la complexité de l’organisation de l’extermination des juifs : « La destruction des Juifs d’Europe » par Raul Hilberg.
L’Histoire montre que le projet de créer une enclave juive en Pologne ou de les déplacer à Madagascar relevait de la manipulation de l’opinion. L’Allemagne ne pouvait concevoir sérieusement d’envoyer 4 millions de juifs à Madagascar par bateau alors que les Britanniques contrôlaient les mers et que l’effort de guerre ne pouvait permettre un début de déplacement de ce type. Notons quand même qu’un Ministre français du nom de Bonnet avait envisagé d’envoyer les juifs d’Europe réfugiés en France dans l’île malgache (300000 personnes) !
L’heure des camps de travail et des camps de concentration était venu. Pour la petite histoire, IG Farben et Siemens s’étaient implantés à Auschwitz. L’idée était de tuer les juifs au travail. Les habitants d’une ville de Moravie, Theresienstadt furent expulsés pour laisser place à des juifs « privilégiés » (des anciens combattants, des juifs d’union mixte, ou des juifs plus âgés ». Eichmann supervisa l’opération. Theresienstadt se révéla un camp de transit vers Auschwitz.
La solution finale : le meurtre de masse
La solution finale fut mise en route de façon massive et systématique, au lendemain de l’attaque contre l’URSS en juin 1941.
Il paraît que des militaires et des gendarmes avaient fini par se plaindre de devoir tuer par balles en série la population juive civile des villages polonais ou de les gazer dans des camions, après leur avoir fait ôter leurs vêtements.
Avec la mise au point des camps, du transit vers les camps, décidée par Hitler, conçue et organisée par Heydrich, le cauchemar allait prendre une dimension industrielle. Nous survolerons ces pages.
Mentionnons tout-de-même le passage d’Eichmann en Hongrie, Himmler ayant préparé efficacement l’action de déportation-élimination. Eichmann trouva un secrétaire d’État à la question juive particulièrement zélé en la personne de Lazlo Endre. « En moins de deux mois, 147 trains transportant 434351 personnes » prirent la direction d’Auschwitz.
Variations des positionnements nationaux et religieux à la politique antijuive des nazis
Arendt balaye les variations des positionnements nationaux et religieux selon les différents pays soumis au pouvoir nazi. Cette suite de chapitres est éclairante, même si elle est incomplète.
« En juin 1942, Eichmann convoqua les conseillers de France, de Hollande et de Belgique, afin d’élaborer des plans de déportation à partir de ces pays. Pour « peigner l’Europe d’Ouest en Est », Himmler avait ordonné que la priorité absolue fût donnée à la France, en partie parce que la nation par excellence avait une importance en soi et, en partie, parce que le gouvernement de Vichy avait montré une « compréhension » véritablement extraordinaire et avait promulgué, de lui-même, un grand nombre de lois antijuives. » Il avait créé un Commissariat aux affaires juives successivement dirigé par deux antisémites notoires : Xavier Valat puis Darquier de Pellepoix. De nombreux juifs de Russie, d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche, de Hongrie et de Roumanie s’étaient réfugiés en France. Le gouvernement décidait de s’occuper d’eux en commençant par les faisant mettre dans les trains à hauteur de 100000, au titre de leur future « réinstallation ». Les SS avaient l’art de la formule, qui dispense du sentiment de culpabilité. Au cours de l’été et de l’automne 1942, 27000 juifs (en majorité parisiens) furent conduits à Auschwitz.
Les histoires atroces ne manquent pas, telle celle de 4000 enfants séparés de leurs parents à Drancy, dans la banlieue parisienne, expédiés dans un second temps en train vers les fours crématoires, sur un ordre d’Eichmann à un nommé Dannecker.
Les Allemands firent alors une erreur, ils crurent pouvoir déporter sans distinction les « apatrides » et les juifs français. Le gouvernement de Vichy s’y opposa, d’autant que les retours d’information sur les « réinstallations » ne laissaient pas de place au doute sur le sort réservé aux passagers des wagons à bestiaux. Les juifs déportés depuis la France sont estimés à 40000 dont 6000 de nationalité française. 250000 juifs étaient restés en France au moment où les alliés débarquèrent en France.
La Belgique fut d’emblée hostile aux « réinstallations ». Les partisans locaux du régime hitlérien étaient négligeables. La police belge ne coopéra pas, contrairement à la police française qui organisa la rafle du Vél’ d’Hiv du 16 et du 17 juillet 1942 pour près de 13000 hommes, femmes et enfants juifs de Paris et sa banlieue. Les Allemands renoncèrent à confier le convoyage aux cheminots belges : les portes des wagons ne fermaient pas,. les embuscades interrompaient la progression des trains.
En Hollande, la situation était différente. La monarchie gouvernante et ses ministres s’étaient réfugiés en Grande-Bretagne. Le pays était à la merci des SS. Cependant, les étudiants se mirent en grève lorsque des professeurs juifs furent renvoyés. Il y eut également des grèves pour s’opposer aux déportations. Cependant, les juifs hollandais avaient montré une distance face à leurs homologues allemands qui arrivaient en masse et le parti nazi local n’était pas anecdotique comme en Belgique. Le résultat est que les 3/4 des juifs résidant en Hollande furent tués dont les 2/3 étaient des hollandais.
L’attitude des pays scandinaves est intéressante à considérer. Le roi du Danemark fut le premier à adopter l’étoile jaune pour s’opposer à la discrimination. Le pays refusa de faire la distinction entre juifs nationaux et juifs réfugiés. En Norvège, le gouvernement pronazi dirigé par un nommé Quisling enregistra des démissions de ministres quand il s’agit de livrer les juifs allemands réfugiés et, dans le même temps, la Suède leur offrit l’asile et la nationalité s’ils la désiraient. La Finlande qui comportait très peu de juifs ne fut pas concernée par les « réinstallations ».
Arendt mentionne le manque de fiabilité des Italiens à l’égard de leurs alliés allemands pour abandonner leurs compatriotes juifs : 90 % des juifs italiens furent épargnés.
Les comportements divergèrent également dans les Balkans. A noter que le métropolite de Sofia (équivalent d’un archevêque dans la religion orthodoxe) cacha le grand rabbin de la capitale bulgare, en précisant que « les hommes n’ont pas le droit de torturer et de persécuter les juifs ». Pas un seul juif bulgare ne fut déporté. Hannah Arendt signale l’attitude d’un communiste bulgare, Giorgi Dimitrov, après le curieux incendie du parlement allemand, en février 1933. Lors du procès, il prit, de fait, la position d’un accusateur face à Goering, permettant la libération de presque tous les accusés.
« Dans les dernières semaines de la guerre, la bureaucratie SS était surtout occupée à fabriquer de faux papiers d’identité et à détruire les montagnes de papier témoignant de six années d’assassinats systématiques ». Le navire faisait eau et les rats se dépêchaient de le quitter.
Que retirer de cet ouvrage qui fourmille d’annotations et de références historiques ? Qu’en déduire pour notre époque ?
Incontestablement, la Solution finale est un modèle inégalé, à ce jour, dans l’histoire des génocides, par son ampleur, par la force donnée aux assassinats de masse en raison d’une bureaucratie cauchemardesque. Hannah Arendt nous dit que lorsque l’Humanité fait l’expérience d’une pratique nouvelle, dans l’ordre de la Barbarie, elle peut plus aisément récidiver.
Récidiver mais pas nécessairement à l’identique. Avec la puissance communicationnelle et inquisitrice du Numérique, les organisations totalitaires disposent, à présent, d’un pouvoir de nuisance infiniment plus développé et efficace que la bureaucratie paperassière des SS.
Ces mêmes nazis ont montré comment par des manifestations de rue orchestrée, il était possible d’obtenir une sorte de soumission générale. Nous voyons encore quotidiennement des personnes qui gardent des masques comme si l’air que nous respirons était envahi de dangereux virus et comme si cette protection était une garantie.
D’autres ont apporté la preuve qu’il pouvait être efficace de dire NON, tel ce roi du Danemark qui décida d’être le premier sujet à porter l’étoile infamante ou encore ces cheminots belges distraits qui ne fermaient pas la porte des wagons, tout en avertissant du passage des trains pour permettre les embuscades. L’archevêque orthodoxe fit honneur à sa religion en rappelant un principe d’égalité et d’ouverture d’esprit qui tranche avec ceux qui ne doutent jamais, parce qu’ils ont la vraie croyance, et qui s’attachent à balayer devant la porte des autres.
Il a été reproché à Arendt son incompréhension à l’encontre de ceux qui adoptèrent un comportement de moutons. Mais que dire des autres qui restent non concernés, silencieux et passifs ?
L’émotion fait la Masse et la Masse est incapable de se conduire autrement qu’aveuglément. Gustave Le Bon en son temps analysa la « psychologie des foules ». Face à un pervers, un esprit simple a du mal. Des pervers collectifs alternent le chaud et le froid, le banal, la séduction, l’intimidation, la violence. Il est des humains qui se transforment en loups, face à ceux qui voudraient les transformer en moutons d’abattoir.
Pour prendre la mesure de ses addictions et des autres problèmes, mieux vaut exercer son esprit critique et faire prévaloir l’éthique qui en résulte, en actes, si possible. Telle sera notre conclusion.