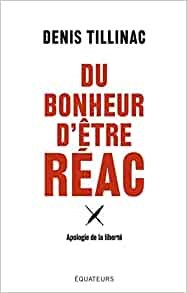Emmanuel Stip
L’Harmattan
2021
316 pages 33€
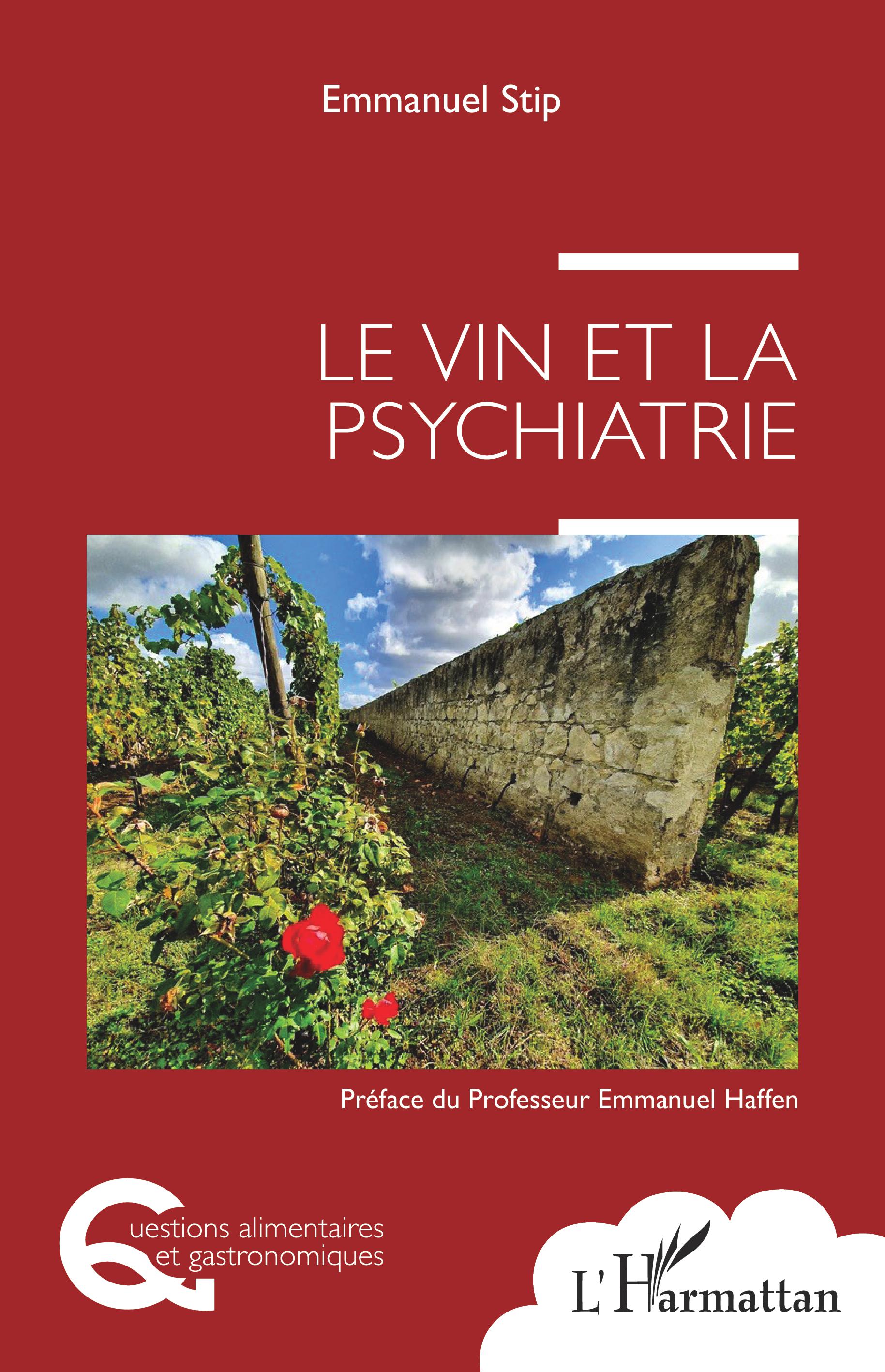
L’ouvrage a été écrit à plusieurs mains. L’auteur principal, Emmanuel Stip a la particularité d’associer deux savoir-faire, celui de psychiatre et de sommelier. La collection s’intitule « Questions alimentaires et gastronomiques ». Le livre, pour l’essentiel, est un ouvrage collectif sur le vin.
Avant d’aller plus loin dans la rédaction de cette fiche, je résume ma dernière consultation : un homme de quarante ans vient me trouver car, de plus en plus habituellement et depuis longtemps, il constate qu’il perd le contrôle de sa consommation de vin ou de bière après le premier verre, même s’il a la ferme intention de se limiter. Il a fréquenté deux écoles d’ingénieur, en France puis en Angleterre où les soirées d’ivresse étaient la règle. Il est allé très tôt plus loin que les autres. Il avait perdu sa mère d’un cancer au moment de la première année de grande école et il lui était très attaché Je lui ai donné rendez-vous à l’automne, dans trois ou quatre mois, pour disposer de recul. J’ai proposé à ce patient qu’il informe son entourage amical de son problème et de sa décision. Les moments de rencontre comme les moments festifs se passeront pour lui de toute prise d’alcool. Il pourra consommer l’équivalent d’un verre de vin pendant les repas gastronomiques. Il a déjà constaté qu’il n’y avait pas de dérapage dans ce cadre.
Goûter un vin n’est pas boire. Je me suis occupé de trois sommeliers devenus alcoolodépendants. Ils ont dû changer de métier. L’un d’eux expliquait sa soif de vin par les astres. Il était, disait-il, né sous une planète sèche.
Revenons à l’ouvrage d’Emmanuel Stip qui regorge de précisions.
La première partie (162 pages) réunit des connaissances scientifiques sur les vins. Elle ne peut manquer d’intéresser les sommeliers et les amateurs de vin.
La seconde partie (p 167 à 227) est moins contributive. Le lecteur gagnera à se rapporter au « Guide de l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool » et aux « Représentations de l’alcoolique ».
La troisième partie, intitulée un savoir expérientiel, est l’œuvre d’un sommelier « scientifique ».
C’est un livre que l’on a envie d’offrir à Pierre Arditi.