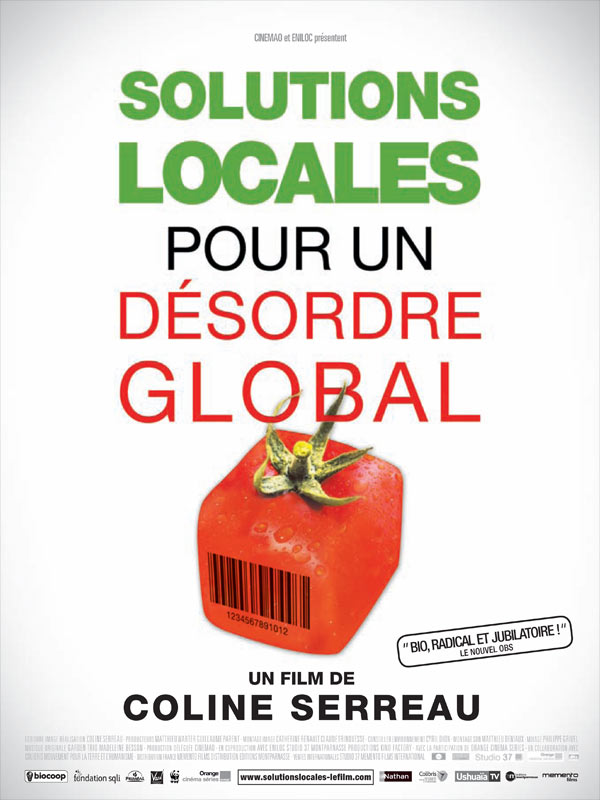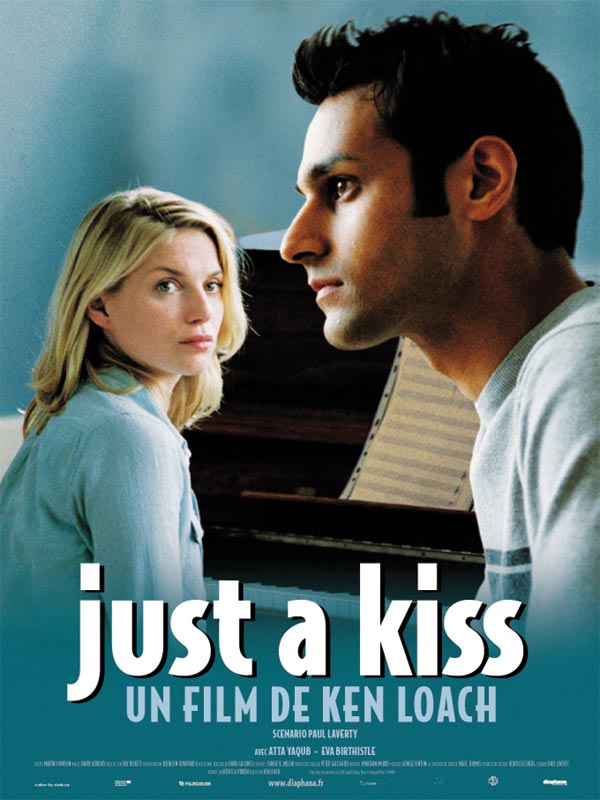Réalisation : Jean Renoir
Scénario : Jean Renoir, Carl Koch
Date : 1939
Durée : 110 mn
Acteurs principaux :
Marcel Dalio (le Marquis de la Chesnaye)
Nora Gregor (Christine de la Chesnaye)
Jean Renoir : Octave
Mila Parely : Geneviève de Marras
Roland Toutain : André Jurieux, l’aviateur
Julien Carette : Marceau, le braconnier
Gaston Modot : Schumacher, le garde-chasse
Paulette Dubost : Lisette, la camériste
SA / HA
Mots clés : Aristocrates – Domestiques – Amours – Amitiés - Médiocrités

La Règle du jeu a été produit à la veille de la seconde guerre mondiale. Il a été qualifié de « fantaisie dramatique » par son auteur, son « plus gros insuccès immédiat ». Une version remasteurisée nous permet de découvrir le film, en dépit d’une insonorisation défectueuse. Comme nombre d’œuvres de Renoir, La Règle du jeu a commencé par connaitre la désaffection du public et de véhémentes critiques avant de recevoir les plus grands éloges. Pour Truffaut, La règle du jeu constitue « le film des films ».
La trame de l’histoire est une chasse en Sologne et les jeux amoureux des principaux protagonistes. Les mœurs de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie y sont mises en scène ainsi que celles de leurs domestiques.
L’histoire n’est pas morale, parce que précisément, tout est bien qui finit bien.
Tous pourris !
Nous sommes à la période qui précède de peu le second génocide européen. Aussi, n’est-il pas étonnant d’être confronté à la déliquescence morale des dominants, les dominés ne valant pas plus cher dans la mesure où ils partagent les mêmes valeurs fondées sur le pouvoir de l’argent, la satisfaction des appétits les plus médiocres, le règne de l’imposture, la versatilité des relations. La cruauté trouve son apogée dans une abominable chasse à courre où biches, faisans et lapins sont rabattus vers les chasseurs pour être massacrés à vue. Le déroulement de l’histoire illustre un autre massacre, celui de l’amour et de l’amitié.
Ce qui fait la valeur de ce film se situe dans le constat qu’au terme de l’abaissement des protagonistes, leur dimension humaine apparait dans toute sa fragilité. Entre le Marquis, propriétaire des lieux, et Marceau, le braconnier, l’affinité se manifeste d’emblée. La partie de chasse joue le rôle d’un révélateur. Il n’est donc pas étonnant que ce grand film ait été vilipendé. C’est un bonheur qu’il soit parvenu jusqu’à nous. Merci à Jean Renoir d’avoir existé.
La problématique alcoolique offre de semblables contrastes et dégage les mêmes lois : le pire côtoie le meilleur. C’est la règle du jeu.