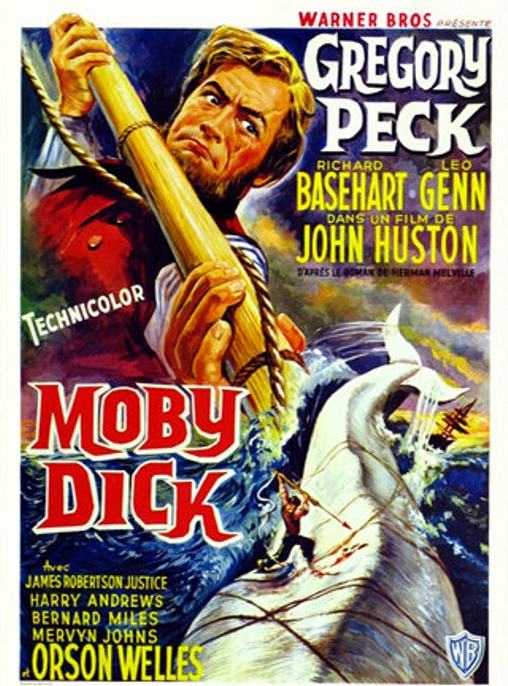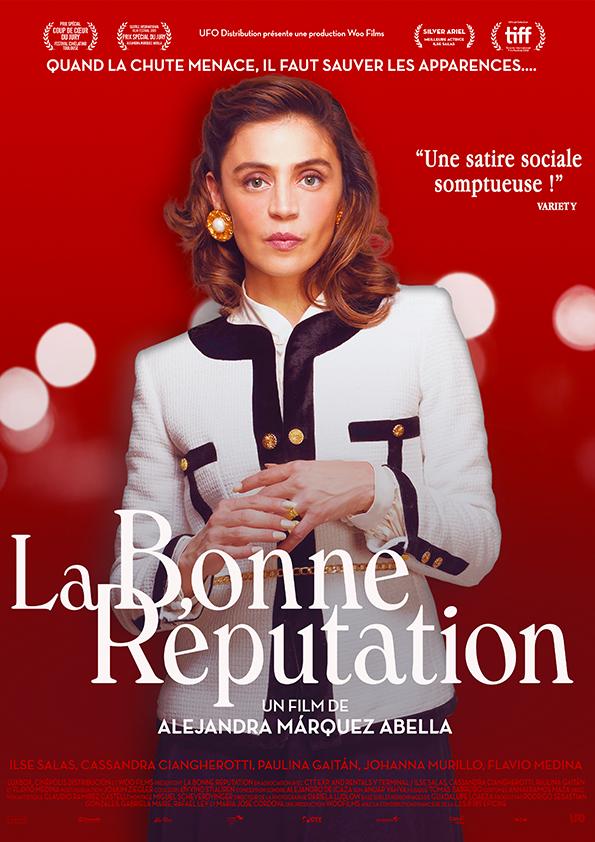Réalisation et scénario : Terrence Malik
Date : 2019 / USA / Allemagne
Durée : 173 mn
Acteurs principaux :
August Diehl : Franz Jäggerstatter
Valérie Pachner : Franziska, sa femme
Marie Simon : Rezie, sa belle-soeur
Franz Rogowski : Waldan, l’ami en prison
Nicolas Reinke : le père Moericke
Bruno Ganz : le juge Lueben
Mathias Schoenaerts : le capitaine Herder
Tobias Moretti : Ferdinand Fürthauer
Ulrich Matthes : le Maire
SA/HA
Mots clés : Refusant – Famille – Obstination – Dictature − Sacrifice

Le film de Terrence Malik relate l’histoire d’un opposant à Hitler, Franz Jäggerstatter, de 1939 à 1943. Franz fait vivre sa ferme à proximité du village de Saint Radegund, près de Salzbourg, au flanc des Alpes autrichiennes. Le cadre naturel est splendide, entre rivières, champs cultivés, forêts et montagnes abruptes. Les conditions de travail sont rudes mais Franz vit heureux avec Franziska, son épouse et ses trois petites filles. Il est parfaitement intégré dans sa communauté. Mais, à présent, l’Allemagne a annexé l’Autriche. Le troisième Reich a son Guide, sa doctrine folle et ses boucs émissaires. Les convictions catholiques et la sensibilité de Franz interdisent qu’il porte allégeance au Führer. Il s’obstine dans son refus et c’est le début d’une tragédie qui s’achèvera par sa décapitation, le 9 août 1943.
Les ombres d’une position sacrificielle
Nous laisserons aux spectateurs le plaisir de découvrir la beauté des images et l’élégance des cadrages, le sens du détail du réalisateur, l’originalité du montage, la lenteur du final qui restitue si bien la suppression du temps en prison et le caractère angoissant des étapes ultimes.
L’alcool est absent dans ce film. Pour autant, le héros de cette histoire n’est pas dépourvu d’intérêt sur le plan de la psychologie que l’on retrouve dans la problématique alcoolique.
La posture que prend Franz face à la fidélité imposée à tous les sujets du Reich se situe entre la figure du refusant et celle du résistant. Le refusant est celui qui n’accepte pas de pratiquer un acte pour des raisons qui lui sont propres, sans référence à une foi religieuse ou à des convictions préalablement réfléchies. Le résistant est celui qui, pour des raisons politiques ou idéologiques, décide de combattre ce qu’il désigne comme ses oppresseurs ou une menace pour les valeurs qui lui tiennent à cœur.
Le cas de Franz est intermédiaire. Il a des convictions religieuses. Il refuse d’obéir à une injonction dépourvue de conséquences concrètes. L’entêtement qu’il manifeste jusqu’à la mort fait intervenir sa conscience en tant que telle. Sans aucune autre considération, il maintient son attitude jusqu’au bout. Les incitations à composer avec la réalité ne manquent pas. Elles émanent de personnes bienveillantes telles que le prêtre de son village ou l’avocat lors de son procès. D’autres, comme celle du Maire acquis à l’idéologie nazie ou plus opportunistes, sont d’un autre ordre. Franz écarte toute suggestion, d’où elle vienne, susceptible de préserver sa vie. Il n’hésite pas à faire de sa femme une veuve, de ses petites filles des orphelines, de sa mère une femme terrassée par la perte de son unique enfant. Il est indifférent à l’opprobre et au rejet qui frappent sa famille au sein de sa communauté. Ceux de son village peuvent avoir la conviction qu’ils ont été trahis, déshonorés ou qu’ils sont jugés par un des leurs qui a choisi la Vertu. Il laisse à sa femme, seulement assistée de sa belle-sœur, la responsabilité écrasante de la ferme et de leurs enfants. L’intransigeance de Franz pourrait évoquer l’aveuglement passionné de la personne alcoolique sacrifiant tout à la poursuite de son addiction.
Franz a été par la suite distingué comme martyr par l’Église catholique. N’y a-t-il pas une logique de drogué dans la rigidité morale du héros ? Le Christ, lui, n’avait ni femme ni enfant à charge. D’autre part, n’est-ce-pas accorder une importance excessive à un geste dont la signification répond à une symbolique généralisée. L’adhésion à 100% d’un peuple pour quelqu’un ou un programme perd toute crédibilité. Franz n’a pas de sensibilité politique qui l’aiderait à relativiser son refus. Nous pourrions le trouver orgueilleux. Il manque surtout d’humour et de capacité à prendre du recul. À. un moment, il se trouve prisonnier de son personnage. Il est contraint d’aller au bout de sa décision. L’expérience humaine nous apprend que la force des convictions doit tenir compte de l’adversité et qu’il existe quelque prétention à vouloir avoir raison tout seul, particulièrement quand son attitude est source de malheur humain. L’entêtement à boire doit aussi s’effacer devant la réalité de la dépendance et de ses conséquences pour le présent et l’avenir. Franz adopte une attitude qui n’est pas sans évoquer celle des bellicistes qui n’hésitent pas à susciter des massacres d’innocents, vêtus ou non d’uniformes militaires.
La position sacrificielle s’apparente à une forme de suicide. N’y a-t-il pas une force d’autodestruction chez l’alcoolique qui persiste dans son addiction ?
Nous pouvons penser que les meilleurs des humains doivent plutôt avoir le souci de faire vivre leurs capacités dans une vie préservée, si terne soit-elle. Le bonheur est trop précieux et fragile pour le balayer par besoin de satisfaire une croyance – boire comme tout le monde – ou par entêtement – boire avec modération. L’alcoolique devenu sobre apprend souvent à apprécier le bonheur d’une vie affective partagée, d’un travail investi et d’un cadre naturel respecté. Fort de son expérience personnelle, il a acquis le sens du relatif.