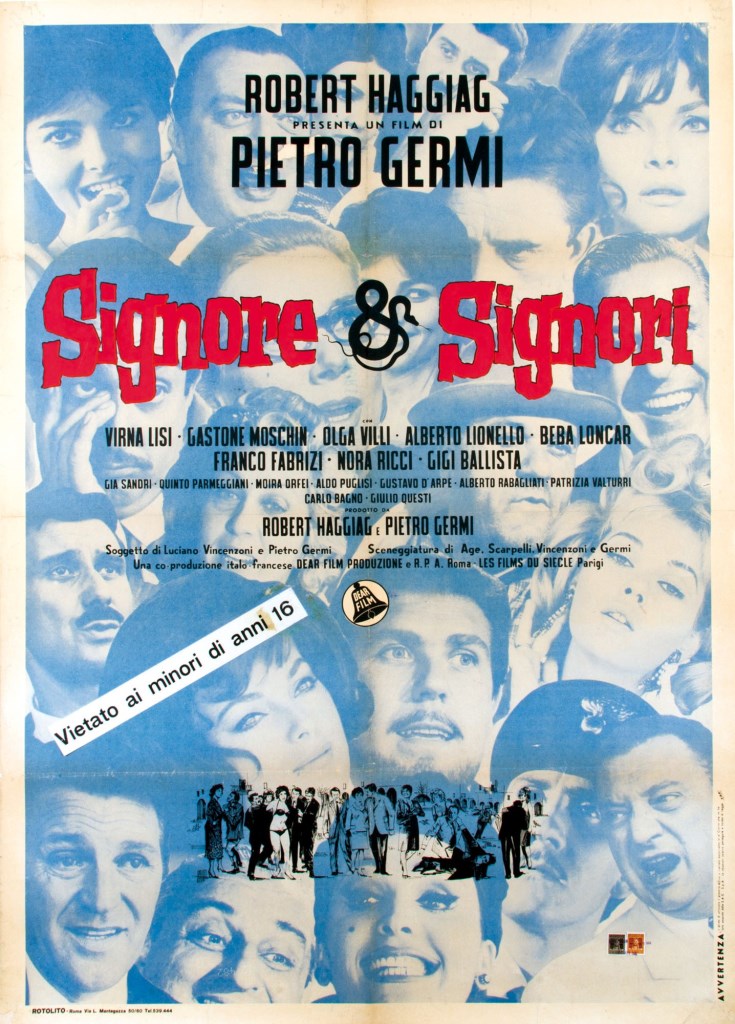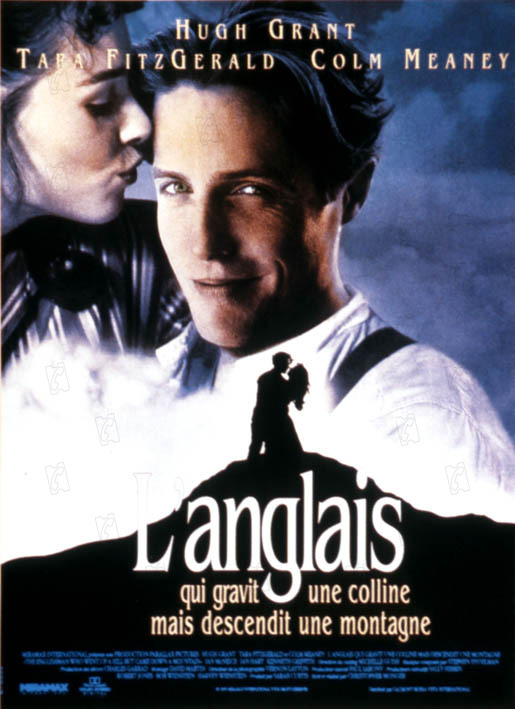Réalisation : Luigi Comencini
D’après l’œuvre de Carlo Collodi (1881)
Scénario : L. Comencini ; Suso Cecchi
Date : 1972-1975/ Italie
Durée :135mn
Musique : Fiorenzo Carpi
Acteurs principaux :
Andrea Balestri : Pinocchio
Nino Manfredi : Geppetto
Gina Lollobrigida : La fée Turquoise
Ugo d’Alessio : Maître Cerise
SA/A/HA
Mots clés : Conte – enfance – normes – paternité – pauvreté

Le film de Comencini est une adaptation pour le cinéma d’une courte série pour la RAI. Il utilise la trame du célèbre conte de l’anarchiste Collodi pour rendre admirablement l’esprit d’enfance dans ce qu’il a de plus spontané : indiscipliné, n’en faisant qu’à sa tête, menteur pour se protéger des injonctions dérangeantes, plein de vie et de naturel. Tout commence par un tronc d’arbre à la voix d’enfant qui refuse d’être découpé. Maître Cerise, son propriétaire s’en débarrasse en l’offrant à Geppetto, un pauvre menuisier d’un village de Toscane, veuf de surcroît. La fée Turquoise transforme la marionnette qu’il a confectionnée en petit garçon incontrôlable, malgré les promesses d’être sage. C’est le début d’une série d’aventures que Comencini traite avec un souci de greffer la poésie de l’histoire dans le concret de conditions de vie dures, où manger est la première préoccupation. Pinocchio n’arrête pas de courir et de s’écrier qu’il a faim.
L’enfant spontané et l’éducation
Le film de Comencini est très attachant dans la mesure où il permet aux enfants comme aux adultes de s’identifier pleinement.
Un enfant normalement constitué est à l’image de Pinocchio, avant que ne s’abatte sur lui le rouleau compresseur des conditionnements éducatifs et, aujourd’hui, du numérique pour les jeunes consommateurs. Pinocchio n’est addict qu’à la vie et aux découvertes. Il n’est pas dépourvu d’affects filiaux mais il est, avant tout, indépendant, se fiant d’abord à ses envies.
Sur le plan symbolique, la fée Turquoise, incarnée par la sérieuse Gina Lollobrigida, est un équivalent maternel. Elle est bienveillante mais normative. Pinocchio doit être sage, propre et bien travailler à l’école, sinon gare ! Le petit garçon rechute en marionnette. N’est-ce pas un paradoxe de l’histoire : quand l’enfant est lui-même il devient une marionnette ? Quand il se comporte en marionnette, respectueux des règles, il garde son apparence d’enfant !
Geppetto est un modèle de père, aimant, affectivement dépendant de ce fils inespéré mais fugueur, courant après lui, au risque de sa vie, pour le retrouver. Geppetto c’est Joseph, menuisier comme le père de l’Evangile, dépassé par sa condition de père d’un enfant incontrôlable, perdu dans un monde dur, où il a du mal à exister, tant il est pauvre. Il dit explicitement à son fils qu’il aimerait autant rester à l’abri dans le ventre du « monstre ». Il n’est pas fait pour un monde violent. Comme dans l’Evangile, c’est son enfant qui prendra l’initiative pour l’inciter à utiliser les services d’un gros thon et retrouver le monde sans empathie des humains.
La critique de l’éducation est facile à identifier : la fée Turquoise est pénible avec ses alternances de suave persuasion et de sanction transformatrice. Elle convoque deux professeurs qui pérorent sur la bonne attitude éducative. Pinocchio semble avoir le choix entre devenir une marionnette de chair s’il obéit et de marionnette en bois s’il s’écarte du droit chemin, avec les mauvaises rencontres du chat et du renard, sans parler du mauvais garçon Lucignolo. L’histoire montre que s’éloigner du chemin, en suivant aveuglément ceux qui incitent aux plaisirs et à la facilité, peut devenir dangereux et très triste aussi.
La toxicomanie, de ce point de vue, comme choix d’exister par la transgression, fait courir des risques graves aux anticonformistes, à ceux qui n’intègrent pas la loi du père qui peut être aussi une loi d’amour, de tolérance et d’humilité, confrontée à la rudesse des rapports sociaux et à la misère sociale. La fête à laquelle sont conviés Pinocchio et les autres enfants, de futurs ânes, pourrait évoquer les rave-parties. À la question du métier de Geppetto, Pinocchio répond abruptement : Pauvre !