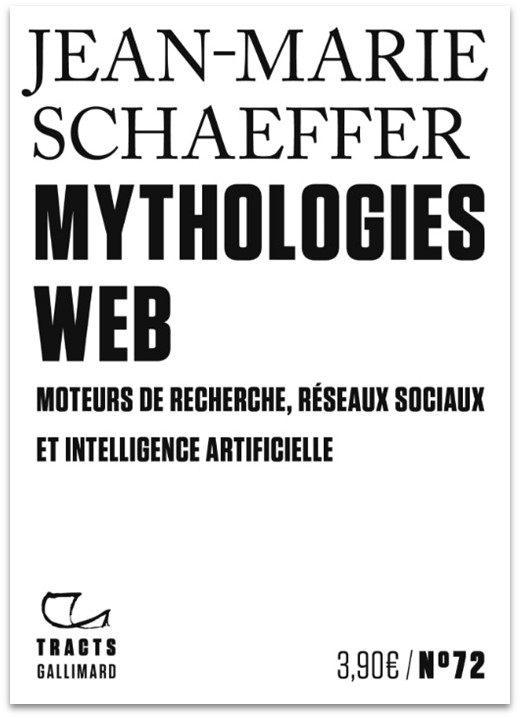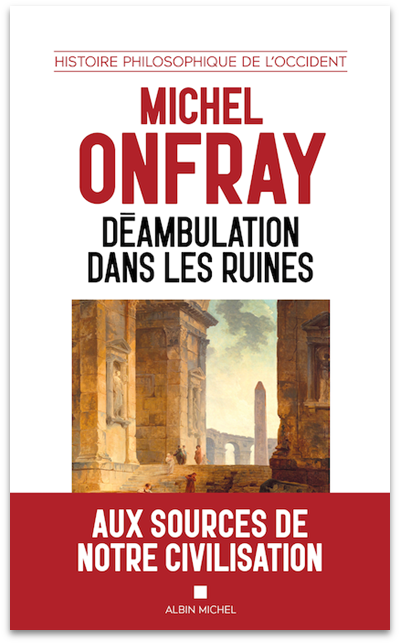Michel ONFRAY
Albin Michel
22€90 350 pages
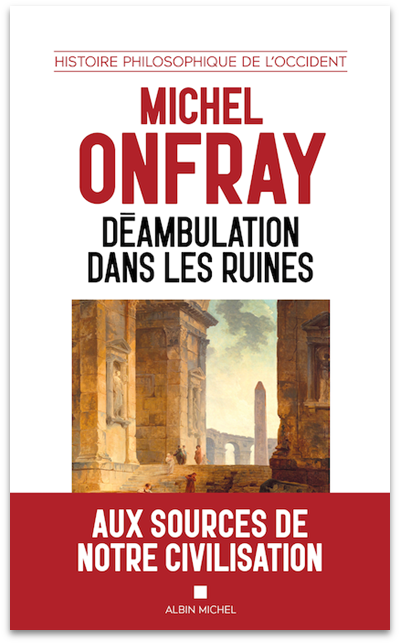
En fait de ruines, Michel Onfray s’est appliqué à présenter les principales figures philosophiques grecques et à commenter ce qui ressort de leurs historicité.
L’introduction situe son propos. Jadis – il n’y a pas si longtemps –, notre culture était associée à l’usage de la raison. Le progrès, illusoire ou pas, était un concept qui associait les champs du politique et de l’éthique à ceux des activités économiques. La science avait le souci de s’opposer à la pensée magique. Le tout visait un universalisme qui se confondait avec ce que l’on appelle l’humanisme.
De nos jours, « l’Occident est combattu, honni, méprisé, vilipendé par de nouveaux barbares. On lui préfère la déraison pure. ». L’Histoire est revisitée. L’universalisme est estimé destructeur des diversités…
Onfray oppose, dans son introduction, Apollon et Dionysos. Ce dernier inspire l’ivresse mais aussi la musique, la danse, le chant, l’exaltation, les instincts, la force de vie.
Apollon au contraire rapproche la sculpture, la prévision, l’imagination, le rêve mais également le calme, la sobriété, le dialogue, la transparence, la dialectique, la science, le besoin de connaissance.
Au terme de la lecture et avant de résumer son ouvrage, quelques annotations. Onfray dit quelque chose d’important à propos de celui qui écrit, en politique ou en philosophe : il est important de préciser d’où on écrit et pourquoi on s’exprime. Il se trouve que c’est comme cela que j’ai entamé la rédaction du Tract intitulé : « : Homo addictus ? Et après ?! ». J’ai pu apprendre que l’Université populaire qu’il avait fait vivre à Caen, pendant des années, avait dû fermer, faute de locaux publics et que le même problème s’était posé dans le village normand où il réside, quand il n’intervient pas sur un plateau de télévision. L’AREA n’existerait pas si je n’avais pas eu la possibilité de lui garantir un lieu de vie. Je comprends mieux – sans l’approuver du tout – son animosité systématique quand il décrit ce qui vient de la tradition de gauche. Déconstruire les idées reçues à propos des philosophes grecs est un exercice qui lui plaît manifestement. Il manifeste ainsi une culture encyclopédique de cette période de l’histoire de la pensée. Il s’y emploie avec d’autant plus de force qu’il règle, par ce biais, un contentieux sans fin avec le Christianisme et le courant socialiste, tout en défendant notre civilisation, ce qui me semble contradictoire… J’ai appris également qu’il avait été gravement touché par des accidents vasculaires, dont il a réchappé.
La difficulté est que nous disposons de très peu de texte de première main et qu’il s’agit, à leur propos, de reprises ou de colportages, avec tout ce que cela comporte de parti pris. Onfray se livre à un travail de démolition des opinions reçues, si bien, qu’à la fin, le lecteur a, vraiment, la sensation de s’être promené dans un champ de ruines. Nous pourrions dire qu’il enfonce aussi souvent les portes ouvertes et que les questions soulevées méritent peut-être une vision plus chaleureuse, distanciée et subtile de la philosophie grecque même revisitée par les influences européennes ultérieures. Onfray s’affirme hédoniste athée et s’exprime comme tel… Soit !
Pour les besoins du résumé, j’utiliserai peu de citations du texte et écrirai dans mon propre langage.
La philosophie grecque oppose des courants plus ou moins opposés.
Le livre comporte plusieurs parties qui regroupent plusieurs philosophes.
I – LES PRINCIPES
La dialectique d’Héraclite, d’Ephèse
Nous ne disposons que de quelques fragments de sa réflexion. Chacun a en tête sa formule célébrissime : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Tout change, le fleuve et nous-mêmes, en dépit de l’illusion du même. Il préfère les connaissances issues de l’observation et de l’expérience. Il admet que la connaissance n’est pas une donnée immédiate.
L’image du soleil se rapproche de celle du fleuve : « Chaque jour, il est le même soleil, certes, mais il est plus riche de la journée qui lui faisait défaut la veille et plus pauvre d’un jour manquant sur le lendemain ». Héraclite oppose la référence conceptuelle à la matérialité concrète et datée du concept, ce en quoi il a, de mon point de vue, parfaitement raison.
La dialectique suppose un déploiement dans le temps qui permet la confrontation, la contradiction, en vue d’une possible et passagère harmonie.
Je fais mienne la pensée dialectique d’Héraclite, telle que je l’ai résumée.
Parménide d’Elée : le concept en soi, ou ontologie
Dans le Phédon de Platon, il est dit que Socrate s’assoie sur son lit, mais on ne sait pas de quoi ce lit est fait. C’est « ce qui reste de l’objet quand on a supprimé l’entièreté de sa matérialité » p 33. C’est donc le philosophe de l’abstraction.
Il serait stupide d’être opposé aux abstractions. Elles sont indispensables à la pensée. Cela étant, nous privilégions les concepts opérants qui aident à comprendre et/ou à transformer une réalité.
II – LA REALITE
Démocrite ou le rire de l’incroyant
Ce philosophe eut la révélation de l’infiniment petit dans l’existence du monde (l’idée de l’atome) en considérant la poussière éclairée par un rayon de soleil. Son œuvre « Le grand système du monde » est une mise en forme d’une philosophie matérialiste.
L’hégémonie chrétienne, mentionne Onfray, a eu pour effet de réaliser une sorte d’autodafé des œuvres qui contrariaient sa conception du Vrai : D’Épicure à Lucrèce, sous oublier Démocrite, ne restent que des fragments ayant échappé à la destruction. Le poème de 7415 vers de Lucrèce a échappé à l’oubli par miracle, si on peut dire. Il ne reste rien ou presque des textes d’Épicure.
Nous faisons nôtre le rire, pour éviter de nous prendre excessivement au sérieux, parce que cette réaction à l’absurde, à la bêtise, ou à l’inattendu fait un grand bien. L’église déteste a priori le rire (Pensez au célèbre film « Le nom de la rose »), dans le sens qu’il aide à dissiper le fumeux des discours. Les personnalités politiques rient très peu aussi, mais les meilleures ont de l’humour.
Pour Démocrite, la métaphysique est un non sens. « La physique congédie la métaphysique. Elle interdit les craintes d’un arrière-monde qui n’existe pas. Il n’y a ni enfer ni paradis (p55). Reste l’éthique et… le rire. La morale de Démocrite rejoint « la sagesse des peuples » : (p56) : Dire la vérité (autant que possible), éviter de parler pour ne rien dire, critiquer ses erreurs plutôt que celles des autres, ne pas donner une importance qu’il n’a pas à l’argent, être indifférent – au mieux attentif – aux critiques, jouir sans excès, réfléchir avant d’agir, ne pas être envieux, subir l’injustice plutôt que la commettre, se montrer généreux, savoir être reconnaissant… Démocrite ne met rien plus haut que la tranquillité et la fermeté d’âme, c’est-à-dire d’un état d’esprit débarrassé de la crainte.
Je me sens proche de Démocrite.
Platon et la philosophie des oppositions
Platon est le philosophe grec préféré par l’Eglise. Il s’oppose à la dialectique. Il fonde l’idéalisme et le dualisme : le corps et l’esprit. Le corps est une prison pour l’esprit. Il convient de s’en accommoder.
Il est dangereux d’en jouir, dit-il. Sa philosophie laisse place aux idées de vies antérieures et de réincarnations. Il défend la réminiscence : « on n’apprend jamais rien, on ne se ressouvient que de ce que l’on avait déjà ».
Dans l’allégorie de la Caverne, la Lumière vient d’en haut et de l’extérieur et les hommes enchaînés ne peuvent voir que leurs ombres.
Au final, les conceptions platoniciennes sont des machines de guerre qui permettent d’imposer la loi de la classe sacerdotale au plus grand nombre.
Depuis Platon, il n’a pas manqué de clergés, religieux ou non, qui se sont appliqués à soumettre le plus grand nombre à la Loi de leurs intérêts.
On découvre que Platon, membre éminent de l’élite, comme pratiquement tous les philosophes grecs, savait présenter ses adversaires d’opinion de façon caricaturale. Cela n’a pas beaucoup changé.
Nous sommes en désaccord profond avec la philosophie de Platon, même s’il a su mettre en scène des dialogues passionnants et faire de Socrate une référence de la maïeutique, de l’art d’accoucher des vérités, inapparentes en première analyse. Les idéologies ont toujours, de notre point de vue, des fondements qui se trouvent dans les rapports sociaux. Plus elles s’affirment au-dessus du réel, plus elles peuvent le masquer.
III – LE COUPLE
Pythagore, le mariage et la famille
Six siècles avant Jésus-Christ, Pythagore distingue le corps et l’âme. Il croît en la réincarnation. Il considère le corps comme une prison. Il interdit le suicide.
Il valide le primat des hommes sur les femmes, le mariage et la procréation dans le cadre de la monogamie. Les ancêtres doivent être vénérés etc… Bref, bien avant l’église apostolique et romaine, Pythagore fixe les lois de la tradition. Le dualisme du philosophe annonce l’idéalisme platonicien.
Nous connaissons la valeur d’une famille aimante, qui se parle, comme modèle d’une microsociété solidaire.
Les cyniques et les copulations débridées
Faisant pendant au rigorisme de Pythagore, les cyniques avec Antisthène, Diogène et quelques autres célébrités tels que le couple formé par Cratès et son épouse Hipparchia.
La sensibilité libertaire fait partie des contrefeux opposés aux modèles normatifs contraignants.
Antisthène, notamment, manifestait un mépris pour les honneurs et l’argent dont pourraient davantage s’inspirer nos seigneurs et maîtres, sans parler de leurs valets.
IV – LA VERITE
Le Socrate de Plutarque
Il est inutile de présenter Socrate, tel qu’il a été scénarisé par Platon.
Relevons, au passage, une histoire symbolique concernant le porc, non la matière travaillée par une charcutier mais comme métaphore du « pourceau matérialiste incapable de lever sa tête vers le ciel, tout occupé qu’il est à fouiller la terre avec son groin ».
Nous n’attachons aucune importance à l’historicité de Socrate, à ses mœurs ou à sa mort.
Nous faisons nôtre la maïeutique socratique comme moyen de mettre en discussion et en doute les évidences.
L’art éristique de Protagoras, le sophiste
Eristique ou controverse.
Le chapitre met l’accent sur la dualité du sens des « mots de la philosophie », avec un sens commun qui se révèle souvent plus sage que la formulation philosophique proprement dite.
Ainsi, le matérialiste désigne une personne obsédée par l’accumulation de biens et d’avantages matériels.
L’idéaliste est celui qui prend ses désirs pour la réalité.
Le cynique, un personnage sans foi, ni loi, ni éthique.
L’épicurien devient un jouisseur.
Le sceptique celui qui doute de tout et ne croit en rien.
Le sophiste est un discoureur, capable de défendre tout et son contraire.
Les sophistes faisaient payer chèrement leurs interventions publiques. Protagoras et Gorgias étaient les plus connus.
On pourrait reconnaître chez un sophiste le portrait de certains avocats. Un habile orateur, se jouant de la vérité et des émotions, peut sauver un coupable d’un mauvais pas, au détriment de la victime, coupable d’avoir choisi un mauvais avocat.
Des sophistes, retenons la nécessité de savoir défendre une cause, avec la conviction et l’habileté nécessaires.
V – LA NOURRITURE
Rien de marquant dans l’opposition entre Diogène, l’amateur de viandes et Porphyre, le frugal, qui aurait pu inspirer un ordre monastique.
De notre point de vue, notre dentition nous donne le statut d’omnivore, libre à nous d’être gourmet et frugal plutôt que goinfre et glouton. L’excessivité relève du masochisme inutile, à moins qu’elle manifeste un goût pour la castration.
VI – LE BONHEUR
Rien de passionnant dans ce double chapitre, de l’hédoniste Aristippe de Cyrène, pour lequel n’existent que des vérités de convention et d’usage. A retenir : « Ne pas lire beaucoup, mais lire utile, à vivre en bonne intelligence avec les plaisirs : ni trop, ni trop peu, faire bon usage de l’ironie » …
Le passage consacré à Cicéron (que vient faire, ici, ce romain ?) ne manque pas d’intérêt, ne serait-ce que pour montrer le hiatus entre les discours et conseils, d’un côté, et les pratiques et la position sociale, de l’autre. Les tusculanes, une de ses œuvres de référence, insiste sur la Vertu. Sa réflexion est hautement compatible avec la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Nous savons quel usage en a fait la religion chrétienne et, de nos jours, en fait la religion musulmane.
Pour nous, simplement, le bonheur évoque l’amour, l’amitié et un accès raisonné aux plaisirs. Le bonheur est aussi une sagesse : une aptitude à se satisfaire de ce qui est raisonnablement atteignable et d’agir conformément à son éthique.
VII – LE PLAISIR
Épicure eut beaucoup d’ennemis, les uns se moquant de son esprit ascétique, les autres l’accusant d’un double langage. L’auteur indique, (p 186) qu’ils pratiquent « l’attaque ad hominem » qui dispense d’un effort de réflexion et font l’économie dans leurs propos de l’honnêteté, de l’humilité, de la probité et, plus encore, de l’intelligence. Bref, il décrit les modalités des controverses de notre période par des sophistes qui pratiquent le déni. Epicure n’affirme pas son incroyance mais il agit comme si les Dieux n'existaient pas. Il s’efforce d’être son propre guide, en toute indépendance intellectuelle, dans une éthique de modération. A l’époque d’Epicure, il n’y avait pas de conscience sociale.
Nous ne refusons pas les plaisirs accessibles, dans leur diversité, mais nous nous efforçons d’appliquer le Ne pas (se) nuire. Nous ne nous laissons pas entraîner dans leur seule recherche, à la différence des hédonistes.
Lucrèce : La douceur (et la vacuité ?) matérialiste
Lucrèce, le latin, nous a fait connaître Epicure, qu’il prolonge par son poème De la nature des choses composé de 7415 vers. C’est un philosophe de la lucidité. « Il sait que tout va, tout passe, tout trépasse et tout disparaît. Ce n’est pas un nihiliste. C’est un incroyant au sens fort du terme. Il sait que « la plupart préfèrent des illusions qui les sécurisent (en surface) à des vérités qui les inquiètent (ou les angoissent). « Les hommes craignent tellement la mort qu’il leur arrive de se suicider par peur de la mort » (p207). « Toutes les passions sociales s’enracinent dans cette angoisse que le mortel doit écarter en accumulant des jouets pour enfants (les honneurs, les richesses accumulées, le pouvoir…).
(On croirait lire la phrase choc de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités » …)
VIII – LE SUICIDE
Le métier de vivre
Tout est dit dans cette formule : vivre est, effectivement un métier, et un art. Cela étant, notre modernité en fait un métier très difficile.
La Bible comporte des textes philosophiques. Le livre de Job permet de réfléchir à la souffrance et à sa signification, si tant est qu’elle en ait une.
La mort de Sénèque, le stoïcien, a fait couler beaucoup d’encre. En fait, il avait déplu à Néron, son empereur, qui lui avait donné l’ordre de se suicider. Ce fut laborieux.
Le suicide assisté fait partie des débats actuels…
IX – LE CITOYEN
La république de Zénon, tel est titre de l’œuvre de ce « philosophe » avant tout identifiable à l’école cynique pratiquant une activité sexuelle sans aucune exclusive, toutes les catégories d’inceste étant licites.
Aristote, avec sa Politique et son Ethique à Nicomaque, est le théoricien d’une société hiérarchisée, validant l’esclavage. Il y a, côté domination, le maître, époux-père, et de l’autre, esclave-épouse-enfants. Aristote défend la notion de maîtres, par nature, et d’esclaves, par nature ! Il a longtemps été la référence intellectuelle pour l’Eglise.
X – LA CONNAISSANCE
La rhétorique de Quintilien ou la parole au service du vrai, avec ce que cela suppose de connaissances.
Pyrron et le relativisme. C’est une réflexion détaillée qui annonce la célèbre formule d’Einstein.
Il en établit 10 raisons :
- Différences de perception entre l’être humain et les animaux.
- Différences de perception entre les humains.
- Subjectivité des perceptions : nous considérons une pomme à partir de ce que nous savons sur la pomme.
- Subjectivité liée aux différences de position.
- Relativisme selon les cultures, ce qui renvoie à l’attitude déconstructiviste, redéfinissant, par exemple, le normal et le pathologique.
- Relativisme dépendant des conditions de la perception, dans une pénombre ou en plein jour…
- Relativisme par rapport aux
- Même chose, par rapport aux quantités.
- Les conditions d’apparition : habituelles, fréquentes, rares…
- L’intervention des comparaisons.
La relativité des approches n’empêche pas la réalité des choses, mais elle incite à la prudence dans les interprétations.
XI – L’ORIENTATION
Pythagore et la formation des élites
Pour le petit nombre d’élèves admis à son enseignement le parcours de sélection était plus que rude et ils devaient développer des dispositions impressionnantes qu’il serait fastidieux ou amusant de décrire. Le Maître était une véritable diva. Il parlait séparé par un drap de ses élèves. Nous n’avons pas besoin de tels maîtres qui, avant tout, s’écoutent parler.
Philon d’Alexandrie s’est appliqué à effectuer une synthèse du judaïsme et de l’hellénisme. Il insiste sur le « contrôle de soi », sur le détachement des choses.
XII – LA SOUFFRANCE
Marc Aurèle, Epictète et le stoïcisme
Nous sommes, ici, proches des références des Alcooliques anonymes. Marc-Aurèle utilisait le concept des 24 heures, dans un sens différent de celui que nous préconisons. Il réfléchissait sur la façon dont sa journée s’était passée. Nous préférons réfléchir en début de journée. Au moins, met-il en valeur le rôle qu’il accorde à cette réflexion : construire sa vie.
Une notion à connaître pour l’écarter, la psychagogie : réduire les activités humaines à des pratiques méprisables, telles que manger un poisson qu’ingérer un cadavre…
Plotin s’applique des privations pour affaiblir les « passions » du corps. Il rejoint une sensibilité philosophique qui déteste le corps, les désirs « naturels ». Il ne mangeait qu’un jour sur deux. Sa philosophie représente une variation de la « haine de soi », très répandue de nos jours.
CONCLUSION
Onfray résume les influences de la philosophie grecque sur le christianisme.
A Platon, les néoplatoniciens, eux-mêmes enfants de Pythagore, les ecclésiastiques empruntent la dualité du corps et de l’âme, la haine des désirs, la survie de l’âme à la mort du corps. S’y ajoute une misogynie structurelle, la femme suscite le désir du corps, poison de l’âme.
Aux stoïciens, les chrétiens empruntent le dolorisme, la soumission à ce sur quoi on ne peut rien, l’amour de la pauvreté, l’invitation fraternelle à aimer son prochain, ennemis compris.
Aux épicuriens, la sensibilité communautaire et la vie monastique.
Aux aristotéliciens, la métaphysique : Trinité, Corps Glorieux, Réincarnation, Immaculée Conception.
Aux néoplatoniciens, le retrait du monde…
Au terme de ce survol savant, que conclure ?
Nos conduites de vie ont besoin d’une réflexion distanciée pour limiter l’effet des préjugés et des erreurs d’interprétation et de positionnement.
La vie n’étant assurément pas un long fleuve tranquille, il faut savoir l’aborder en stoïcien quand elle comporte des périodes difficiles, en épicurien quand elle laisse place à une plus grande marge d’action.
Le « ne pas (se) nuire » peut s’associer au (se) faire plaisir, ce qui rejoint le « vivre et laisser vivre » des Alcooliques anonymes.
Le sens du collectif et l’intérêt général étaient absents des philosophes grecs dans la mesure même où ils vivaient au sein d’une société esclavagiste, dominée par les hommes.
Certains courants ont la haine du corps, et plus largement, la haine de soi. Ils fuient les réalités. Notre option est à l’opposé.
Il est bon d’avoir des influenceurs, à condition, à un moment, de savoir s’en détacher et de réaliser sa propre synthèse.