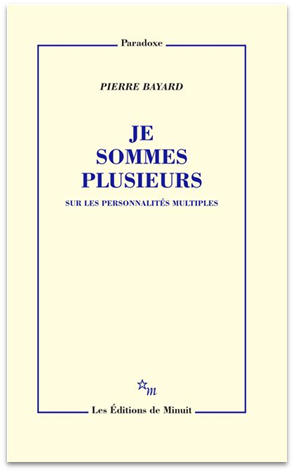Martine Sandot-Buthaud
Laurence Begon-Bordreuil
Martine de Maximy
DANS LA TÊTE
DES JUGES
Préface de Denis Salas
Trajets / Érès
28€ 309p
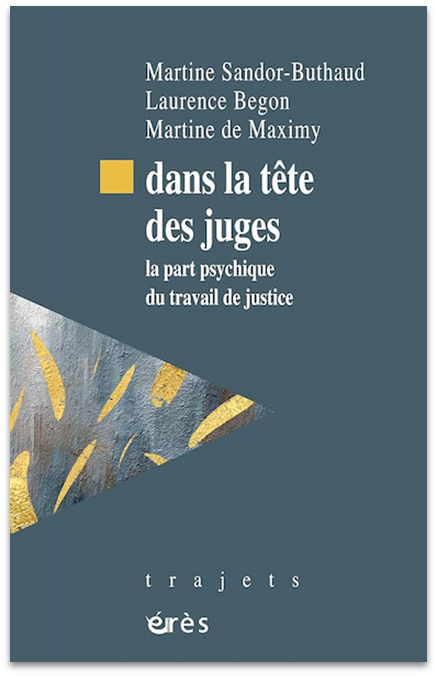
Trois raisons de m’intéresser à cet ouvrage : comme père d’enfants investis dans le Droit – une avocate pénaliste et un juge, comme possible psychiatre-expert auprès des Tribunaux et comme praticiens confrontés quotidiennement à des situations impliquant la Justice.
Martine Sandot-Buthaud est psychanalyste et les deux autres autrices sont des juges qui ont été confrontées à des enfants, comme l’auteur de la préface.
Le préfacier est lui-même juge des enfants. Le juge, dit-il, est « aux prises avec le conflit, la confusion, la violence. Il côtoie la destructivité en permanence. Il a besoin d’un « surmoi tempéré », associant fermeté et bienveillance. Il est confronté en permanence à des interlocuteurs qui tentent de retourner la loi à leur profit. Il est plus ou moins animé par une pulsion réparatrice.
L’introduction confirme le titre de l’ouvrage. Il s’agit de s’interroger sur la subjectivité d’un juge au-delà de ses « obligations déontologiques » : l’indépendance vis-à-vis des Pouvoirs, l’impartialité, la conscience professionnelle… « Le juge travaille un dossier mais le dossier le travaille aussi ». Elle met en jeu ses représentations, son inconscient.
I – Psychisme et théories psychologiques (1,2,3)
Trois théories sont succinctement présentées.
- La psychanalyse met en avant les traumas, constructions mentales à partir d’un fait réel, mais parfois aussi, d’un fantasme, souvent retrouvé par Freud dans le suivi de personnalités hystériques. Son disciple et collègue, Ferenczi mit, fort justement, l’accent sur la fréquence des actes et des situations réellement subis: abus sexuels, maltraitances, deuils précoces, absence de soins précoces, individualisés plus tard par des anglo-saxons (Bowlby, Winnicott…)
- Le courant comportementaliste insiste sur les troubles cognitifs et les difficultés liées des interprétations des émotions.
- Le courant humaniste mise sur les ressources du sujet et sur la relation. Carl Rogers avec son approche des groupes, Bern, le père de l’analyse transactionnelle ou encore Milton Erickson pour l’hypnose, appartiennent à ce courant.
Quid du Magistrat ?
Le comportementalisme met l’accent sur des biais cognitifs possibles. Il en est ainsi (p44) du :
- biais de disponibilité: se fier aux données identifiées et ne pas creuser davantage,
- biais de confirmation, qui consiste à ne retenir que les éléments confirmant les premières impressions, (attitude fort répandue au demeurant),
- biais d’ancrage, qui consiste à s’en tenir à la thèse initialement émise (attitude tout aussi banale).
En clair, ces biais sont une façon de mal faire son travail, sans prendre le temps et réaliser les rencontres adéquates, pour prendre la mesure d’un dossier. Les Juges sont des femmes et des hommes comme les autres.
Il est proposé qu’un juge dise comment il a ressenti la prestation de son collègue dans d’une affaire. Je doute que cela se pratique beaucoup.
D’une façon générale, tout juge doit disposer d’une bonne maîtrise émotionnelle. Il doit se connaître assez pour se méfier de sa propre subjectivité qui peut être diversement sollicitée selon le contenu des dossiers.
Les humanistes insistent sur la qualité de la rencontre, en dépit du caractère très inégalitaire de la situation lors d’une action de justice. Le Juge n’a pas à se cacher derrière sa fonction. Cela diminuera l’artifice dans la posture du prévenu.
Quel est le niveau de compatibilité entre l’approche judiciaire et l’approche thérapeutique ?
Considérons les 5 caractéristiques d’une attitude thérapeutique selon Carl Rogers.
1/ L’empathie :
Il est toujours utile de considérer une situation à partir de la subjectivité de l’interlocuteur, sans se formaliser du ton et du style de son discours. L’important est que le sujet s’exprime en confiance. Certains y voient de l’habileté. Pourquoi pas ?
2/ L’acceptation inconditionnelle
Il s’agit de prendre le sujet, ici le « prévenu », tel qu’il est, de rester poli, neutre et égalitaire lors des échanges. Il est lui, je suis moi.
3/ La congruence
La congruence est une forme d’honnêteté vis-à-vis de soi (ici, du juge envers lui). Il doit faire place à ses propres affects, pour les mettre à distance.
4/ La centration sur l’autre.
Au cours d’une action de justice, il serait drôle que le Juge parlât de lui. Le hors-sujet doit être évité alors que ce n’est pas le cas lors d’un entretien psychothérapique. L’effet de miroir ou d’écho ou un hors-sujet peuvent cependant avoir du sens.
5/ La non-directivité.
La non-directivité est relative. Car beaucoup d’interlocuteurs parlent pour ne rien dire, sans réellement savoir ce qu’ils disent, sans se soucier d’être compris. Elle aide à écouter, tout en veillant à éviter les hors-sujets du prévenu, qui égareraient le propos.
Avec ces nuances, le clinicien fonctionne comme un juge dans la relation.
- L’approche psychanalytique : la scène inconsciente et le travail psychique dans la pratique judiciaire
« L’inconscient est séparé de la conscience par un système de censure et une organisation de défense qui empêche les contenus inconscients de remonter ». Il est dit que certains juges « sont raides comme la justice ».
Le juge peut ne pas sentir qu’il est affecté et ne sentir que sa réaction de défense : un malaise, un rejet du justiciable, un dégoût exagéré, des jugements très forts et tranchés, une envie de passer vite à un autre dossier ». (P110). Quel est le clinicien qui n’a pas lui-même éprouvé ces affects, mécontent de ne pouvoir exprimer son point de vue, face à certains récits ou attitudes ?). Il convient, à la fois, d’éprouver, de comprendre le sens de son ressenti et de se contrôler, en raison même du caractère impersonnel du jugement à énoncer.
II - L’attitude analytique et la posture interne du juge la plus propice au travail de justice
Trois éléments essentiels : l’attention flottante, la neutralité bienveillante, la tenue du cadre.
L’attention flottante est d’usage habituel dans la relation clinique et, plus largement, lors des conversations. Quelqu’un parle pour ne rien dire, encombre son propos de détails inutiles, et, cependant, ici et là, une parole prend un sens et a une signification particulière. Cette faculté est compliquée à faire vivre lors du travail du Juge, convoqué à aller au fait le plus rapidement possible. « Les juges sont sous la pression de juger vite. La hiérarchie le leur demande, le public le réclame » (p134). Notons cependant, qu’à l’occasion les procès médiatisés prennent l’allure de feuilletons. L’écoute flottante, contrairement à ce que l’on pourrait croire, est une forme de rigueur intellectuelle permettant de saisir le signifiant au-delà du signifié. « Le juge est seul. Il ressent cette solitude. Il doute et à un moment il doit sortir du doute, trancher, se déterminer » (p129)
La neutralité bienveillante est à la portée de tout professionnel normalement constitué. Il ne s’agit pas de prendre faits et causes pour celui qui parle, mais d’écouter ce qu’il a à dire sans préjugés, en étant prêt à l’aider à s’exprimer davantage. Comme l’analyste ou le clinicien, le juge « ne livre pas ses opinions, ne donne pas de conseils et se garde de tout passage à l’acte » (p134). Le devoir d’impartialité entre en tension avec la subjectivité du juge. On conçoit l’importance d’effectuer un travail critique sur la subjectivité de tout professionnel de la relation.
« Le procureur de la République est, comme tous les magistrats, tenu à l’impartialité. Il tient le rôle de l’accusation. Il défend la société et l’intérêt général.
Il requiert l’application de la loi, non la vengeance, pas plus qu’il n’est l’instrument de la vox populi » (p147). Il doit tenir compte de tous les arguments et sa « sévérité doit être indépendante de ses propres affects. »
Chacun sait combien, les magistrats peuvent être soumis à des pressions du politique, des médias, de la hiérarchie, sans parler des menaces éventuelles. Les médecins ne sont plus à l’abri de ce genre d’intimidations ou de rétorsions plus ou moins explicites.
Christophe Dejours (p156) sait de quoi il parle quand il « affirme la centralité du travail pour chaque individu, et parle de la souffrance éthique lorsque la qualité du travail est empêchée ou, au contraire de « l’accomplissement de soi » par le talent déployé dans le travail.
« Tenir le cadre, s’y tenir et être tenu par lui » est une exigence qui ne tolère pas d’exception de la part du professionnel. Libre aux autres de s’en éloigner, le Juge, comme le clinicien, est là pour faire vivre le cadre, garant de la qualité de la relation. Le souci du cadre participe à la solitude du professionnel. En même temps, il garantit la qualité de ses prestations. Les rituels participent au cadre par leur force symbolique. Nous sommes réunis pour quelque chose qui nous dépasse.
« La robe du juge est comme le costume de l’acteur de théâtre. Elle aide l’acteur à entrer dans la peau du personnage » (p173). « Le juge doit investir son rôle, c’est-à-dire qu’il va créer son propre masque », selon le collectif et selon sa propre personnalité.
« Il est des justiciables (ou des patients) capables d’intégrer le sens du cadre, d’autres pas ». (p180).
III – Incidences de la structure psychique du magistrat et du transfert dans l’exercice de sa fonction
Surmoi et idéal du Moi dans la pratique judiciaire
Le Surmoi équivaut à la « conscience » pour notre « Jiminy Cricket ». C’est un produit d’importation d’origine parental, culturel et sociétal. Il fonctionne comme une instance interdictrice, indiquant ce qu’il faut et ne faut pas faire. On le retrouve dans les traditions.
L’idéal du Moi représente l’amour porté, il à l’image de soi. Il est possible d’être fier de soi ou, au contraire, ne pas s’aimer, en dehors de toute véritable correspondance avec la valeur propre du sujet. L’idéal est moi, il est volontiers comparatif, illustré par la formule de Talleyrand : « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ».
Freud a émis l’hypothèse du caractère constitutif de la pulsion de mort chez tout sujet. « Les pulsions de vie tendent vers la recherche de plaisir, vers le lien. La pulsion de mort « tend vers la non-vie. Elle est force d’inertie à l’origine du phénomène de répétition, et fait œuvre de désunion, de déliaison et de désorganisation. La pulsion de mort, défléchie vers l’extérieur, devient pulsion de destruction, pulsion d’emprise, volonté de puissance (p211). « La violence retournée par la société contre la destructivité peut devenir excessive et se mettre au service de la barbarie sous la forme de dictature et toutes les formes d’abus de pouvoir. « Le droit est sans cesse guetté de se retourner en son contraire » selon Garapon.
Les stades ’d’organisation de la libido : quelles incidences dans la pratique ?
Libido signifie désir, envie, plaisir.
La libido orale renvoie à la « niche maternelle » au temps de l’allaitement, acte libidinal diversifié : le bébé est tenu, soutenu, porté, serré contre la poitrine de la mère, ses mains contrôlent l’objet-sein, la bouche se nourrit au contact du mamelon, son regard croise celui de sa mère dont il peut entendre la voix. La théorie de l’attachement découle de ces observations. L’enfant peut devenir sécure et autonome ou, au contraire, anxieux et instable, faute d’avoir incorporé la sécurité des premiers temps de sa vie.
Le stade d’organisation anale se met en place autour de la seconde année, avec le plaisir de la rétention et de l’expulsion, le plaisir du contrôle des sphincters.
Le stade d’organisation phallique, entre 3 et 5 ans, est celui de la découverte des différences anatomiques entre les sexes. Ni garçon ni fille ne le possède en propre.
La génitalité permettra d’harmoniser ces différents stades de la maturation mentale, si les conditions requises pour cette évolution ont pu se concrétiser dans la vie du sujet.
Le juge comme le clinicien est confronté à toutes sortes de sujets diversement constitués, ayant plus ou moins intégré ces différents stades. Il doit faire avec. A noter que l’inceste n’est toujours pas nommé dans le Code civil (p238). Les juges sont confrontés, comme d’autres, à « la loi du silence ».
Un passage (p239) cite le psychanalyste Racamier qui parle de fonctionnement incestuel : « Ce fonctionnement (familial) organise et maintient la confusion des places et des rôles. L’enfant est un objet pour la satisfaction des besoins narcissiques du parent…Le paternel est ce qui vient faire tiers par rapport à la mère. Chaque parent, quel que soit son genre, exerce les deux fonctions paternelle et maternelle. « L’essentiel est que, d’une manière ou d’une autre, la fonction de tiers soit assurée, que l’interdit de l’inceste soit posé et respecté, que la différence des sexes soit inscrite et la différence des générations marquée, et la place de chacun délimitée. » (p340). Telle est la mission impartie au juge.
Celui-ci a maille à partir avec certains justiciables qui entendent imposer leurs discours, leurs attitudes et leurs lois à la Loi représentée par le Juge. Il doit tenir bon face aux provocations.
La dynamique du transfert et du contre-transfert et son maniement dans la pratique judiciaire
Il est naturel de rechercher a priori les plages de rencontre et d’alliance plutôt qu’adopter la posture opposée qui relèverait de l’agression. Nous avons à nous garder des phénomènes d’identification ou de projection. Chaque position dans l’acte de justice peut donner lieu à des projections. Le Juge peut être vécu comme juste ou persécuteur, l’avocat comme une bonimenteur, le prévu comme une victime ou un moins-que-rien… « Le magistrat, sans s’en rendre compte, peut vivre une situation du passé ».
Il reste à chaque lecteur à s’emparer lui-même des arguments de cet ouvrage, à les confronter avec sa propre expérience, à interroger sa propre subjectivité.
Nous vivons tous dans une société traversée par des idéologies contradictoires, constitutives d’intérêts divergents.
Certains ont mis en cause « La république des juges » pour la raison que ceux-ci ont jugé des personnalités politiques d’une façon qui heurtait leurs convictions ou intérêts. Nous vivons une époque étrange où il devient de plus en plus difficile de se parler et de se comprendre, où l’intérêt général semble être devenu une question futile, au mieux, l’ornement d’un discours. Ce livre montre, à sa manière, la force des analogies, entre juge et praticien, entre justiciables et patients. Il donne à réfléchir et ce n’est pas le moindre de ses intérêts.