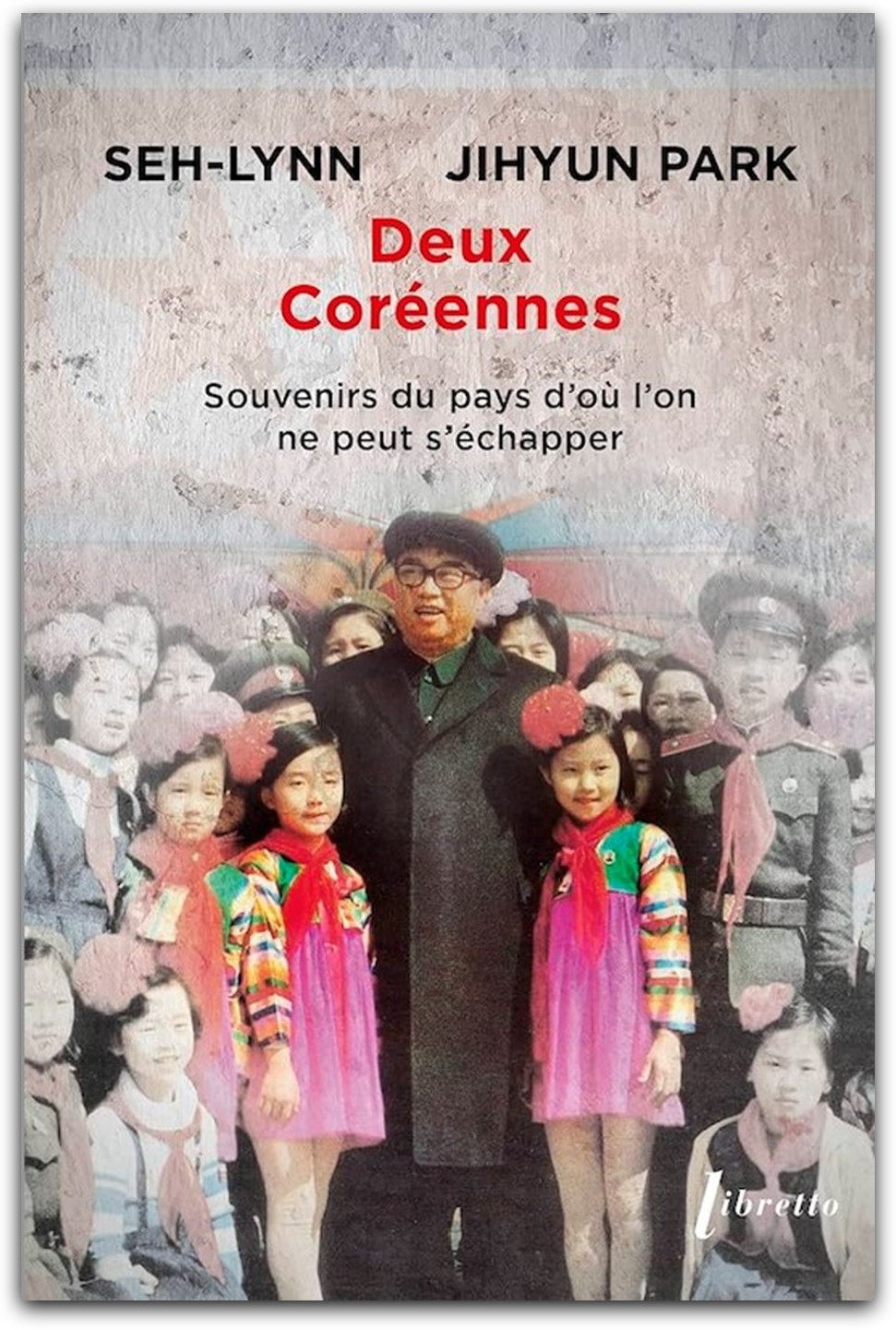La robustesse du vivant
Olivier Hamant
Tracts Gallimard
3€90 n°50
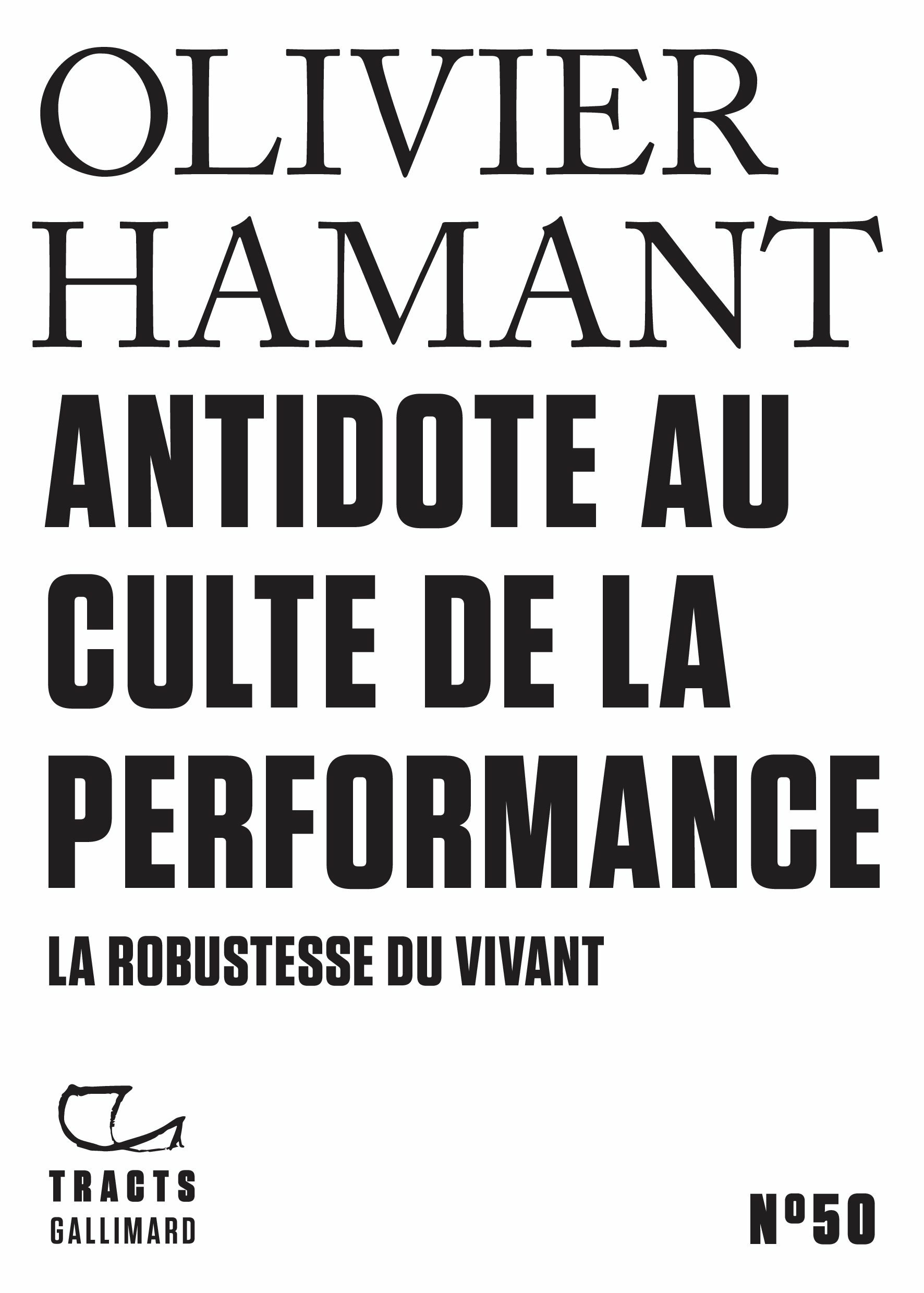
Hier, sur la piste cyclable de l’Isle-Jourdain, un gamin négligé par sa grand-mère s’est mis en travers quand je passais : chute, dérailleur arraché, un mois de délai pour espérer retrouver l’usage du vélo. Les os ont tenu, merci. Où est la performance ? En ville, à Toulouse, le long des plots, nous devrons respecter les 30 kms à l’heure. Où est l’accélération ? Deux exemples parmi des centaines. Notre modernité tardive devient un cauchemar. Olivier Hamant, chercheur à INRA de Lyon se défoule par une série de courts paragraphes. Suivons ses traces.
Passons sur la brève introduction qui souligne la triste réalité du dérèglement socio-écologique et invite à quitter le monde du burn-out.
À propos de robustesse, souvenons-nous d’un commentaire à notre demande de reconnaissance contractuelle il y a plus de 25 ans. Un des énarques temporairement propulsés à la tête de l’Agence Régionale de Santé (qui s’appelait autrement) avait conclu notre présentation d’activité par « La fragilité rend créatif ». Depuis, nos élites n’ont rien appris, rien corrigé, bien au contraire. La créativité dont elles font preuve leur est dictée par le libéralisme financier à l’ère du numérique. Les masses doivent être soumises, atomisées et robotisées.
Revenons au Tract n°50.
Halte à la performance
« En 1972, le rapport au club de Rome, Les limites de la croissance, prévoyait un basculement socio-économique » : « pénuries plurielles de ressources, événements climatiques, remous sociaux, tensions géopolitiques ». Dans son livre éponyme, Dennis Meadows nous invitait à faire un « pas de côté ». Il précisait « Ce sont nos habitudes qui construisent les crises ». L’auteur ajoute « notre principale habitude aujourd’hui, c’est le contrôle et l’optimisation ». Je me porte respectueusement en faux contre cette « dénonciation » : par sa généralité, elle masque la perversion mensongère de notre système de vie. Le Ministère de la Santé est-il acquis au contrôle de l’efficacité et de l’efficience en addictologie étatique et en psychiatrie institutionnelle ? Nous serions très heureux de voir des responsables de Santé publique s’intéresser à notre travail clinique, en commençant par essayer de le comprendre. Nous avons récemment poussé la plaisanterie en les invitant à la découverte d’une réunion thématique sur le discernement, dans le but d’aider des responsables de bonne volonté à ouvrir les yeux. En réalité, la technostructure, comme entité globale, se moque de l’efficience et de l’efficacité. Elle pratique le laisser-faire libéral dès que l’Argent et la pensée paresseuse l’exigent. Son système de contrôle, dispendieux et inefficace, sert essentiellement à la justifier comme organisme de contrôle.
Autojustification
L’auteur dénonce le principe des « indicateurs » quantitatifs, ces chiffres et statistiques qui servent d’argumentaire. Dans le domaine du sport, la priorité de la performance suscite le dopage, les paris… « La croissance donne l’illusion de l’abondance, alors qu’elle crée la pénurie ; elle dessine une trajectoire de progrès alors qu’elle menace la viabilité de l’humanité ». « La masse des indicateurs masque d’autres valeurs et nourrit une forme de pensée réductionniste toxique ».
Réductionnisme
« Optimiser fragilise en appauvrissant les interactions ». L’alcoologie nous en fournit un exemple avec la réduction de l’approche soignante à des suggestions sur les « bons comportements », à des prescriptions de médicaments peu efficaces, le tout visant à « gérer les dommages ». Des pans entiers de connaissance et de l’expression de l’humain sont ainsi éradiqués du soin. Optimiser en pesant par l’absence de ressources est un autre mot pour supprimer ou interdire des activités utiles. Ainsi l’aide aux proches en alcoologie ou même la formation de futurs professionnels. Si nous avions respecté le principe d’une juste rétribution de nos activités, celles-ci n’auraient pu exister et persister.
Effets rebonds
Les gains d’efficience sont censés « faire des économies d’énergie et de ressources ». En réalité, il se produit un « gain d’attractivité » qui aboutit à une consommation accrue. Il n’y a qu’à regarder ce que font 90% des gens dans un métro avec leur portable. Il est facile de commander sur Internet, alors pourquoi fréquenter les boutiques et le marchés ? Ce phénomène est appelé le « paradoxe de Jevons ». Les gains d’efficience se font au détriment des professionnels et même des usagers, invités à faire eux-mêmes ce que des salariés faisaient auparavant, avant d’être éliminés pour « diminuer les coûts ».
Destruction sociale
Les gains de productivité conduisent à la raréfaction des relations humaines, « à des soins négligés, au désengagement, au burn out ». Dans son livre « Le Ministère des contes publics », Sandra Lucbert énonce une chaîne logique : la réduction des impôts (célébrée spontanément) profite à ceux qui en payent le plus. L’allègement fiscal accroit le déficit du secteur public qui détermine, à son tour, une décision de réduction des dépenses publiques, jusqu’au moment où le secteur financier boursier prend possession des services publics malmenés pour dégager des sources de profit qui éloignent un peu du souci du service public. Le tout, cela va sans dire, correspond à la suppression d’un maximum d’emplois qui faisaient vivre les relations.
Aliénation
Les échanges boursiers dépendent de plus en plus de l’intelligence artificielle. « Les guichets physiques sont remplacés par des guichets numériques. On poinçonnait autrefois ; aujourd’hui, on scanne des QR codes ». Yvan Ilitch : « l’œil devient dépendant de l’interface plutôt que l’imagination ».
Technocratie
Plus besoin d’atermoiements délibératifs pour des décisions politiques d’envergure : nous avons le 49-3 et le 47-1. Cette préoccupation de rapidité n’a nullement entravé le retard incroyable de mise en œuvre de transports en commun rapides, non polluants (visuellement) et confortables constituant une alternative attractive aux déplacements individuels. Il en est de même du Nucléaire, plébiscité après avoir été décrié.
Guerres
Les pays les plus riches suscitent les guerres à distance. Outre les bénéfices directs qu’ils en retirent, « la guerre est aussi le carburant de la performance ». Quoi qu’il en coûte. Le développement de l’aviation civile est issu de l’aviation militaire, la généralisation de l’usage des engrais azotés de synthèse découle du procédé de Haber pour fabriquer des explosifs, l’ordinateur a été mis au point à l’occasion du projet Manhattan à l’origine de la bombe atomique, Internet a été stimulé par la Défense nord-américaine. « La guerre est donc bien à la fois un produit et une cause des gains de performance dans un engrenage sans fin. »
Destruction des écosystèmes
« Nos gains de performance ont un coût caché. Les pénuries s’étendent des ressources non renouvelables aux ressources renouvelables, comme le bois et l’eau ».
« Nous vivons les prémisses de la sixième extinction de masse, avec déjà 30 ou 40% des espéces en voie de disparition. « En trente ans, 80% des insectes auraient disparu en Europe ».
Les sols de l’agriculture intensive ne régénèrent plus leur fertilité, ils ne préservent plus leur hygrométrie, ils ne captent plus le CO2 sous forme de matière organique ».
« En deux cents ans, notre obsession de performance a créé des conditions telles que la viabilité de l’humanité sur de grandes régions de la Terre est engagée ».
Les impasses du développement durable
Le tout-électrique à la place des énergies fossiles suscite « des extractions minières de métaux rares extrêmement énergivores, génératrices de pollutions plurielles et de destructions » du cadre de vie. « Le développement durable se réduit trop souvent à une bonne conscience écologique ».
« La révolution à venir est bien plus profonde qu’une réforme fiscale ». Le défi est de passer du « toujours plus, au moins mais mieux. »
L’adaptation et la fluctuation
De tous les rapports produits, un mot à retenir pour l’auteur : fluctuation. Le climat déréglé sort de l’écart-type. Il y a près de dix mille ans, à l’issue de la dernière glaciation, nous avons inventé l’agriculture, l’élevage, la sédentarisation. L’industrialisation a suivi. « Aujourd’hui, la Nature menacée devient menaçante ». « Notre certitude, c’est le maintien et l’amplification de l’incertitude ». « Quand on est très adapté, on est forcément spécialisé », « ce qui signifie que l’on a abandonné des compétences jugées inutiles ». Nous le voyons bien en médecine quand le contact humain et le contenu culturel qui va avec disparaît. La stabilité suppose l’adaptation, l’instabilité l’adaptabilité. L’instabilité incite au pragmatisme.
L’approche intégrative
Juste ciel ! Ce chercheur en agriculture nous livre une réflexion qui concorde avec notre expérience et notre pratique (p 19) : « Le vivant n’est pas très performant…
Ce réexamen du vivant, riche de ses nombreuses contre-performances, est consolidé par une révolution récente en biologie : l’approche intégrative et systémique. » C’est ce que nous nous sommes employés à faire dans notre pratique de clinicien, en suscitant des progrès individuels à partir des « contre-performances » induites par l’alcoolisation, ce qui nous a permis de nous confronter ( ?) à la cécité des élites universitaires et bureaucratiques.
Le vivant comme modèle de contre-performances
Dans un écosystème – et l’écosystème alcoologique ne fait pas exception ! – « nous retrouvons de l’hétérogénéité, des processus aléatoires, des lenteurs, des délais, des redondances, des incohérences, des erreurs et de l’inachèvement » (p20)
Habiter un monde fluctuant
« Depuis le Néolithique, le progrès de l’humanité a été guidé par les gains de performance ». Nous avons atteint une limite où le processus s’inverse. » « La mondialisation est un château de cartes »
La robustesse avant la sobriété
« Proposer à une personne démunie d’être sobre est indigne. » Nous avons à quitter l’époque de l’optimisation construite sur la pauvreté des interactions. »
Trouver les questions d’abord
L’auteur souligne l’intérêt de la perplexité (il aurait pu parler du doute, si décrié de nos jours). Einstein estimait que l’important était de partir d’une bonne question. Nous pourrions ajouter : d’une bonne observation. Par exemple, « les groupes de parole marchent en alcoologie, pourquoi ? ». « Dans le monde de la performance, on va trop vite vers la solution sans remettre en cause la pertinence des questions. » « L’acte de parler est essentiel pour se penser, la verbalisation laissant échapper des vérités et des intuitions qui, sinon, resteraient diffuses, enfouies, refoulées ou encore biaisées par des clichés et des automatismes ».
Comme disait aussi Soulages : « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche ».
Produire pour nourrir les écosystèmes
Dans le monde stable de la performance, l’accroissement des rendements agricoles a été un objectif qui a permis de résoudre en bonne partie les besoins de nourriture. Il en a résulté des conséquences négatives déjà mentionnées : effondrement de la biodiversité, pollutions, imperméabilisation et désertification des sols, consommation d’énergies fossiles, désertification des campagnes. Le paysan, en agroécologie, dispose de toute une gamme de comportement alternatifs qui s’opposent à l’agriculture industrielle.
Une économie de l’usage collectif
Nous retrouvons l’exemple des transports en communs efficaces, le refus de l’obsolescence programmée, la réparation préférée au changement. Il est question de la voiture du futur mais comment ne pas penser aux voitures simples du passé ? La 2CV était d’une simplicité remarquable. Je me souviens avoir fait tenir pendant des mois les fils du contact par un épingle en bois après la perte de la clé de contact. Avons-nous besoin des sophistications actuelles pour se déplacer ?
Plus loin (p 33) l’auteur parle de recherche impliquée plutôt qu’appliquée. Il plaide pour une innovation qui s’oppose à la performance bureaucratique. En d’autres termes, pour sortir de l’écriture pénitentiaire, il plaide pour l’innovation intelligente au service de l’utilité générale plutôt que la recherche d’améliorations « high tech », financées par l’impôt. Il met l’espoir dans la biomasse végétale (p35). Il évoque la possibilité de batteries à base de lignine (molécule la plus fréquente sur Terre, après la cellulose). Elles sont plus encombrantes que les batteries à base de lithium. Elles remplacent les métaux rares. Pour lui, il ne s’agit pas de décarboner en remplaçant le pétrole par les métaux rares. La bioéconomie demande de respecter la nature, en laissant les bactéries, les champignons et les plantes fabriquer la biomasse, à leur rythme, sans davantage s’en prendre aux besoins des écosystèmes et des humains.
Le travail
L’auteur ne manque pas de souligner « la double épidémie de démissions et de burn out qui marque ce quart de siècle. » Il est possible et souhaitable de revisiter la notion de travail (c’est notre point de vue) plutôt que d’opposer le travail au non-travail. Quand je lis, souligne et résume ce tract, je travaille. La perversion de notre temps est de rétribuer l’argent plutôt que le travail et d’avoir une vision rabougrie, salariale ou à l’acte du travail, sans tenir compte du temps et des ressources mobilisées. La maîtrise de l’activité est nécessaire au plaisir de travailler.
Court, moyen ou long terme
« Dans un monde turbulent, le long terme n’existe plus » (p42). « Spéculer sur les futurs possibles » revient à laisse prospérer le chaos en rêvant de la vie sur Mars. Reste ce qui est possible à court terme et ce qui peut se préparer à moyen terme (le temps étant fonction de l’objectif). L’essentiel est de rester en jeu et sur le chemin.
L’éducation
Ce chapitre n’est guère convaincant car il fait l’impasse de la situation réelle, telle qu’elle se vit chaque jour. Une fois acquis les fondamentaux, l’essentiel est de ne jamais cesser d’apprendre, d’exercer son esprit critique et d’agir en restant reliés et complémentaires, entre gens de bonne volonté.
Au terme de cet essai, faut-il préférer le terme de robustesse à celui de résilience ? Comme tous les concepts utilisés, la résilience a été mise à toutes les sauces. Si nous la rapprochons des problématiques addictives et alcooliques, nous voyons bien qu’il s’agit de concepts-valises qui ne disent pas grand-chose du réel, en définitive. Les rapports sociaux de domination actuels sont ce qu’ils sont. Les effets paralysants et destructeurs du système mondialisé sont ce qu’ils sont. Le tout nous conduit à la catastrophe. Le culte de la performance est une des absurdités et une des impostures du système en place, au même titre que la productivité orchestrée par la logique du profit financier et des compétitions entre grandes puissances…