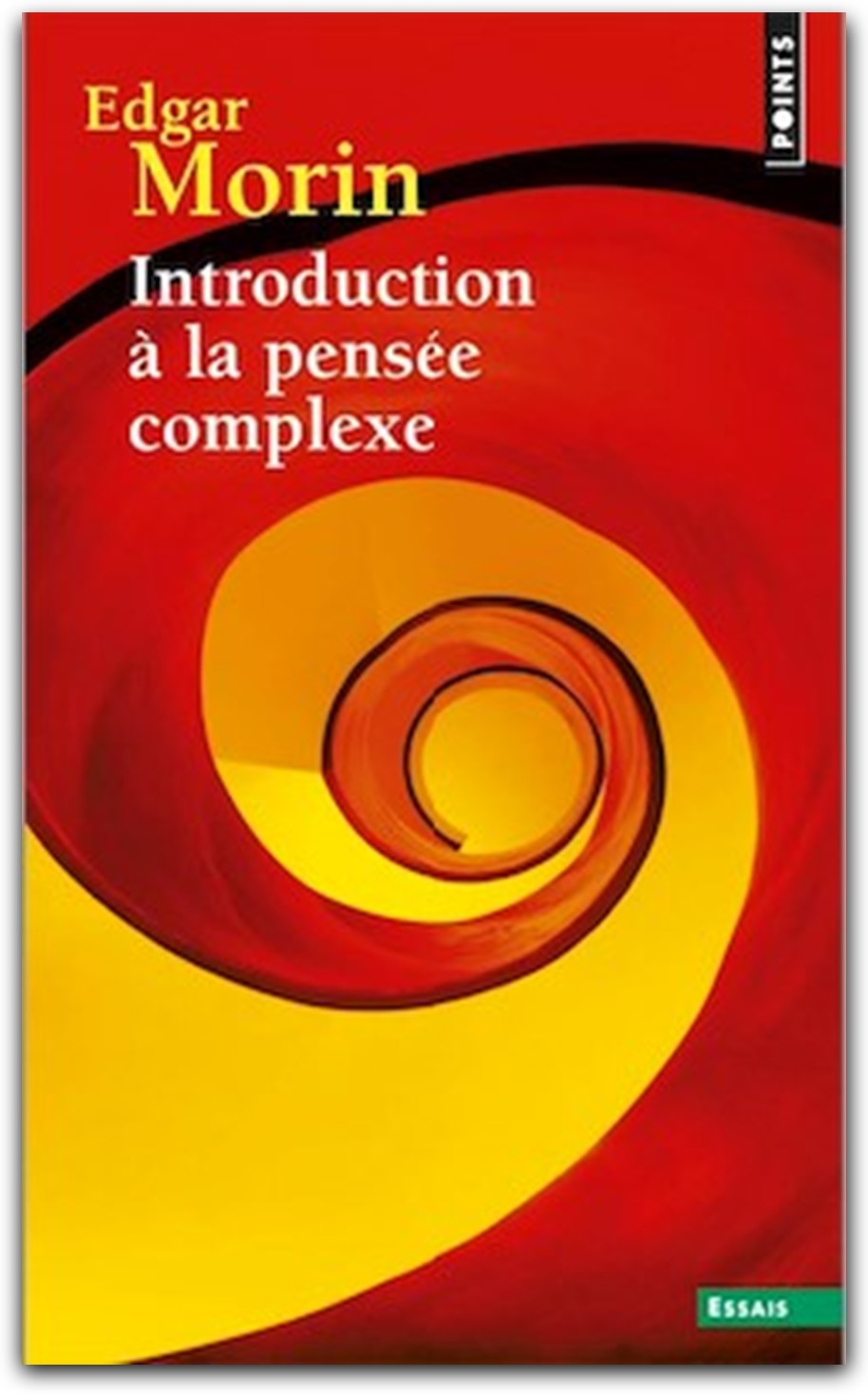Pascal Ory
Tracts
Gallimard
3€90, n°51, 39 pages
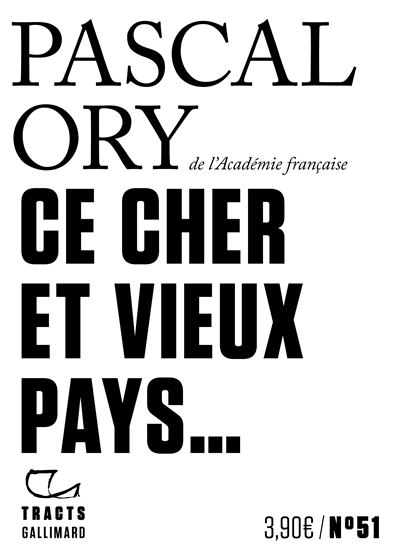
Pascal Ory est d’origine bretonne. Il est historien. Il a écrit sur le nazisme, sur le Front populaire. Il s’est intéressé de près à la bande dessinée. Il a eu une vie bien remplie, celle de son époque. Il a publié chez Gallimard.
Ce qui va suivre est moins un résumé qu’une brève méditation sur cette apostrophe gaullienne, tendre et nostalgique. C’est du moins tel que je le ressens.
Mais commençons par présenter le propos de l’historien Ory.
Pour résumer, l’auteur oppose le régime politique français centralisé à l’organisation politique suisse qui en est l’opposé. La Suisse n’a pas de chef d’État, même pas pour « inaugurer les chrysanthèmes ». Ce qui tient lieu de gouvernement est un collège de sept membres, l’Etat fédéral. Les 4 partis politiques y sont représentés et partagent les responsabilités. Un parlement élit à la fois l’exécutif et les juges fédéraux. Quatre fois par an, les citoyens votent sur des référendums qu’ils soient d’initiative populaire ou représentative. Les traditions politiques françaises se sont établies à l’inverse, depuis Louis XI par étapes successives, de Richelieu à Colbert jusqu’à Bonaparte puis son oncle Louis-Napoléon et enfin de Gaulle. Quand Mitterrand, auteur du « Coup d’État permanent », a été élu président de la République, il s’est dépêché de ne rien changer. Aujourd’hui, derrière un président qui a pu s’identifier à Jupiter, on se demande à quoi sert la volière de l’Assemblée nationale, en dehors d’être une annexe de Pôle Emploi pour des fractions de la bourgeoisie urbaine. Je sais, je suis polémique. Ory a le mérite de souligner la réalité de l’Etat Jacobin, sans le nommer. Il n’évoque pas le poids de la technostructure administrative ni la déperdition de pouvoirs consécutive au pouvoir de structures supranationales, identifiées ou non, dont les orientations doivent très peu à l’entité nationale.
Il n’évoque pas davantage le pouvoir désagrégeant du multiculturalisme et de la géopolitique actuelle.
Il cite un texte de 1934 de Paul Valéry (p16) : « la réponse inévitable (et comme instinctive) de l’esprit quand il ne reconnaît plus dans la conduite des affaires, l’autorité, la continuité, l’unité, qui sont les marques de la volonté réfléchie et de l’empire de la connaissance organisée ». Le triptyque « autorité, continuité et unité » » dont la version romanesque est « liberté, égalité, fraternité », porte un nom : dictature.
Il reste à méditer sur la forme de dictature qui permettrait de rétablir la démocratie au sein de l’entité nationale. Nous soyons vers où nous mènent nos renoncements successifs à préserver l’unité, la continuité et l’autorité.
P 19-20 : « Si le talent de Churchill fut de résister victorieusement non à Hitler mais d’abord à Neville Chamberlain et à Lord Halifax, le talent de De Gaulle fut, sinon de faire croire, du moins de faire dire que la France avait résisté ».
Il est relevé, plus loin (p32) que « les révolutions fondatrices de la modernité politique sont toutes adossées à la religion (protestante), la française, au contraire se heurte de front à l’Eglise (catholique). La Laïcité faisant des religions « une affaire privée », selon le mot du communiste Roland Leroy, a permis un apaisement progressif des antagonismes. Ce « cher et vieux pays » s’est doucement réconcilié, unifié, jusqu’à ce le mondialisme néolibéral en décide autrement.
Pascal Ory n’est pas optimiste (p38) : « Il apparaît de plus en plus nettement que le moteur historique suprême pourrait être la crise écologique, appelée à jouer le rôle imparti à « 1929 » dans les deux décennies qui l’ont suivie. » Il est difficile d’imaginer dans ce contexte ce qui pourrait faire « progresser la démocratie participative et ne pas faire reculer la démocratie représentative ».
Que va devenir « ce cher et vieux pays » ?