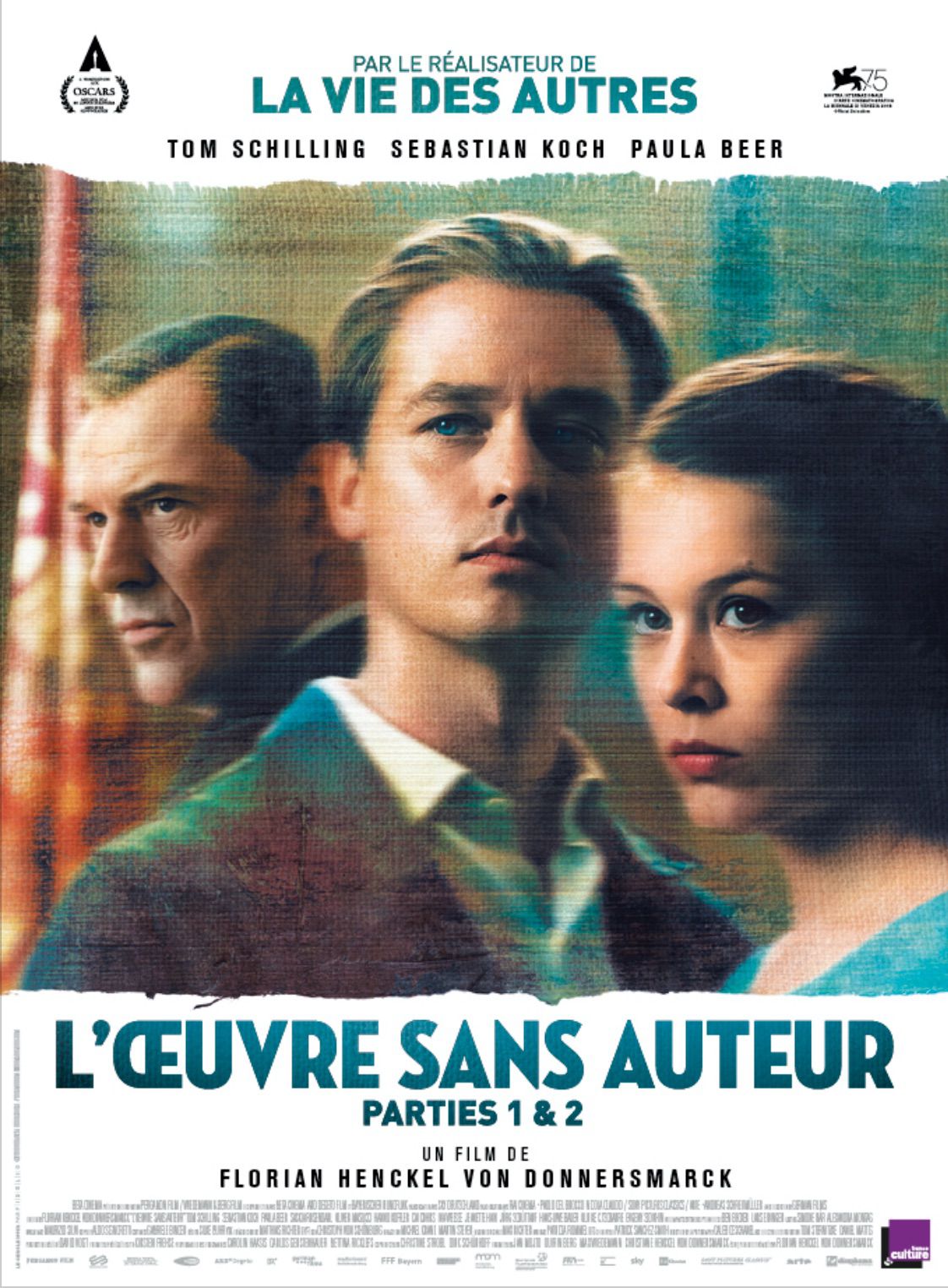Réalisation : Hiner Saleem
Scénario : Thomas Bidegain, Hiner Saleem, Véronique Wüthrich
Date : 2019
Turquie – France - Belgique
Durée : 90 mn
Acteurs principaux :
Mehmet Kurtulus : Fergan, l’inspecteur
Ezgi Mola : Azra, la propriétaire de l’hôtel
Ahmet Uz : Kasim
Turgay Avdin : Kurak, le journaliste
Senay Gürler : Lady Winsley
SA/ HA
Mots clés : identité – divertissement – mœurs – mystère – humour

Lady Winsley est une américaine qui a l’habitude de passer l’hiver dans une île turque pour écrire ses romans. Elle est trouvée morte dans sa villa. L’inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour l’enquête. Il fait la relation entre l’assassinat – d’une seule balle et sans violence – de la romancière et le fait qu’elle écrivait un livre traitant d’un meurtre survenu vingt ans plus tôt dans l’île. Le livre est introuvable. Fergan émet l’hypothèse que le meurtrier pourrait être le fils illégitime d’un notable de l’île, déclenchant un vaste dépistage par des tests ADN. Cela faisant, il soulève une question-tabou, celle des relations extra-conjugales. Le journaliste de l’île révèle alors que l’inspecteur est d’origine kurde. Les habitants lui deviennent d’autant plus hostiles. L’inspecteur est d’abord vécu comme un perturbateur, un étranger, y compris par les femmes de l’île : « Et d'abord, on est chez nous et on a le droit de tuer qui on veut! ». Cependant, Fergan et Arza, la propriétaire de l’hôtel tombent amoureux et celle-ci maîtrisant l’anglais va aider l’inspecteur à résoudre l’énigme quand le tapuscrit devient disponible, à l’initiative de la mère d’un suspect.
Que peut apporter une intrigue policière à un patient alcoolique ?
« Qui a tué Lady Winsley ? » reprend sur un mode humoristique la construction d’une enquête policière à la façon d’Agatha Christie : un meurtre sans mobile évident, une communauté restreinte, des rebondissements, un dénouement inattendu. Une personne qui suspend son addiction doit affronter de nombreux problèmes. Elle dispose aussi d’un temps libéré qui laisse place aux divertissements. En quoi ce genre de film policier peut-il la satisfaire ? À la différence des émissions télévisées ou des films noirs créant une atmosphère d’angoisse, émaillés de violences, de « scènes de sexe » et dégoulinant de sang, ce type d’histoire est de tout repos : l’énigme est posée, l’inspecteur saura la résoudre et dans l’intervalle nous avons la possibilité de découvrir, grâce à des acteurs inconnus et un scenario élaboré, des visages, et des éclairages propres au cadre où se déroule l’action.
L’histoire donne l’occasion de se rapprocher de mœurs qui participent au dépaysement. Le fait qu’elle se déroule sur une île turque et que l’inspecteur soit d’origine kurde conduit à nous intéresser aux particularités de cette diaspora sans territoire défini. Elle permet de s’interroger sur l’origine des conflits identitaires, des contentieux enfouis qui alimentent une intolérance peu compréhensible de l’extérieur. L’intrigue policière devient en partie le prétexte de la découverte d’une forme de culture insulaire, avec l’humour ainsi que l’archaïsme et les oppositions idéologiques qu’elle véhicule. Nous avons l’occasion de découvrir des personnalités singulières et d’assister à l’évolution des protagonistes. Le rapprochement amoureux de l’inspecteur Fergan et de son hôtesse Azra s’effectue en contrepoint de l’enquête.
La confrontation entre une justice du continent, c’est-à-dire d’Istanbul, se voulant scientifique, recherchant systématiquement le criminel via son ADN, et la volonté de la population de retrouver sa tranquillité, après le meurtre d’une étrangère, est une source d’amusement pour le spectateur. Un tel film est recommandable. Il répond au souci de légèreté et de peuplement d’images qui convient à un esprit confronté à la grisaille de son quotidien.