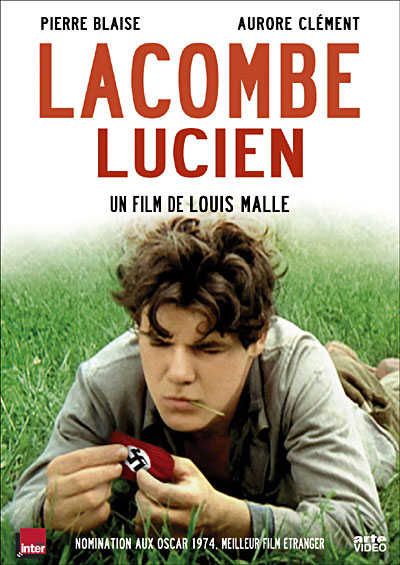Réalisation et scénario : Greta Gerwig,
D’après le roman de Louisa May Alcott
Date : 2019 / USA
Durée : 135 mn
Acteurs principaux :
Saoirse Ronan : Jo(éphine) March
Emma Warson : Meg March
Florence Puch : Amy March
Elisa Scanlen : Beth March
Meryl Strep : Tante March
Laura Dern : La mère
Timothée Chalamet : Laurie
SA/ HA
Mots clés :
Fratrie – Féminisme − Famille – Écriture – Loi du père
Un roman familial dans l’arrière-plan d’une guerre
Deux œuvres de femmes ont rendu compte de la société nord-américaine au temps de la guerre de Sécession : Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell, et Les filles du Docteur March, de Louisa May Alcott. La version de « Little women » mise en scène par Greta Gerwig est la huitième au cinéma.
La guerre de Sécession a été une crise de croissance fratricide. Elle a été décisive pour la constitution des Etats-Unis en grande puissance économique. La culture protestante choisissait le salariat contre l’esclavage. Le père, contrairement à la suggestion du titre, est un pasteur, comme le père d’Alcott et d’Austen, et non un médecin comme dans le roman.
Un film écrit comme un livre
Le film est subtil, intelligent et fin. Certaines répliques justifieraient d’être mémorisées. Le sous-titrage passe trop vite et il faudra attendre la version DVD pour les arrêts sur image. Le récit est alerte pour une histoire familiale conventionnelle. Le montage de séquences de temporalité différente déconcerte jusqu’à ce que le spectateur trouve ses repères. C’est un film conçu pour décrire l’écriture d’un livre. De nombreuses scènes illustrent les étapes de la production d’un livre. Le choix de dérouler l’histoire en la centrant sur Jo, la sœur la plus « rebelle », l’indépendante, le « garçon manqué », l’écrivaine, s’impose, de ce fait. Le personnage de Jo est remarquablement joué par l’actrice de Lady Bird, Saoirse Ronan, le précédent film de Greta Gerwig.
Des réminiscences
Ce film s’inscrit dans une double continuité anglaise, littéraire et cinématographique. Il est, à l’évidence, soixante ans plus tard, imprégné de l’œuvre de Jane Austen. Plusieurs séquences du film renvoient aux meilleures transpositions au cinéma des livres d’Austen, le Orgueil et préjugés de Jo Wright, le Raisons et sentiments d’Ang Lee, dont Emma Thompson, la scénariste du film, disait qu’il s’était révélé plus anglais qu’un anglais. Certaines scènes suscitent d’autres réminiscences pour des films plus récents. La scène finale « sous le parapluie » n’est pas sans évoquer le happy end, de « Coup de foudre à Nothing Hill ». Il est d’ailleurs suggéré par le sympathique éditeur.
Quatre filles face à leur condition
Le roman d’Alcott est le roman familial d’une fratrie de filles. L’histoire illustre le passage de l’enfance à la vie adulte. Elle se nourrit de la vitalité de la jeunesse. Les quatre sœurs sont, dans l’ordre, Meg (Margaret), Jo (Joséphine), Beth (Elisabeth), et Amy, la plus jeune. L’unité de la fratrie de filles résiste aux différences de caractère et aux rivalités amoureuses. Le mélodrame est évité, malgré la mort de Beth. La condition féminine de l’époque est évoquée sans outrance, en distinguant les différences de fortune.
Au final, Jo March, pourra tirer avantage du legs inespéré de sa tante March pour créer une école. L’époux de Jo et son beau-frère pourront y exercer leurs compétences d’enseignants, tout comme elle. Le poids de l’argent n’est pas escamoté. C’est aussi pour gagner de l’argent que Jo écrit. Les échanges entre Jo et l’éditeur, sur le partage des bénéfices à venir, ne manquent pas de saveur.
Le sens du collectif ou « loi du père »
La Loi du père dont il a été si souvent question dans le langage lacanien prend ici sa signification symbolique. Le sens du Collectif – autre expression plus exacte que la « Loi du Père » – est incarné aussi bien par la mère que par les sœurs. Le père s’est porté volontaire, en dépit de son âge. Il est donc absent, inexistant. Il n’y a ni patriarcat ni matriarcat, en dépit de la présence attentive de la mère. Les mêmes valeurs sont partagées. Elles épousent le logique libérale et le désir de promotion sociale. L’unité familiale ne s’affirme pas contre le reste de la Société. La générosité existe : aide de la famille March à une famille de miséreux, sans père ; don d’un piano par le vieux châtelain James Laurence à Beth ; don de la propriété de la tante March pour finir à Jo, l’héroïne. L’altruisme est présent dans les cœurs et les actes. C’est une action de charité et de solidarité concrète qui lance l’histoire.
Un féminisme intégré
Ce sont les femmes qui assurent la continuité en ces temps de guerre. Elles le feront plus encore lors du premier conflit mondial. Elles doivent gérer la pénurie. Les sœurs March s’aiment, aiment et respectent leurs parents. Elles surmontent leurs différences de personnalité. Elles peuvent affronter solidairement le malheur. La mère, Mary, assistée d’une domestique, assure le fonctionnement de la maison et la cohésion de la famille. Elle donne du temps pour porter assistance aux soldats nordistes.
Le féminisme de cette histoire ne se constitue pas contre les hommes. Ces derniers s’écartent des stéréotypes et des caricatures qu’ils justifient trop souvent aujourd’hui. Théodore, « Laurie » Laurence manifeste sa fantaisie et sa vulnérabilité de garçon abandonné par ses parents. Il a tendance à abuser de l’alcool. Amoureux de Jo, il deviendra l’époux d’Amy, la douée en dessin, manifestant ainsi une forme de versatilité. James Laurence ; son grand-père, le vieux châtelain, est inconsolable de la perte de sa fille. Il exprime son transfert d’affection sur Beth, pianiste comme sa fille. Le percepteur de Laurie, John Brooke, est de « condition modeste ». Il tombe amoureux de Meg, l’aînée, et l’épouse. Il respecte sa liberté quand elle achète un tissu de robe au-dessus de leurs moyens. Frédéric, aperçu au début et à la fin du film, fait l’honneur à Jo de sa franchise de lecteur, écorchant sa susceptibilité. Il sera choisi – à la fin – par l’héroïne, poussée par les siens à laisser s’exprimer ses sentiments.
Avoir osé ce film
La surprise, en définitive, vient d’avoir osé ce film, à notre époque. Serait-il possible de s’intéresser aujourd’hui encore à la famille, à un féminisme qui ne diabolise pas les hommes, à la qualité du langage, à des relations humaines excluant le sordide ?
Quels enseignements pour les addictions ?
Nous pouvons tout d’abord relever la remarquable absence d’addiction dans cette histoire. Seul Laurie manifeste son penchant pour l’ivresse afin d’atténuer son mal-être.
Sans doute, pourrions-nous relever la place de l’argent dans la vie de la tante March ? Il ne s’agit pas d’une addiction. La fortune de cette veuve est la garante de son indépendance. Elle fait elle-même la comparaison entre le mariage et la prostitution, compte tenu de l’inégalité d’accès aux métiers lucratifs entre les femmes et les hommes.
La passion de l’écriture que manifeste Jo relève d’un besoin vital, à caractère addictif. Il serait mal venu de lui en tenir rigueur. Des romancières de cette époque l’ont démontré : l’écriture est le seul moyen dont elles disposaient pour exprimer leur intelligence et leur vision du monde. En cela, l’écriture manifeste le besoin d’exister des femmes et au-delà, des personnes non reconnues.
Le collectif, tout en tenant compte des singularités de chacun et des différences de condition, n’est jamais oublié. Il trouve sa raison d’être dans l’amour partagé, et non dans la recherche de la domination des uns par les autres ou de la coexistence d’individus sans appartenance, narcissiques, pervers ou infantiles. Le peuple américain est en cours de gestation. Sa mythologie illustrée par la filmographie d’un John Ford ou d’un Frank Capra est encore crédible. Elle alimente l’estime de soi et la foi dans l’avenir.
Les combats d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux d’hier ou d’avant-hier. Ils ne pourront cependant être menés qu’à partir des valeurs incarnées par la plupart des personnages de cette histoire : le courage, le souci de l’autre, le sens du collectif, le goût de l’effort, l’humilité, une forme d’optimisme, associés à l’acceptation de ce qui ne peut être changé. (reluMF)
Nouvelle lecture (à partir du DVD)
La découverte du DVD nous a enchantés. Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette famille aux convictions bien ancrées, aux talents complémentaires. Au fond, nous ne savons pas s’il nous est raconté une histoire vraie ou s’il s’agit des épisodes d’un roman qui s’écrit. La vérité est au service de la fiction qui devient, à son tour, force de vérité.
Il est regrettable que la longueur du film ne permette pas de le proposer à un atelier-cinéma.